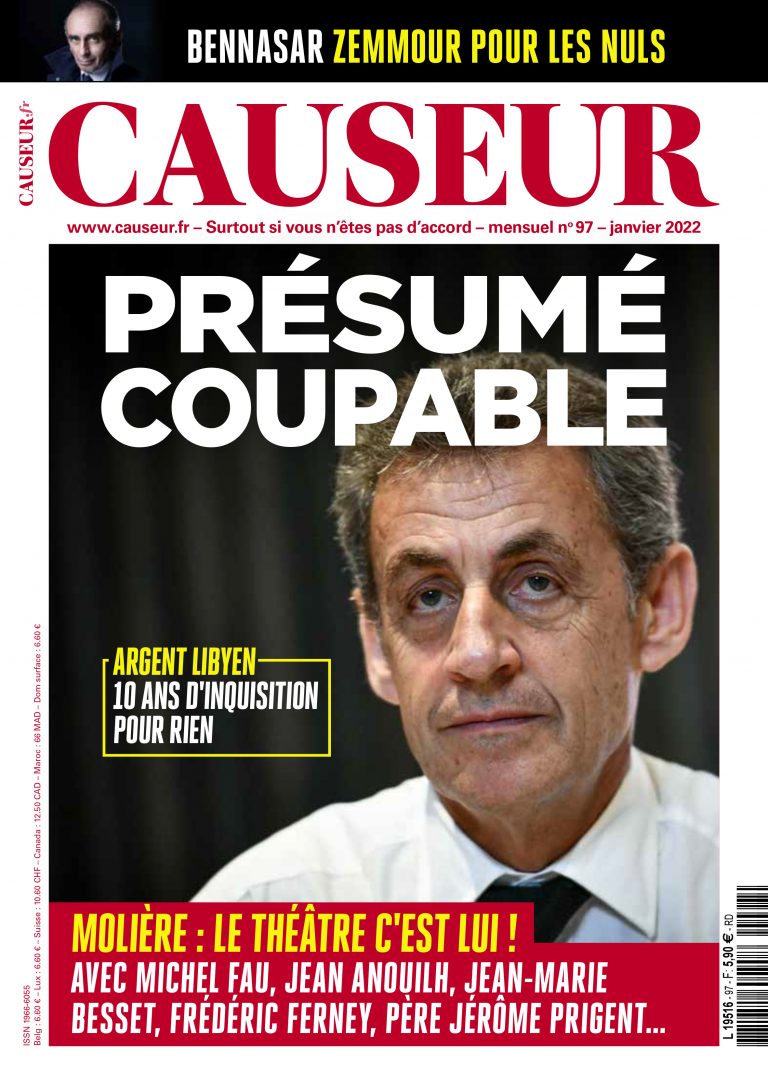Le débat est toujours vif entre les tenants d’un Molière farcesque et populaire et ceux qui défendent sa profondeur quasi élitiste. À l’inverse, il en est même qui estiment qu’il « n’est pas un grand écrivain ». Et si son œuvre se plaçait, tout simplement, au-delà de ces querelles ?
Le ver a été mis dans le fruit d’emblée, par l’ami Boileau – les critiques sont-ils jamais vraiment des amis ? : « Dans le sac ridicule où Scapin s’enveloppe, je ne reconnais pas l’auteur du Misanthrope. » La malédiction dure depuis quatre siècles. Il y aurait donc dans l’œuvre de l’auteur Molière, d’un côté des pièces nobles et profondes (Misanthrope, Tartuffe, Dom Juan…) et de l’autre des farces vulgaires (Georges Dandin, Les Fourberies de Scapin, L’Avare…) souvent puisées chez des auteurs comiques anciens (Plaute) ou contemporains (Cyrano de Bergerac).
Cette facile séparation de l’œuvre en deux versants épouse la limite qui a été celle de l’art de l’acteur Molière sa vie durant, triomphant dans le genre comique, échouant dans le tragique. « Le Roi a un peu baillé à Nicomède », persifle Saint-Simon lors de la première représentation de la troupe devant la cour de Louis XIV, dans l’actuelle salle des Cariatides, au Louvre. Molière se rattrape aussitôt en enchaînant avec une bouffonnerie de son cru, si bien que leurs majestés « se tenaient les côtes de rire ». Quinze ans plus tard, lors de son enterrement, on entend certains commenter : « On ne sait pas ce que valent ses pièces, mais qu’est-ce qu’il nous aura fait rire ! »
Depuis Molière, nous avons aussi conservé une distribution, un découpage toujours en vigueur. Il y a deux sortes d’auteurs dramatiques : les praticiens et les reclus. Ceux qui écrivent dans le secret de leur cabinet, et ceux qui participent activement au montage et à la représentation de leur pièce, quitte à devenir chefs de troupe, voire directeurs de théâtre. Ainsi, nous avons d’un côté, Corneille,