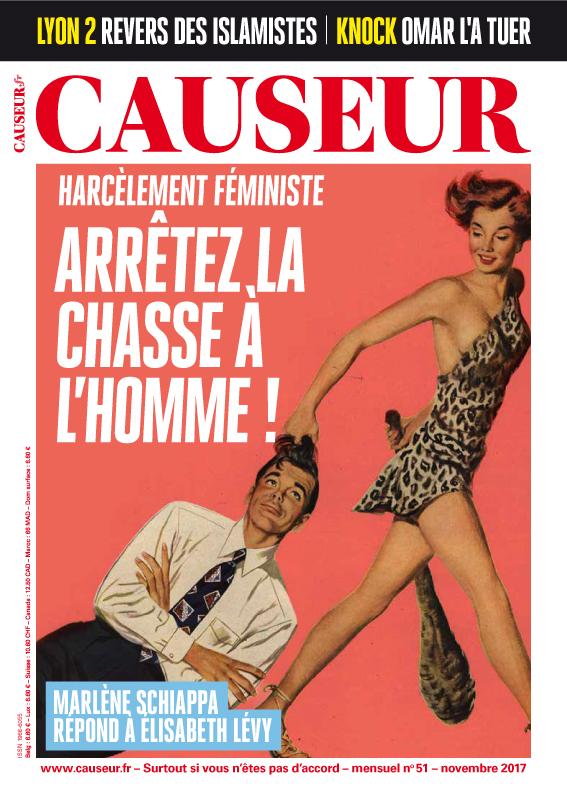Auteur radical mais grand public, Melville est l’une des figures les plus fascinantes du cinéma mondial, et aussi l’une des plus mystérieuses. A l’occasion du centenaire de sa naissance, plongée dans le théâtre d’ombres d’un homme qui se définissait comme « anarcho-féodal ».
L’air grave, l’homme s’approche de son neveu et désigne deux fauteuils Louis XV. « Tu vas bien les regarder et ensuite, tu vas me dire, sans te tromper, quel est le plus beau donc le plus cher. » Le gamin montre le bon siège. La leçon tombe, définitive : « À partir d’aujourd’hui, tu sauras toujours la différence qu’il y a entre le beau et le reste. » De retour dans l’appartement familial, l’enfant cogite, saisit la caméra Pathé Baby à manivelle offerte pour son sixième anniversaire et filme la rue de la Chaussée d’Antin. Cinquante ans plus tard, à sa mort en 1973, il aura bouleversé le cinéma en créant ses propres studios, se sera affranchi des académismes bien avant la Nouvelle Vague, et aura façonné un personnage mythique, un fantôme en Stetson et lunettes noires. Surtout, il aura signé 13 longs-métrages hors du commun, en parfait équilibre entre exigence artistique et séduction du grand public, monolithiques et pourtant riches en recoins subtils, une somme si radicale et bouleversante qu’elle déborde largement du cadre de la seule cinéphilie pour hanter chaque instant de la vie de ses admirateurs. Il sera devenu Jean-Pierre Melville.
Révélation aux Folies-Bergères
Né en 1917, Jean-Pierre Grumbach se découvre un goût pour le music-hall grâce à l’oncle antiquaire, un ami de Maurice Chevalier et Mistinguett. Le cinéma muet le laisse froid en comparaison des soirées des Folies-Bergères. Sans doute est-ce face à ces spectacles que le futur Melville se forge l’une de ses convictions : l’artiste doit remplir les salles. Une rage de convaincre et de séduire qui ne le quittera jamais, d’où son goût pour les stars, contrairement à l’ascèse prônée par Bresson, cinéaste auquel on le compare souvent et paresseusement. L’arrivée du parlant change la donne. Le jeune Jean-Pierre devient cinéphile, fasciné par les films américains. Sa vie s’articule autour des heures de projection et des salles de quartier. « Tout le monde a le droit de tourner, expliquera-t-il, une seule condition est nécessaire : être amoureux fou du cinéma. » Et l’amour fou, il connaît : il revoit les films plusieurs dizaines de fois, compare les réalisateurs, dresse une liste des 63 meilleurs cinéastes américains. La guerre vient briser cet élan. D’origine juive, il s’engage dans la résistance et prend Melville comme pseudonyme, par passion pour l’écrivain, plus particulièrement pour Pierre ou les ambiguïtés.
Après la libération, dès 1947, Jean-Pierre Melville décide d’adapter Le Silence de la mer de Vercors, livre mythique de la Résistance française. Personne ne connaît ce type, cinéaste autoproclamé après un court-métrage. L’auteur lui refuse les droits du roman,