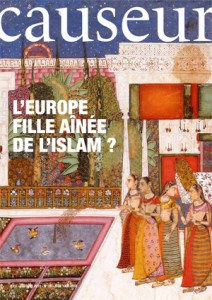Je suis bien placé pour parler de Tony Curtis : j’ai été Danny Wilde pendant de nombreux mois à l’aube des années 1980. Le blouson court et les gants en simili cuir portés jusqu’en été me donnaient sans doute une allure étrange, mais le ridicule de mon accoutrement ne m’a jamais effleuré. Le séducteur tendre et retors qui donnait la réplique à Brett Sinclair (Roger Moore), dans Amicalement vôtre, était alors pour moi une sorte de mauvais génie délicieux, un Alcide sans gravité qui me corrompait doucement, me faisait croire à ma légèreté et à mon insouciance. C’est peu dire que je ne lui ai jamais complètement pardonné.
Tony Curtis a toutefois des circonstances atténuantes ; c’est justement grâce à son personnage de série télévisée que je suis entré en cinéphilie. Cherchant à retrouver sa fascinante désinvolture, je me mis en quête de quelques-uns de ses rôles comiques et le découvris dans les élégants navets de Richard Quine comme dans les farces enlevées de Blake Edwards. C’est là que le premier choc survint. Je compris rapidement que j’avais été avant tout séduit par les intonations ironiques et le timbre sautillant de Michel Roux, car la voix originale de Curtis, grave et presque monocorde, ne lui ressemblait décidément pas… Une voix d’ailleurs à la limite du désagréable, au point que celle-ci effraie Mia Farrow et perturbe le spectateur du Rosemary’ baby de Polanski. C’était un premier dessillement : il y en aurait d’autres.[access capability= »lire_inedits »]
Découvrant, au fil des années suivantes, sa filmographie chaotique, il m’apparut assez rapidement que ses choix se tournaient volontiers vers des personnages plus troubles qu’il n’y paraissait de prime abord, manipulateurs et ambivalents, joueurs avec la morale comme avec la vertu, qu’ils fussent travestis pour la bonne cause (Certains l’aiment chaud) ou corrompus sous le fard (Le Grand chantage). C’est d’ailleurs cette ambiguïté fondamentale, apanage des grands acteurs, qui constitue le ressort dramatique des beaux films de doute et de trahison que sont Trapèze ou Les Vikings. Une sorte de synthèse de son style se retrouve en quelque sorte dans l’amusant Roi des imposteurs, réalisé par Robert Mulligan en 1960, où il campe toute une série de personnages contradictoires avec une réjouissante amoralité.
L’étrangleur de Boston : un tournant
Et puis, il y eut la découverte de L’Etrangleur de Boston (Richard Fleischer, 1968), où il jouait le rôle du psychopathe bien avant que le fait de casser son image devînt le passage obligé de toute carrière hollywoodienne. Désormais, plus de plaisante ambivalence : juste le malaise insistant. Certes, d’autres rôles, plus tard, permirent à la noirceur de Mr Schwartz (son véritable patronyme hongrois) de continuer à se déployer, comme le gangster psychotique de Lepke (1975), remarquable thriller réalisé par le producteur Menahem Golan, pourtant bien peu inspiré par la suite, ou encore le vil sénateur McCarthy du déroutant film de Nicolas Roeg, Une Nuit de réflexion (1985), mais avec ce film-pivot, le cinéma enfin ne m’apparaissait plus uniquement comme la coexistence de saynètes aimablement variées, mais devenait cette longue coulée où le style épouse le propos.
En passant de Danny Wilde à l’étrangleur DeSalvo, du confortable découpage télévisuel à l’imprévisibilité du montage cinématographique (le film de Fleischer contient les plus beaux split-screens qu’il m’ait été donné de voir), je quittais le confort des fictions sans conséquence pour commencer à côtoyer l’incertitude des récits où, même si tout est faux − et surtout les diverses représentations du Vrai−, d’authentiques rencontres se nouent entre les images du monde transposé et celles que l’on garde de soi.
Quelques années plus tard, alors que je m’apprêtais définitivement à fétichiser le cinéma, c’est-à-dire à me laisser prendre à son vertige, ce fut à nouveau Tony Curtis, dont les rôles se délitaient dans d’invraisemblables nanars, qui m’en montra l’aspect le plus vain. Ainsi, grâce à un parcours d’acteur entre rôles extrêmement élaborés (le sens du mouvement chez Tony Curtis, la justesse de ses variations de rythme aussi bien dans le pas que la diction, sont largement sous-estimés) et caméos goguenards, le cinéma se révélait peu à peu comme à la fois dérisoire et lumineux, porteur d’un sens secret éparpillé dans la multitude des signes triviaux, emprise et participation inextricablement mêlées.
Tony Curtis est décédé le 29 septembre à l’époque des comédiens compassés et sérieux comme des papes ; il est évident qu’il ne laisse aucun héritier. Dans une scène de Certains l’aiment chaud, l’acteur, allongé de profil, a la jambe repliée tandis que Marilyn Monroe l’embrasse. Il expliqua plus tard que cette position (réclamée à Billy Wilder) lui permettait de dissimuler son érection à la caméra. Tony Curtis, c’était cela sans doute : la sensualité et la retenue également extrêmes, la maîtrise toujours plus ludique, un peu de poussière de Bronx et de Vieille Europe dans les signaux lumineux d’Hollywood ; de quoi désorienter pour longtemps les psychorigides comme les avachis.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !