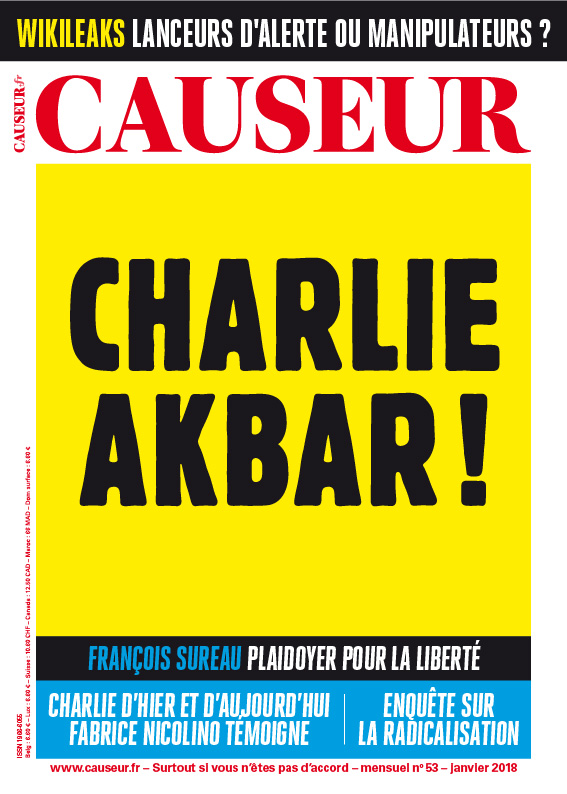Le gouvernement fédéral souhaite faire entrer 450 000 immigrés chaque année dans le pays. L’objectif avoué de Justin Trudeau n’est même plus le multiculturalisme, mais de dissoudre tout ce qui reste du Canada d’hier.
À l’automne 2016, un comité spécial mis en place pour recommander de nouvelles orientations au gouvernement canadien en matière d’immigration a conclu ses travaux avec une proposition surprenante : le Canada devrait tout faire en son pouvoir pour avoir une population de 100 millions de personnes en 2100. Pour cela, le gouvernement canadien devrait faire passer à 450 000 le nombre d’immigrés reçus annuellement. De nombreux commentateurs enthousiastes ont célébré cette proposition, qui permettrait enfin au Canada d’avoir la démographie d’une grande puissance mondiale, et pas seulement d’une superpuissance morale.
A lire aussi: Au Québec, un colloque sur la radicalisation… des islamophobes
Un an plus tard, le gouvernement Trudeau a tranché : s’il se montre plus modéré que ne l’aurait souhaité le comité, il a néanmoins décidé de relever les seuils d’immigration annuelle de 300 000 à 340 000. Un accroissement justifié par des raisons économiques : le Canada aurait de tels besoins en main-d’œuvre qu’il serait obligé de faire fonctionner à plein régime les pompes aspirantes de l’immigration massive. C’est l’argument classique de la mouvance immigrationniste. L’ensemble de la classe politique fédérale se montre favorable à cette hausse systématique des seuils d’immigration : la seule discussion publique autorisée tient à l’ampleur de cette hausse et il est mal vu de ne pas exprimer son adhésion avec ferveur.
Le Canada sera le premier pays authentiquement postnational
Mais quiconque gratte un peu derrière les prétentions à la rationalité économique découvrira aisément des motifs plus profonds, qui se trouvent au cœur de ce qu’on pourrait appeler l’idéologie canadienne. Dans un entretien au New York Times, quelques semaines après son élection en 2015, Justin Trudeau expliquait sa vision du Canada : le Canada serait le premier pays authentiquement postnational, sans noyau identitaire propre ni culture fondatrice. Le Canada serait le laboratoire d’une humanité nouvelle, et peut-être même, de l’homme nouveau : il se fait une fierté de sa vacuité identitaire dans la mesure où il ne contraindrait personne à s’adapter à une culture nationale particulière. Au Canada, nous serions tous des immigrants : telle est la doctrine officielle d’un pays qui a inscrit le multiculturalisme comme principe fondateur dans sa constitution. Les seules nations à pouvoir se dire fondatrices seraient les nations amérindiennes, dont l’installation est antérieure à l’arrivée des Européens. On va même jusqu’à trafiquer l’histoire pour les placer symboliquement au cœur de l’identité canadienne contemporaine.
Les Québécois comme les Canadiens anglais sont victimes d’une forme de déchéance symbolique : ils ne sont plus considérés comme des peuples fondateurs, mais comme des communautés issues de vagues démographiques parmi d’autres (ce qui n’empêche pas le Canada de fonctionner globalement en anglais). Dès lors, les immigrés n’ont pas à prendre le pli identitaire de la société d’accueil – tout simplement parce qu’il n’y a pas de société d’accueil.