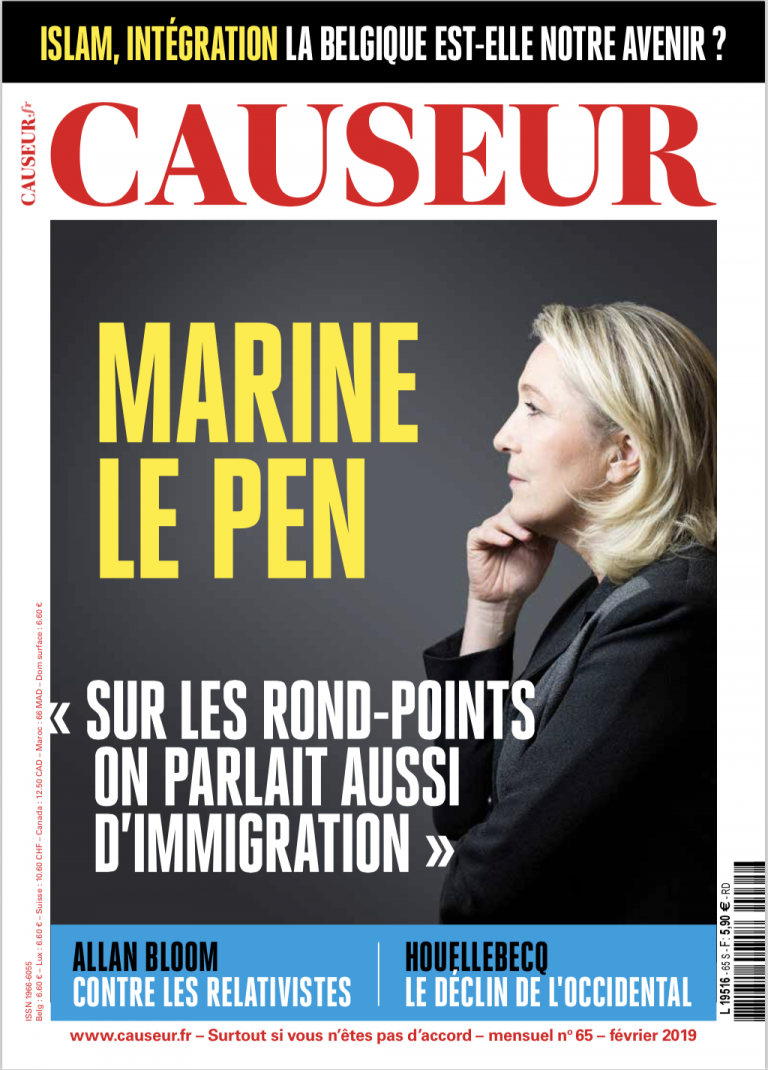Premier secrétaire du PS sous le quinquennat Hollande, Jean-Christophe Cambadélis décrypte la crise de la social-démocratie française et européenne. Prisonnières d’un logiciel idéologique dépassé, les gauches de gouvernement doivent contester l’Europe allemande et inventer un modèle de croissance verte pour renaître.
Causeur. Au plus fort du mouvement des gilets jaunes, vous avez déclaré au Point : « Pour la première fois depuis 1956, la gauche est spectatrice d’un mouvement social populaire. » Que vouliez-vous dire par là ?
Jean-Christophe Cambadélis. Pour la première fois depuis le mouvement poujadiste, la gauche observe et commente un mouvement social sans y participer. Aucun des acteurs – et encore moins des figures de proue – des gilets jaunes ne provient de la gauche. C’est un phénomène tout à fait particulier.
Pardon, mais qu’entendez-vous par « la gauche » ?
Je parle de la gauche des partis et des syndicats. Force est de constater que, parmi les initiateurs, les coordinateurs ou ceux qui sont à la tête des boucles Facebook des gilets jaunes, il n’y a ni syndicalistes ni militants du PS, de la France insoumise ou des organisations d’extrême gauche. Ce sont des gens dont l’histoire personnelle n’a rien à voir avec celle de la gauche.
La gauche vit encore sur des concepts construits dans les années 1960. Elle ne s’est pas renouvelée idéologiquement.
C’était vrai au début du mouvement, mais la stratégie d’entrisme menée par la France insoumise a payé. Aujourd’hui, il y a beaucoup de mélenchonistes assumés dans le mouvement.
Quoi qu’en disent Mélenchon, Coquerel ou Ruffin, la rencontre des Insoumis avec les gilets jaunes n’a pas eu lieu. Du reste, quand on connaît le modus operandi de la gauche, on peut s’étonner qu’il n’y ait pas eu de tentative d’instrumentalisation sur le mode « Touche pas à mon gilet ! »…
Quelle leçon en tirez-vous ?
Si on combine la fragmentation de la gauche, la quasi-disparition de l’offre politique à gauche, les défaites électorales et son absence dans le mouvement des gilets jaunes, on arrive à zéro ! Cette gauche est hors-jeu.
Pourquoi ?
La gauche vit encore sur des concepts construits dans les années 1960. Elle ne s’est pas renouvelée idéologiquement. Concrètement, le courant progressiste défend l’extension continue des libertés et les dividendes de l’État providence. Or, ces deux thématiques sont durement questionnées par le monde contemporain. L’État providence est mis à mal par la mondialisation, et ses acquis sont remis en cause. L’extension de l’individualisme et des droits se heurte à une forte demande de protection venant de la société, aussi l’aspiration à plus de liberté des années 1960 et 1970 est-elle aujourd’hui marginale. Résultat, la gauche vit dans la mélancolie et la nostalgie : la gauche réformiste dans la nostalgie de l’État providence et la gauche radicale dans celle de la décolonisation et de la révolution. Pour finir, en plus de passer son temps à ressasser le passé, la gauche se fractionne !
Cela ne signifie-t-il pas tout simplement que la gauche a accompli sa mission historique ?
La question se pose ! Mais on peut aussi penser que la gauche a aujourd’hui vocation à redéfinir le progressisme dans la société contemporaine.
Vous décrivez un échec, mais vous ne l’expliquez pas. Qu’est-ce qui ne marche plus, le messianisme ?
Comme je l’ai déjà dit, la gauche du XXe siècle s’est refondée sur la défense de l’État providence et des libertés, mais aussi sur un compromis historique entre communistes et gaullistes. Ces compromis autour de l’État jacobin, comme de l’État providence, ont été percutés par la mondialisation et la libéralisation financière. L’État providence est en crise, le jacobinisme source de crises. Quant au messianisme, il a sombré avec la chute de l’Union soviétique et l’extension de l’économie de marché à la Russie, l’Europe centrale et la Chine. Et il