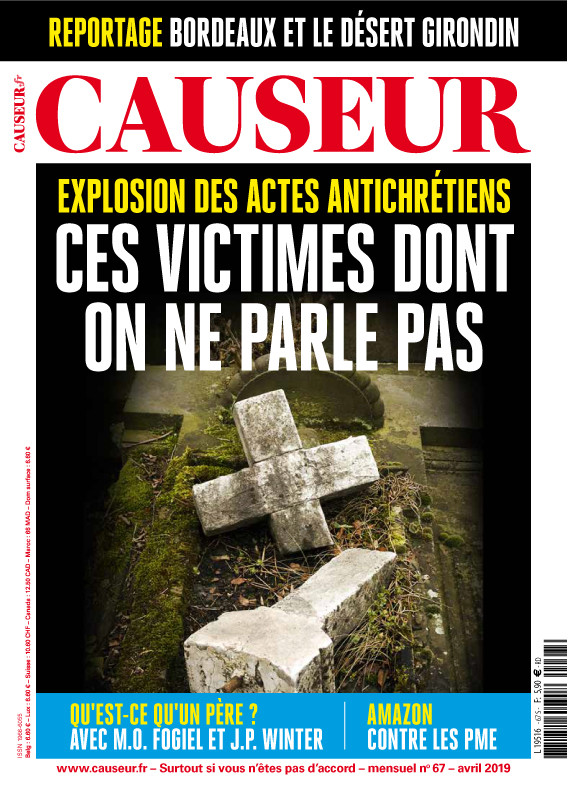En vingt-quatre ans à l’hôtel de ville, Alain Juppé a réveillé, modernisé et embelli Bordeaux. Mais la réussite de cette grande métropole n’entraîne pas le reste du département. Et crée son lot de frustrations, qui ont nourri le mouvement des Gilets jaunes, particulièrement remontés dans la région. Reportage.
Les miracles existent. Au soir du 7 mars, place Pey-Berland, Alain Juppé quitte l’hôtel de ville de Bordeaux sous les vivats après vingt-quatre ans de règne quasi ininterrompu. Jusque dans les rangs de l’opposition municipale, tous saluent l’œuvre accomplie. Même Matthieu Rouveyre, chef du groupe socialiste au conseil municipal, reconnaît « du positif : la revitalisation et l’embellissement de la ville de Bordeaux ». Noël Mamère, ancien vice-président de Bordeaux Métropole et longtemps maire de Bègles (1989-2017), admet que « Juppé a réveillé Bordeaux la belle endormie ». Derrière le poncif, cette vérité a valu trois réélections triomphales (2001, 2008, 2014) au dauphin de Jacques Chirac, récemment nommé au Conseil constitutionnel.
Bordeaux n’est pas qu’un Boboland
Cependant, le successeur de Jacques Chaban-Delmas, « duc d’Aquitaine » qui présida aux destinées de Bordeaux quarante-huit ans durant (1947-1995), laisse une ville moins sereine qu’il n’y paraît. Certes, la capitale de la Nouvelle-Aquitaine brille comme jamais auparavant : centre-ville classé par l’Unesco (2007), croissance au beau fixe tirée par l’explosion du tourisme, arrivée massive de Parisiens attirés par la qualité de vie et la liaison TGV en deux heures depuis la gare Montparnasse… Cette réussite a cependant ses revers : la gentrification tend à faire de Bordeaux une ville-monde pour cadres dynamiques aujourd’hui caricaturée en Boboland alors que 17 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Chaque samedi, des manifestations de gilets jaunes particulièrement virulentes rappellent aux Bordelais la fragilité de leurs périphéries, la Gironde restant l’un des départements les plus pauvres de France. Comme le confirme une note de l’IFOP, « les témoignages recueillis par la presse locale comme le profil des individus interpellés lors des différents actes confirment que les cortèges étaient très massivement composés de non-Bordelais » souvent issus du croissant de la pauvreté aquitain de la pointe du Médoc au Lot-et-Garonne.
« Le centre était noir. Bordeaux faisait penser aux villes du nord de l’Angleterre »
Hier encore ville bourgeoise éteinte, comment Bordeaux s’est-elle transformée en l’espace de vingt ans ? Ancien adjoint à l’environnement de Chaban, membre fondateur des Verts passé avec armes et bagages dans l’entourage de Juppé, l’élu métropolitain Michel Duchène se souvient : « Le centre était noir. Bordeaux faisait penser aux villes du nord de l’Angleterre, avec de très nombreux bâtiments inoccupés et commerces vacants. Les grands espaces publics étaient occupés par la voiture ». Résultat : entre 1954 et 2002, Bordeaux a perdu 80 000 habitants, les plus aisés investissant échoppes ou maisons cossues en périphérie. Pour stopper l’hémorragie, Duchène s’est inspiré d’un précédent américain : Portland. Dès la fin des années 1970, la capitale économique de l’Oregon a rompu avec l’urbanisme des Trente Glorieuses pour engager un virage écolo : requalification des quais désertés par le départ du port, ouverture des rives aux vélos et aux piétons, introduction d’un tramway. On croirait lire l’histoire récente de Bordeaux, dont l’ouverture des quais de la Garonne à la population a été une première « vélorution », comme diraient les Verts parisiens. Au plus fort des années Chaban, les quais de la Garonne ressemblaient à une autoroute urbaine, avec dix voies de circulation laissées aux voitures. Aujourd’hui, piétons, rollers, vélos et trottinettes électriques y circulent à leur guise tandis que les autos sont reléguées sur deux voies et une contre-allée. Du Delanoë avant Delanoë. En beaucoup plus ambitieux et abouti. Les friches qu’a entraînées le transfert des principales activités portuaires vers Le Verdon, à l’embouchure de la Gironde (1976) ont permis à Juppé de remettre la Garonne au centre de la vie citadine.
Hidalgo en rêve, Juppé l’a fait !
Chronologiquement, le second pilier de la politique