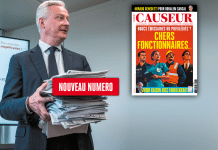L’augmentation phénoménale des diagnostics accrédite la thèse selon laquelle la « dysphorie de genre » serait « socialement transmissible » par contagion entre pairs, un peu comme l’anorexie. Gil Mihaely, directeur de la publication, fait le point sur les connaissances, alors que Causeur publie un grand dossier « génération trans, sauvez les enfants » mercredi 4 mai prochain.
Aux États-Unis, mais aussi en France, les demandes de changement de sexe chez les adolescents augmentent depuis plus d’une décennie. Ces demandes sont l’expression d’une véritable pandémie qui sévit au collège et au lycée : un nombre croissant de jeunes, dans la très grande majorité des adolescentes, se disent nés dans le « mauvais corps ». Et la communauté éducationnelle et thérapeutique, les professionnels de l’Éducation nationale et de la santé cautionnent de plus en plus souvent ces expressions par un diagnostic de « dysphorie de genre ». Ainsi, des changements de comportement et de discours parfois aussi rapides que certaines radicalisations et passages à l’acte, se voient légitimés, voire encouragés, poussant d’autres à se lancer dans cette voie. Après l’ouvrage de Claude Habib, deux livres sur le sujet [1] viennent de paraître en France à quelques jours d’intervalle, une « salve éditoriale » qui témoigne de la gravité du phénomène.
Une solution magique aux problèmes des adolescents
Ces ouvrages rédigés par des professionnels (Melman et Lebrun sont psychiatres et psychanalystes, Eliacheff est pédopsychiatre et psychanalyste et Céline Masson est psychologue) sont différents et complémentaires. Eliacheff et Masson dénoncent, au nom de la protection de l’enfant, un « droit à l’autodétermination identitaire » de mineurs et avancent que souvent ces manifestations occultent des problèmes authentiques chez les adolescents en leur proposant des solutions magiques.
Quant à Melman et Lebrun, ils dialoguent à propos de Petite fille (2020), un film de Sébastien Lifshitz diffusé par Arte en décembre 2020 qui relate la vie de Sasha, élève de CE1 qui, selon sa mère, « se sent » fille dans un corps de garçon.
A lire aussi: “Petite Fille”, grand malaise
Ces travaux ont été précédés par l’enquête de la journaliste américaine Abigail Shrier parue en juin 2020 sous le titre Irreversible Damage:The Transgender Craze Seducing Our Daughters (« Dommage irréversible : comment la folie transgenre séduit nos filles »), qui n’a pas encore été traduit en français. Shrier, qui n’est ni psychologue ni éducatrice, dresse le tableau d’un phénomène très large dont les véritables ressorts sont plutôt culturels, idéologiques et politiques que psychiques.
La dysphorie de genre, connue auparavant sous le nom de « trouble de l’identité sexuelle », a une longue histoire. Selon le « Manuel diagnostique et statistique » (DSM) de l’Association américaine de psychiatrie (APA), son incidence se situe entre 0,005 et 0,014% chez les hommes nés aux États-Unis. Elle est nettement moins fréquente chez les femmes (0,002 % – 0,003). Jusqu’à 2013, ce phénomène a été nommé par la communauté professionnelle « Gender Identity Disorder » (GID) ou trouble de l’identité de genre (TIG). C’est seulement dans l’édition 2013 du DSM, que le GID, qu’on appelait aussi « transsexualisme » puis « incongruence de genre », est devenu « gender dysphoria » – « dysphorie de genre », un terme considéré par la communauté professionnelle comme non stigmatisant. L’APA énumère huit symptômes, dont au moins six doivent être présents, pour pouvoir diagnostiquer la dysphorie de genre. Dans leur majorité ils sont facilement observables dès la prime enfance : une préférence pour le travestissement et les jeux de rôle entre les sexes, et une forte aversion pour son anatomie sexuelle. Aujourd’hui pour les psychologues américains il s’agit de la détresse d’une personne face à un sentiment d’inadéquation entre son sexe assigné et son identité de genre. Pour l’APA, « la non-conformité de genre n’est pas en elle-même un trouble mental. C’est la souffrance associée qui est l’objet clinique ».
Un diagnostic en augmentation de plus de 1000% sur une quinzaine d’années!
Le phénomène existe donc bel et bien mais, avant les années 2010, il est rarissime, très majoritairement masculin et ne suscite pas beaucoup d’intérêt. Et puis, au tournant de la décennie, les diagnostics se multiplient et la grande majorité des cas concerne des adolescentes. Dans un entretien publié par FigaroVox le 13 février, Caroline Eliacheff parle d’une « croissance exponentielle des demandes de changement de sexe d’enfants et d’adolescents » et d’un corps médical qui suit le mouvement. Selon elle, dans différents pays « sur une période de dix à quinze ans, le diagnostic de “dysphorie de genre”, qui traduit un sentiment d’inadéquation entre le sexe de naissance et le “ressenti”, a augmenté de 1 000 à 4 000 % ».
Cependant, peu de chercheurs et d’intellectuels sont prêts à s’exprimer par peur d’être qualifiés de transphobes. Pour un universitaire américain, une telle accusation équivaut aujourd’hui à un arrêt de mort professionnel assorti du risque de voir ses publications retirées des revues scientifiques. C’est le cas de Lisa Littman. Abondamment citée dans le livre d’Abigail Shrier, cette chercheuse en santé publique à l’université Brown, dans le Rhode Island, a analysé 256 cas de dysphorie de genre. Les résultats sont surprenants. Les transitions femme-homme représentent 80% des cas et l’âge moyen des jeunes concernés est de 15 ans. Significativement, très peu de ces jeunes avaient montré des signes précoces, pré-pubertaires, de malaise par rapport à leur corps. Autrement dit, le phénomène actuel est clairement en rupture par rapport au syndrome décrit par l’APA. Pour Littman, il s’agit d’une dysphorie de genre « socialement transmissible » par contagion entre pairs.
Shrier consolide cette intuition par une approche sociologique et plus de 200 entretiens avec des parents, des adolescentes, des professionnels et des « influenceurs ». Elle parle aussi avec des transgenres « à l’ancienne », c’est-à-dire des adultes qui ont souffert d’une dysphorie de genre dont les symptômes ont été discernables clairement et précocement pendant l’enfance, bien avant les tourments habituels de l’adolescence.
A lire aussi: Debbie Hayton: trans d’un autre genre
Elle pointe également les similitudes entre la mode transgenre et la multiplication des cas d’anorexie chez les adolescentes il y a quelques décennies. Ce phénomène a suscité un très grand intérêt médiatique à partir de la fin des années 1970. Bien que les faits médicaux de l’anorexie mentale soient documentés depuis les années 1870, la sensibilisation du public à cette affection était très limitée avant la publication, en 1978, de The Golden Cage: The Enigma of Anorexia Nervosa, livre dela psychologue américaine Hilde Bruch, devenu un best-seller. Quelques années plus tard, la mort à 32 ans de la célèbre chanteuse américaine Karen Carpenter, attribuée à l’anorexie mentale (anorexia nervosa), fait sensation. Dans la foulée, des célébrités comme Jane Fonda font part de leur expérience de troubles de l’alimentation et le sujet est repris par les médias (notamment « people », « féminin » et « santé »). Et comme, dans les mêmes décennies (années 1970-1980), la mode des régimes alimentaires – et le discours qui va avec – a conquis un très grand nombre d’adolescentes, l’anorexie (qui commence toujours par la phase simple « régime »), jadis un phénomène rare et méconnu, devient presque une banalité. On peut donc avancer que, même si l’anorexie existait au moins depuis le Moyen Âge (voir Holy Anorexia, de Rudolph M. Bell), la révolution culturelle des années 1960 portée et subie par la génération baby-boom lui a donné une nouvelle dimension à la fois sociale et psychologique. Un petit demi-siècle plus tard, démontre Shrier, l’essor des médias sociaux, l’omniprésence des téléphones portables et les parents protecteurs sont autant de facteurs d’une nouvelle contagion sociopsychique, toujours liée à des angoisses autour de l’image du corps chez les adolescentes ; et c’est encore le refus des jeunes femmes et des filles de devenir « grande » (adulte) et femme, mais cette fois-ci il ne s’agit pas de rester petite, asexuée et d’éviter la menstruation, mais carrément de changer de genre.
Les dangers de l’autodiagnostic et du conformisme
Mieux encore : selon Shrier, contrairement à l’anorexie, le transgenre est la seule catégorie de victime à laquelle les adolescentes blanches issues de milieux favorisés peuvent facilement accéder sur la foi de leur propre parole. Dans un contexte général allant de la cour de récréation à la pub pour McDonald’s en passant par le cinéma et les séries, les adolescents des deux sexes sont encouragés à « briser le moule », « être différent » et en « accord avec soi-même », envers et contre tous. Et comme souvent, cette nouvelle forme de non-conformisme est terriblement conformiste : selon l’étude de Littman, 70% des adolescentes diagnostiquées comme dysphoriques avaient au moins un cas de coming out transgenre dans leur cercle d’amis et de camarades d’école.

Cependant, pour que cette pandémie se déclenche, il a fallu des complices. Les professionnels – essentiellement les psychologues – étaient nombreux à légitimer plutôt qu’à remettre en question l’autodiagnostic des adolescentes. Les professionnels ont abdiqué leur responsabilité en matière de diagnostic. Phénomène étrange quand on sait que les très fréquentes formes d’anxiété chez les adolescents ont rarement une explication unique et une solution aussi simple. En plus, des adolescents se questionnent fréquemment sur leur identité et orientation sexuelle et pourraient donc se montrer « fluided »… Or, il arrive qu’on conseille à des parents d’accepter l’autodiagnostic de leur fille ou d’employer un nouveau prénom masculin qu’elle a choisi pour éviter de la pousser au suicide…
Certes, il y a toujours eu des transgenres, extrêmement minoritaires, mais faut-il pour autant croire et faire croire à des enfants que leurs doutes sont des choix légitimes et que l’anatomie ne serait qu’un détail, presque aussi anodin qu’une « imperfection » esthétique qu’on « corrige » par chirurgie esthétique ?
Selon Masson et Eliacheff, plus de la moitié de ceux qui souhaitent changer de sexe présentent des difficultés psychologiques antérieures ou vivent au sein de familles dysfonctionnelles. Pourtant « l’enfant-moi » se voit octroyer par des adultes désemparés, apeurés et complètement dépassés le pouvoir de choisir son sexe en fonction de ses ressentis. Il devient maître chez lui, empêchant ainsi la possibilité de traiter ses véritables problèmes.
A lire aussi: Les réflexions de Claude Habib sur la question trans
Comment expliquer le comportement collectif d’un corps professionnel qui se plie si rapidement à une mode aux conséquences aussi graves ? En effet, certains vont désormais jusqu’à prescrire des bloqueurs de puberté à des enfants dont le besoin est loin d’être établi et certain.
Le principal responsable en est probablement le climat intellectuel régnant dans les milieux faisant office de cadres et références moraux, scientifiques et sociaux pour les psychologues : les universités (chez les enseignants et les étudiants), la presse et les mouvements politiques progressistes radicaux. Ces derniers jouent un rôle particulièrement néfaste. Comme l’explique Eliacheff à FigaroVox, « les activistes LGBT ont inventé une novlangue qui fragmente la société en établissant des typologies : cis, trans, non binaire, etc. Au nom de la lutte nécessaire contre les discriminations, ils veulent aussi nous imposer l’idée que le sexe est “assigné”, qu’on peut en changer dès le plus jeune âge en fonction de son ressenti. » Par un lobbying efficace, ces idées et notions se répandent comme les particules de plastiques dans les océans – on les rencontre dans les cours d’éducation sexuelle délivrés par des associations agréées par l’Éducation nationale ainsi que dans des publications éditées par le Planning familial.
Dans tous ces lieux et milieux, le transgenre est devenu une arme politique entre les mains d’une gauche radicale aveuglée par son obsession d’inverser les rôles de l’oppresseur et de l’opprimé. Les féministes des années 1960-1970 et les héritières de leurs combats se retrouvent aujourd’hui dépourvues de leur autorité morale et de leur légitimité intellectuelle. Dans ce cadre, la pandémie de dysphorie de genre, est une vaste usine à fabriquer des opprimés imaginaires qui deviennent de véritables militants dans un combat politique bien réel.
>> Ne manquez pas notre dossier « Génération trans, sauvez les enfants », mercredi prochain chez votre marchand de journaux, et dès mardi sur le site <<
La dysphorie de genre: A quoi se tenir pour ne pas glisser ?
Price: 12,00 €
12 used & new available from 12,00 €
[1] Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun, La Dysphorie de genre : À quoi se tenir pour ne pas glisser ?, ERES, 2022 ; Caroline Eliacheff et Céline Masson, La Fabrique de l’enfant transgenre, L’Observatoire, 2022.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !