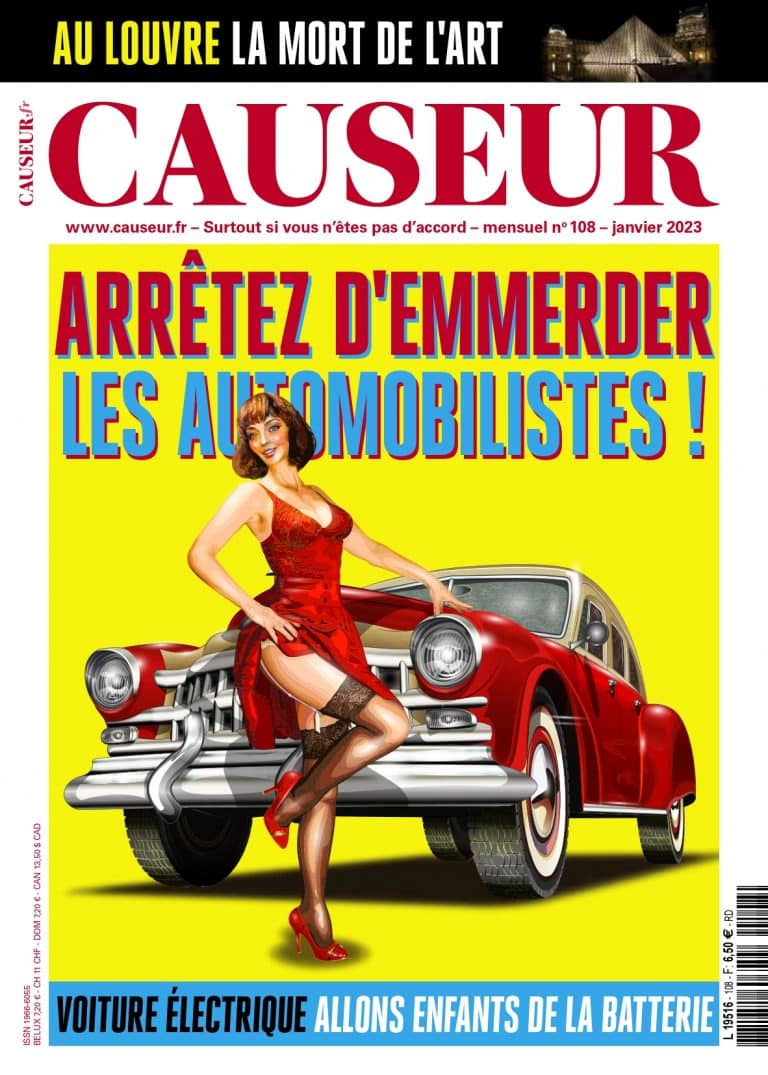La rééducation mentale menée par les woke bénéficie de la complicité de nos plus grands musées. Face aux maîtres anciens, il faut désormais parler féminisme, colonisation et écocide. Preuve au Louvre, avec l’exposition « Les choses. Une histoire de la nature morte », qui se souciait plus d’accuser l’homme de crime contre la nature que de faire honneur aux chefs-d’œuvre qu’elle présentait.
« Les choses : une histoire de la nature morte » : c’est le titre de l’exposition (heureusement) temporaire que le Musée du Louvre propose depuis le 12 octobre à un public enthousiaste à l’idée de retrouver la vie silencieuse des fleurs, fruits, pêche, chasse