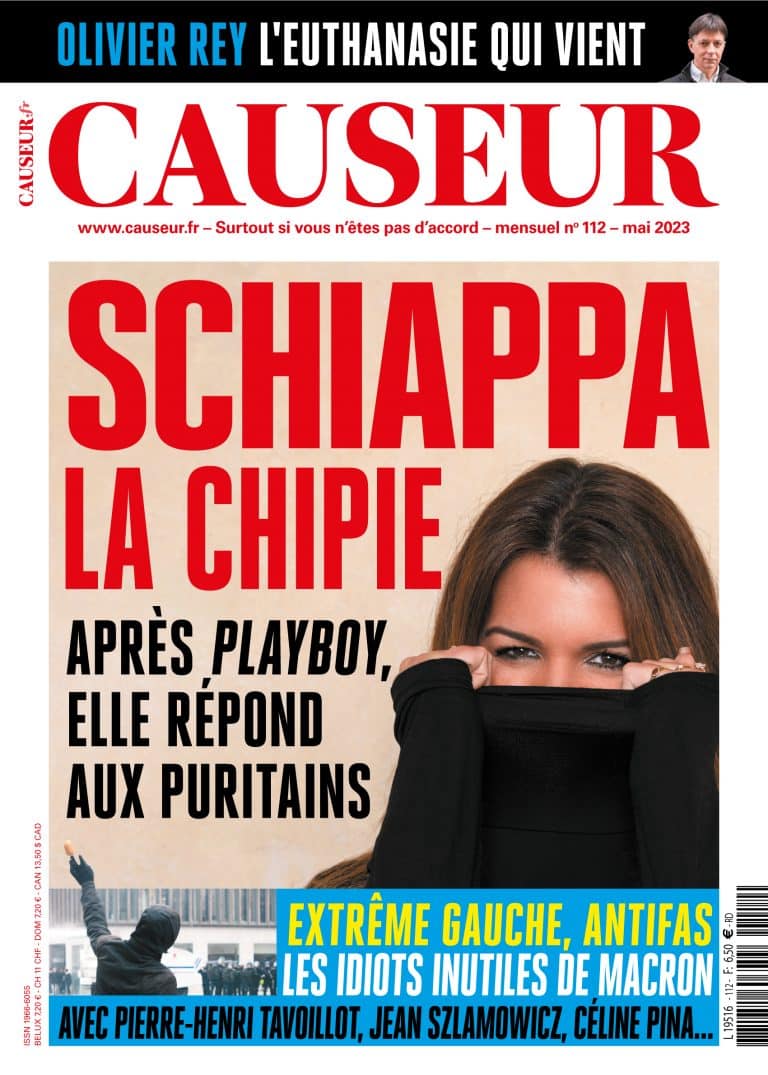L’éditorial de mai d’Elisabeth Lévy
Il est trop fort le président. Pour tourner la page de la réforme des retraites, il a sorti de son chapeau une idée folle que personne n’avait eue (à l’exception de tous ses prédécesseurs) : réformer l’Éducation nationale. Cette ambition occupe une place de choix dans la liste de promesses que Papa Macron nous a faites pour nous prouver qu’il nous aime. Calmez-vous et buvez frais : l’avenir radieux, c’est maintenant. Enfin dans 100 jours. La Justice aura des moyens, mille usines s’épanouiront, la bureaucratie s’allégera. On inventera l’industrie écolo et l’IA qui rase gratis. Et donc, dès la rentrée, l’École aura changé de visage.
Cette annonce aurait pu réjouir ceux qui, comme votre servante, enragent que les Français se roulent par terre pour leur retraite, mais laissent leur École aller à vau-l’eau depuis des décennies, bercés par les illusions rassurantes du taux de réussite au bac – comme si le bac avait encore le moindre sens – et du solide pourcentage de jeunes qui vont glander dans des facs-poubelles. Évidemment, il y a une entourloupe. La pierre angulaire de cette grande réforme, c’est de mieux payer les profs. D’accord, c’est indispensable : selon une estimation consensuelle, depuis les années 1980, leur traitement aurait chuté