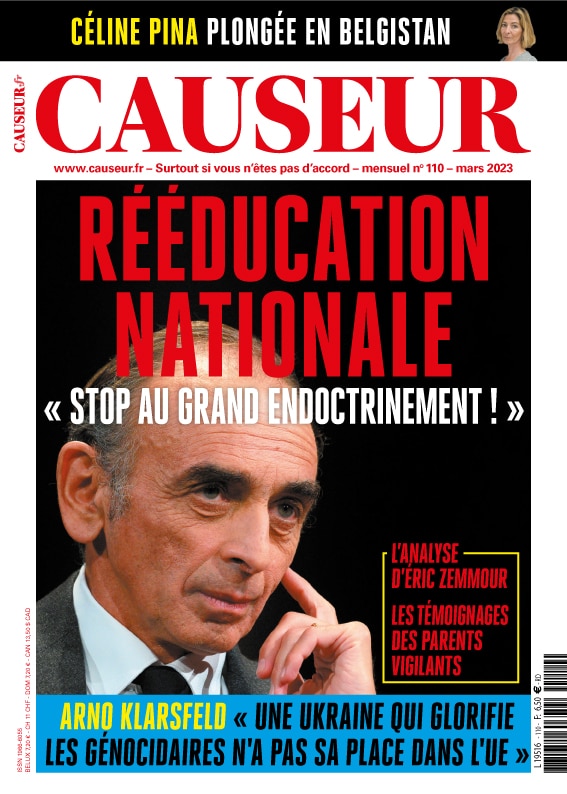La renommée d’Ambroise Thomas s’est éteinte avec lui en 1896. Ce compositeur a pourtant été une figure emblématique de la seconde moitié du XIXe siècle, un artiste adulé par ses pairs les plus illustres et un créateur plébiscité par le grand public. La postérité lui offre un hommage tardif.
Les exégètes se refilent la boutade de Chabrier : « Il y a deux espèces de musique, la bonne et la mauvaise. Et puis il y a la musique d’Ambroise Thomas. » Étrange destin que celui de ce compositeur adulé en son temps comme LA figure majeure de l’art musical français avant d’être effacé, sitôt mort, du panthéon de nos gloires. Qui se souvient encore de cet homme dont Théophile Gautier disait que « personne ne manie l’orchestre avec autant d’élégance et de sûreté », dont Berlioz vantait la patte « alerte, piquante, toujours distinguée, écrite partout avec goût et savoir », et dont Massenet a prononcé l’éloge funèbre lors des obsèques nationales que la République lui a réservées en 1896 !
Dès le seuil de la Belle Époque, Thomas glisse dans l’oubli. Le XXe siècle juge son langage musical conformiste, passé de mode, académique, et il faut attendre le tournant du millénaire pour commencer à rendre justice à cet infatigable créateur lyrique. C’est un curieux bonhomme : les élèves du conservatoire surnomment leur directeur « M. de