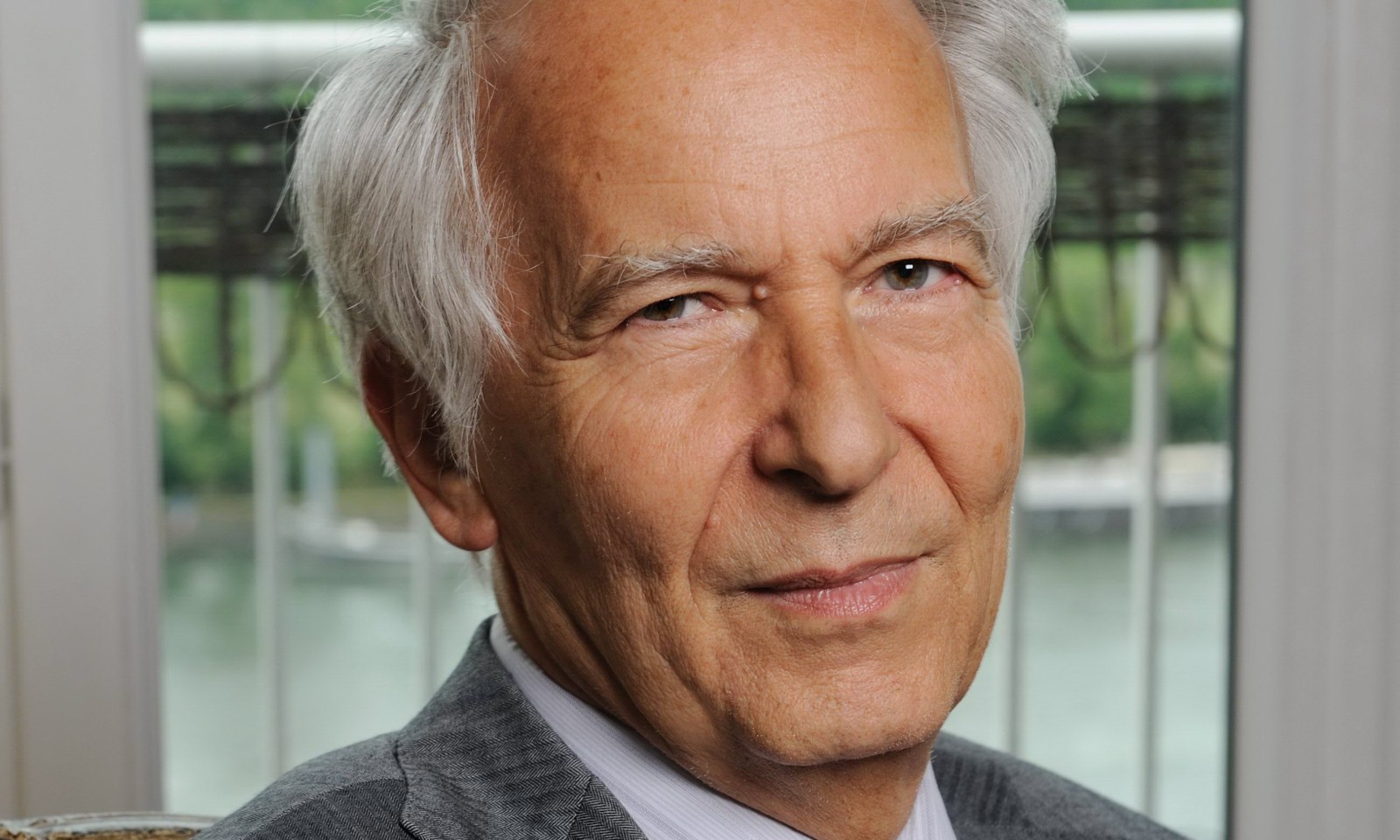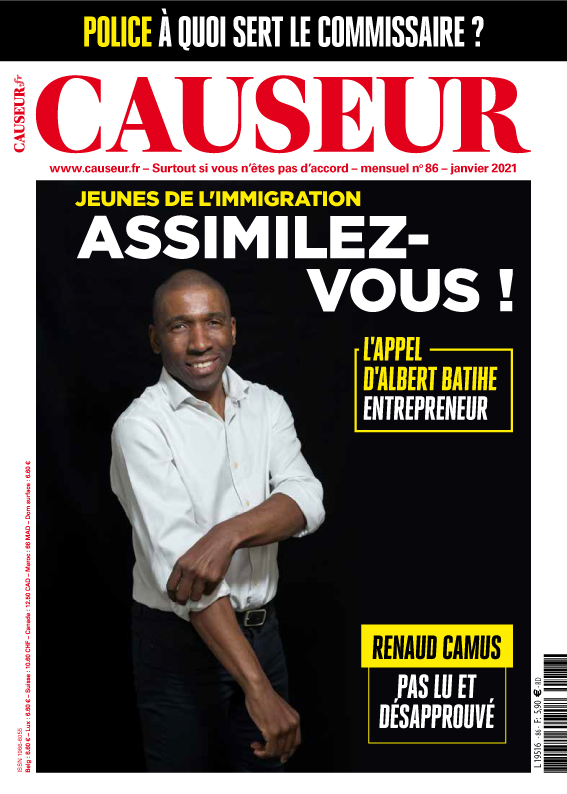Accepter la République et ses lois écrites fait de vous un citoyen. Mais apprendre les codes non écrits d’un peuple et y adhérer transforme les citoyens en membres d’une nation et en héritiers de plein droit du passé du peuple qu’ils rejoignent.
L’idée d’assimilation n’a pas bonne presse dans une époque qui valorise par-dessus tout le droit de chacun à suivre sa propre voie et, s’il est migrant, à cultiver ce qui le relie à sa société d’origine. Le sens même de la notion est mis en question dans des sociétés marquées par une grande diversité de choix de vie. Auxquels de ses membres, objecte-t-on, faudrait-il ressembler pour être déclaré « assimilé » ? En réalité, cette objection fait bon marché du fait que la diversité d’une société n’est pas infinie.
À lire aussi, Élisabeth Lévy: L’assimilation: une dernière chance pour la France
Trois manières de prendre place dans une société d’accueil
L’existence d’institutions communes, de lois communes, souvent d’une langue commune, d’éléments de mémoire largement partagés au sein d’une communauté nationale (la Révolution française, la guerre de Sécession), fait qu’en dépit de sa diversité interne, chaque société a quelque chose d’unique. Ainsi, selon les pays, l’encadrement des conduites de chacun est assuré d’une manière particulière, que ce soit par un pouvoir fort comme en Chine, par la pression sociale comme au Japon, ou par la loi comme en Europe occidentale. Les modalités permettant à des groupes qui vivent différemment de coexister de manière relativement pacifique divergent selon les sociétés : dans certains cas, comme aux États-Unis, les groupes vivent largement dans des lieux distincts ; dans les sociétés de castes, les rapports entre groupes sont minutieusement codifiés. L’existence d’une identité commune joue un rôle important quand il s’agit pour une nation d’agir en corps, comme en guerre. Tout ce patrimoine peut donner l’impression d’aller de soi pour ceux qui l’ont reçu en héritage dès leur plus jeune âge, mais peut paraître étrange à ceux qui viennent d’ailleurs.
Pour les nouveaux venus, trois grandes manières de prendre place là où ils jettent l’ancre sont possibles.
Une attitude courante consiste à se soumettre aux lois du pays d’accueil tout en continuant autant que possible, dans les domaines que ces lois ne régissent pas, à maintenir les traditions de sa société d’origine au sein d’une diaspora. Les liens avec cette société, notamment ses médias, restent privilégiés, l’endogamie est forte ainsi que la sociabilité intracommunautaire. On a alors une simple intégration.