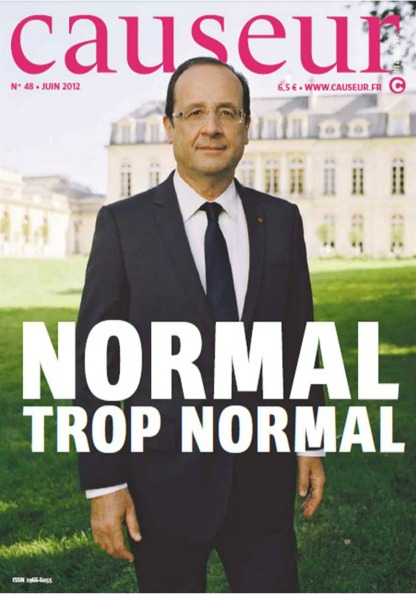Malek Boutih a souvent raison. Interrogé le 4 juin, sur France Inter, il affirme que, depuis plus de dix ans, certains jeunes Français n’ont pas attendu Mohamed Merah pour exprimer bruyamment leur antisémitisme. Il se trompe pourtant quand il estime qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre les meurtres commis par Merah et l’augmentation des actes antisémites observée depuis. L’histoire, notamment celle du XXe siècle, prouve que la violence ne guérit pas de la violence mais qu’elle la banalise, créant un habitus, une atmosphère propice à son explosion ou, à tout le moins, à son expansion.[access capability= »lire_inedits »] Cette violence a pour conséquence première de réifier ceux qu’elle frappe et de réduire tous les membres du groupe auquel elles appartiennent ou sont soupçonnées d’appartenir, à l’état de victimes potentielles, comme le montrent par exemple les travaux de l’historien américain Jan Gross sur la Pologne d’après-guerre. Cibles elles ont été, cibles elles demeurent : dans l’esprit des assassins, leur vie ne vaut rien, on en a pris l’habitude, on peut en disposer.
De fait, les agressions antisémites de Marseille, le 26 mai[1. Le 26 mai, à Marseille, un jeune homme de 17 ans portant la kippa, accompagné de sa sœur et de son beau-frère, est pris à partie par quatre individus qui tiennent les propos suivants : « C’est shabbat chez vous, vive Mohamed Merah, n… les juifs…Palestine vaincra ! » Il reçoit des coups, tente de les rendre, et s’en tire avec une blessure au genou (ligaments croisés sectionnés). Son beau-frère, voulant s’interposer, a également reçu un coup de poing.], de Villeurbanne, le 3 juin, et de nombreux témoignages révèlent bien que, dans une partie de la jeunesse, l’équipée sanglante de Merah, loin de susciter une condamnation unanime, a ouvert le champ des sinistres possibles.
Or, à discuter avec les uns et à entendre les autres, on comprend clairement que ce constat ne fait pas consensus, beaucoup refusant avec constance de voir le caractère antisémite des agressions. On pense à l’assassinat du jeune Ilan Halimi, dont certains s’obstinaient à faire un crime crapuleux ou, plus récemment, aux propos de l’historien Dominique Borne, président de l’Institut européen en sciences des religions: « Il faut mesurer ce qu’on appelle antisémitisme. Je ne dis pas qu’il n’y en a pas chez les élèves : on s’en inquiète depuis le déclenchement de la deuxième Intifada. Mais l’Éducation nationale n’a pas diligenté d’enquête pour cerner, scientifiquement, l’étendue du phénomène. »[2. « À l’école, les difficiles échos de l’affaire Merah », Mattea Battaglia, Le Monde, 21 avril 2012.] Parler de « ce qu’on appelle antisémitisme », revient à affirmer qu’il ne s’agit pas vraiment d’antisémitisme. Et dire qu’on ne dit pas « qu’il n’y en a pas chez les élèves, mais… » signifie, selon la bonne vieille technique de l’antiphrase, qu’on ne croit pas qu’il y en ait.
Il faut en conclure que la haine des juifs et la volonté de leur nuire ne suffisent pas à qualifier l’antisémitisme. Il faut, en outre, que le coupable soit un homme blanc (ou une femme). Des jeunes d’origine maghrébine comme Merah, ou d’Afrique subsaharienne comme Youssouf Fofana, ne correspondent pas à la définition de l’antisémite idéal. Après les assassinats de Toulouse et de Montauban, on rêvait de découvrir un Breivik français, et ce fut Merah. Ça ne collait pas !
Pour surprenante ou choquante qu’elle soit, cette vision des choses ne laisse pas d’être éclairante. Tout d’abord, elle est fondée sur une fâcheuse ignorance des ressorts psychologiques, intellectuels et historiques de l’antisémitisme, qu’on finit par considérer seulement comme − et que comme − le produit de la bêtise. Il ne viendrait pourtant à personne l’idée de nier que les SA fous de haine de novembre 1938, quoiqu’idiots, étaient ivres d’idéologie. Par ailleurs, elle révèle la faible estime que certains portent aux jeunes de banlieue qu’ils accablent de leur compassion : pour eux, les assassins d’Ilan Halimi et des enfants de l’école Ozar-Hatorah ne sont que des voyous abrutis, incapables de la moindre pensée.
Quand on ne veut pas voir l’antisémitisme, on ne peut pas l’analyser et encore moins le combattre. Les organisateurs d’un « débat citoyen » qui s’est tenu à La Courneuve dans le cadre de la campagne législative3 ont posé aux candidats cinq questions qu’ils estimaient « fondamentales pour les quartiers populaires ». Dans l’ordre : l’éducation, le logement, la laïcité et la crainte de voir monter le risque de l’islamophobie, l’emploi et… le conflit israélo-palestinien ! Quand les femmes sont méprisées, les homosexuels contraints de se cacher et que les juifs ont quitté ces quartiers (500 familles juives à Saint-Denis il y a dix-huit ans, 40 aujourd’hui…), la seule menace digne d’intérêt est la montée de l’ « islamophobie ». Bien entendu, la journaliste du Monde qui rend compte de la réunion ne s’interroge pas un instant sur le fait que le conflit israélo-palestinien soit considéré comme « fondamental » pour « les quartiers populaires » dans le cadre des élections législatives françaises. Ne voit-elle pas que poser cette question, c’est encourager une vision communautaire de la politique et, au-delà, de la société tout entière ?
Le message adressé aux candidats présents, notamment Marie-George Buffet, est limpide: « Soutenez la lutte du peuple palestinien et nous voterons pour vous. » Cela devrait questionner, et même déranger. Que le conflit israélo-palestinien soit un sujet important et légitime, nul n’en disconviendra, mais pourquoi doit-il être abordé ici et maintenant ? Pourquoi ce conflit-là et pas la Syrie ou le Tibet ? Parce que les ennemis des Palestiniens sont juifs ? Cette obsession moyen-orientale, qui nourrit confusions et amalgames, ne peut qu’aggraver la haine des juifs, où qu’ils se trouvent.
Heureusement, on connaît la solution, le remède imparable qui soignera les esprits malades et les âmes égarées : le voyage à Auschwitz, que préconise, entre autres, Ariel Goldmann, vice-président du CRIF[4. Ariel Goldmann (vice-président du CRIF): « Après l’affaire Merah, il y a eu un pic d’actes antisémites », propos recueillis par Stéphanie Le Bars, Le Monde, 6 juin 2012.]. Si je voulais être atrocement provocateur, je signalerais qu’Himmler y est allé plusieurs fois, qu’il y a même assisté à un gazage homicide et qu’à ma connaissance, cela ne l’a nullement « guéri » de son antisémitisme. On portera cette remarque au compte de l’exagération. Mais qu’on me permette de douter du pouvoir thérapeutique d’Auschwitz − que l’expérience récente incite à relativiser fortement.
Passons sur la niaiserie, martelée sous diverses formes, consistant à expliquer aux élèves que juifs et musulmans, compagnons d’immigration, sont issus de la même histoire. Ceux que l’histoire intéresse plus que les rassurantes mythologies se reporteront utilement au livre de Georges Bensoussan, Juifs en pays arabes. Le grand déracinement, qui vient de paraître chez Tallandier. Ariel Goldmann évoque une autre piste consistant à imposer à l’auteur d’un acte antisémite « un travail d’intérêt général autour du thème de la Shoah ». Quand l’enseignement de la Shoah devient une sanction… Faut-il faire pleurer sur les juifs morts pour que les juifs vivants aient le droit de vivre tranquillement ?
En réalité, les seules armes efficaces pour lutter contre la résurgence de ce vieux fléau sont l’histoire et la raison, pas le pathos et l’apitoiement, dont le seul résultat est de susciter une morbide concurrence victimaire. Par définition, la victime exclut. Alors, osons le dire : la Shoah est beaucoup trop présente dans les discours publics, car ce n’est pas d’histoire qu’il s’agit, mais d’une mémoire exaltée et émotionnelle.
Sur France Inter, Malek Boutih a défini deux axes de travail : une fermeté politique sans faille et l’éducation. S’agissant du premier, il faudra beaucoup de courage tant l’antisémitisme est devenu une évidence pour une partie, minoritaire (en tout cas souhaitons-le), mais non négligeable de la jeunesse française. S’agissant du second, les déclarations d’intention ne suffisent plus. Pour que l’École soit le formidable outil qu’elle devrait être, il faut que les professeurs soient formés de façon à être capables de répondre à la seule question qui vaille : pourquoi les juifs ? Cela suppose de pénétrer dans l’univers mental des bourreaux, pour comprendre ce qui les animait et l’histoire longue dont ils étaient issus. Cela aurait peut-être permis à beaucoup de comprendre pourquoi Merah, en assassinant froidement les enfants juifs, croyait tuer ses ennemis. La tâche à accomplir est gigantesque, car elle consiste à remettre en cause trente ans de religion civile de la mémoire[5. Georges Bensoussan, Histoire, mémoire et commémoration. Vers une religion civile. Le Débat n°82, 1994.].[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !