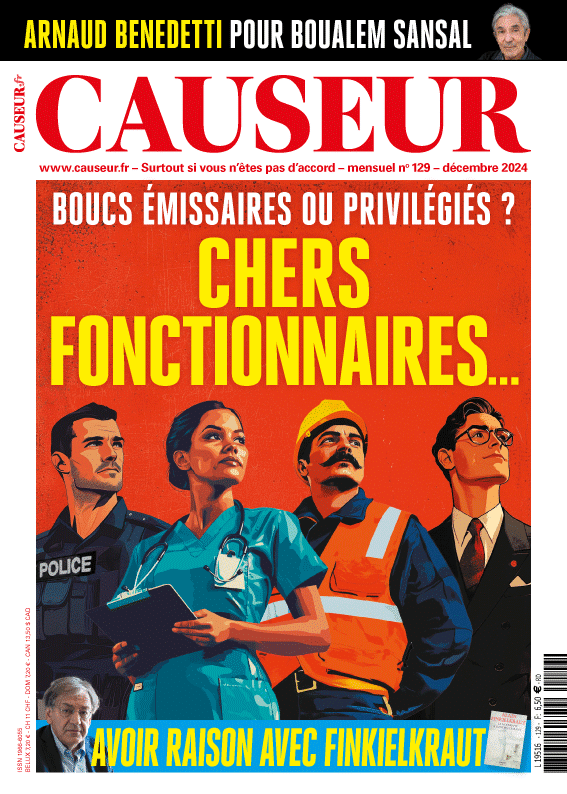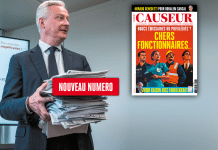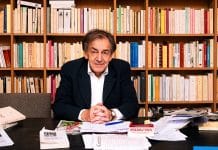La collection « Bouquins » publie un épais volume de textes et d’entretiens d’Alain Finkielkraut. Ils démontrent la sûreté et la précocité de son jugement politique, ainsi que sa capacité à se frotter à ses contradicteurs. Ce défenseur de l’identité et de la nation se double d’un grand styliste, et d’un ami véritable.
La collection Bouquins a eu l’excellente idée de réunir, dans un volume de plus de 1000 pages, une série de livres et d’articles d’Alain Finkielkraut dont la publication s’échelonne de 1996 à 2023 : de L’Humanité perdue, un cours donné jadis à l’École polytechnique, jusqu’à des articles signés l’an dernier qui traitent du 7-Octobre ou de la dévaluation de la parole d’Emmanuel Macron. Entre les réflexions à large spectre sur l’idée d’humanité et les remarques à chaud sur l’événement du jour, la continuité est frappante : les références littéraires et philosophiques sont identiques, et la même intensité anime les propos de l’auteur, cet homme « qui ne sait pas ne pas réagir » (Kundera).
À l’exception de deux textes, Nous autres modernes et L’Humanité perdue, qui ouvrent le parcours, tous les livres suivants sont des livres d’entretiens. Ils donnent à voir Finkielkraut dans une variété de registres qui mêlent l’amitié la plus touchante, la résistance pied à pied ou le conflit irrémédiable. C’est que trois de ces dialogues ont un enjeu humain : Benny Lévy, Élisabeth de Fontenay ou Alain Badiou attendent, voire exigent quelque chose de lui. Benny Lévy voudrait qu’il abandonne le divertissement philosophico-politique pour les choses sérieuses, c’est-à-dire l’étude de la Torah. Leur discussion a un contexte. À l’époque, Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut se démènent pour pérenniser un Institut d’études lévinassiennes, nouvellement créé à Jérusalem, où Benny Lévy enseigne. On ne peut pas dire que l’ex-maoïste déborde de gratitude envers ses soutiens. On ne peut pas dire non plus que son charisme a survécu à sa personne : ce Benny Lévy qui a électrisé des générations de militants puis d’étudiants conjugue au cours de ces échanges le simplisme théorique et la brutalité humaine. Finkielkraut s’inquiète-t-il pour la nation française, dont la laïcité est contestée, l’école menacée, le déclin perceptible ? Eh bien qu’il délaisse la France – si jamais elle se relève et se refait une identité, ce sera de toute manière contre les juifs, tranche Benny Lévy – qu’il délaisse donc la France et fasse son Alyah.
Incartades
Élisabeth de Fontenay, à qui Alain Finkielkraut voue une amitié profonde, attend de lui qu’il réprouve clairement ce qui, dans ses écrits et ses déclarations, l’apparente à la droite, voire à l’extrême droite : avant toute chose, qu’il cesse de soutenir Renaud Camus, ce mouton noir dont elle refuse