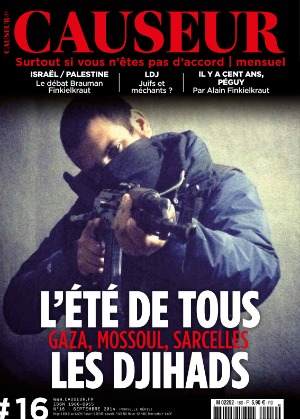Brusquement, le ton des médias a changé au matin du 14 août. Les chiffres de production de la France et de la zone euro pour le deuxième trimestre venaient de tomber : l’hypothèse d’une deuxième rechute économique a été prise en compte, la bienveillance qui protégeait la présidence française s’est muée en appréciation critique[1. En témoignent les commentaires qui ont accompagné l’intervention de François Hollande du 14 juillet 2014]. Le bataillon des journalistes stratosphérisés est redescendu sur terre, sinon pour partager le sort commun, du moins pour méditer sur la dureté des temps.
Pourtant, la personnalité majeure de la zone euro, aux côtés de la chancelière allemande, avait annoncé que la situation restait des plus médiocres. Mario Draghi, le président de la BCE, répète en effet depuis des mois que la reprise n’est pas ce qu’on voudrait qu’elle soit. Aucun des ressorts habituels de la croissance n’est à l’œuvre dans l’ensemble de la zone : la consommation, soutenue en Allemagne, reste faible partout ailleurs ; l’investissement est médiocre ou en recul partout, y compris en Allemagne ; les exportations n’avancent pas de façon notable, sauf encore en Allemagne.[access capability= »lire_inedits »]
On pourrait se réjouir de voir l’Espagne et le Portugal renouer avec la croissance ; ce serait oublier que ces pays redémarrent, depuis une situation de dépression, sur un champ de ruines. L’Italie, elle, vient d’afficher sa troisième récession en l’espace de six ans. La surpuissante Allemagne a reculé. La France est encalminée pour de bon. Or, à elles trois, ces économies, qui forment l’essentiel de la CEE d’origine, représentent plus des deux tiers du PIB de la zone.
Il faut enfoncer le clou : si la zone euro est aujourd’hui la zone la moins dynamique dans le paysage économique mondial, ce n’est pas par accident. Son asphyxie procède de facteurs identifiables qui ne sont jamais pointés. Elle est une zone démographique dépressionnaire, à l’exception de la France. Elle a dissimulé frauduleusement son hétérogénéité sous le voile trompeur de la monnaie unique. Elle accepte le handicap de travailler avec la monnaie la plus surévaluée au monde[2. Airbus affiche un profit bien moindre que Boeing, en dépit de son succès commercial. C’est l’effet de la surévaluation relative de l’euro, de l’ordre de 15 %]. Enfin, elle dépend d’un système institutionnel européen qui ne défend pas les intérêts des ses membres, là où ses concurrents américain et chinois s’y appliquent chaque jour.
Mais avec la surévaluation monétaire, c’est le traitement de la crise dite des pays du Sud, à partir de 2010, qui a causé le plus de dommages immédiats. Pour maintenir l’intégrité de la zone monétaire, on a sommé des économies en faillite d’accomplir une double opération de rigueur budgétaire et de baisse des coûts salariaux dans le privé. Revenons sur ce dernier aspect.
Dans un précédent texte [3. « Une Europe trop faible dans un euro trop fort », Causeur de février 2014], nous avions évoqué la déflation salariale opérée dans les pays du Sud « au risque de la déflation des prix ». Nous y voilà. La baisse des prix à la consommation est effective en Grèce, au Portugal, en Espagne. Ailleurs, les prix évoluent à peine. La France affiche une hausse annuelle de 0,5 % qui correspond uniquement à la hausse des prix administrés tels que ceux de l’énergie ou des transports ferroviaires. Aucun pays de la zone n’atteint 1 % d’inflation.
Les conséquences de cette situation sans précédent depuis la guerre sont aisément imaginables. La double évolution décevante du volume des ventes et des prix vient comprimer les chiffres d’affaires et les marges des entreprises, qui se heurtent ainsi à un double obstacle symétrique : la difficulté d’amortir les dépenses d’investissement du passé, l’impossibilité de se lancer dans des investissements majeurs pour l’avenir. Si l’on ajoute le handicap de la surévaluation monétaire, qui affecte toutes les exportations hors zone euro, il est exclu que le montant d’investissement critique pour l’obtention d’une reprise durable et saine puisse être atteint.
C’est en amont des filières de production que les entreprises pâtissent le plus de ce mouvement de décélération des prix. Leurs clients situés en aval tentent de se protéger en exigeant des prix d’achat de plus en plus serrés. Quand ils obtiennent ces prix, ils reportent leurs difficultés sur leurs partenaires, sans craindre de les asphyxier. Une psychologie égoïste, malsaine et dolosive s’installe ainsi dans le monde économique.
Tout résulte du refus du démembrement de la zone euro dont auraient pu profiter les pays les plus touchés. On avait, en 2010 et 2011, le choix entre la dévaluation monétaire et la dévaluation des salaires. Il s’agit là, en fait, de deux procédés, très différents, qui visent à réduire le coût du travail. Dévaluer la monnaie revient à rendre moins cher le travail produit en vue de l’exportation. Mais quand on cherche à atteindre cet objectif par la déflation salariale, on s’expose mécaniquement à une forte chute de la consommation. Nos amis grecs, espagnols, portugais, irlandais en ont fait l’expérience.
Nos compatriotes intoxiqués par la propagande sur la réussite allemande ont dû être surpris par les difficultés apparues en Allemagne. Elles sont pourtant l’autre face de la réussite germanique et procèdent de la même origine qu’elle : le pari de la mondialisation. Les Allemands ont fait le choix collectif d’une insertion compétitive dans la concurrence mondiale élargie aux pays émergents. Le consensus des pouvoirs publics, des patrons et des syndicats a permis de renforcer un appareil de production qui était déjà de grande qualité. Et l’éblouissante performance à l’exportation a permis à la RFA d’aujourd’hui d’être le premier grand pays européen à effacer sa récession de 2009[4. Avec l’Angleterre depuis ce printemps. Il faudra revenir sur les raisons de la récente prospérité anglaise]. Mais, de ce fait, elle reste étroitement dépendante du courant d’exportations et des investissements qu’il suscite.
C’est pour cette raison que le nouveau gouvernement Merkel évalue les hypothèses d’évolution du modèle économique national. Les ministres économiques constatent avec satisfaction que les salaires progressent enfin, que la consommation suit, que l’immigration choisie, qui n’est pas un slogan outre-Rhin mais la réalité, permet de combler les déficits de main-d’œuvre pour certains métiers. Ils mesurent la force maintenue des exportations, qui devraient progresser de 3,5 % encore cette année. Un retournement conjoncturel est à tout le moins improbable. Mais ces titulaires s’interrogent aussi sur la faiblesse de l’investissement total, privé et public : 17,5 % du PIB contre 21,5 % dans la moyenne des pays développés. L’Allemagne investit peu dans ses infrastructures par souci de réduire au plus vite la dette publique héritée des charges de la réunification[5. 1 500 milliards d’euros ont été transférés de l’Ouest vers l’Est]. Ses entreprises investissent de plus en plus sur les marchés où elles exportent, ce qui réduit le potentiel d’investissement sur le territoire national.
Concomitamment, les chefs d’entreprise allemands s’inquiètent de la crise ukrainienne. Les sanctions occidentales contre Moscou aggravent une situation économique déjà fortement dégradée depuis 2013 par la chute du rouble et la fuite des capitaux. L’ensemble formé par la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie est promis à une sévère récession. Or, 6 200 entreprises allemandes travaillent en Russie. Elles devront faire face à la chute de leurs profits ou à des pertes sur leur marché local. Le patronat allemand en ayant pris conscience, le climat des affaires s’est assombri. En toute hypothèse, les investissements en souffriront. Le dynamisme allemand va se modérer, à moins de mesures de relance.
De ce côté-ci du Rhin, la croissance française a échappé au pire, au premier trimestre parce qu’on a fait des stocks, au deuxième trimestre parce qu’on a consommé grâce à la dépense sociale. Le commerce extérieur est encore un peu plus dégradé, l’investissement s’érode. Les deux zéros trimestriels répétitifs infligent une claque à François Hollande et à Pierre Moscovici, le premier ayant annoncé la reprise et le second ayant pronostiqué une forte croissance, en août 2013.
C’est, bien entendu, le déclin historique de l’industrie qui est au cœur du problème français. Nous produisons moins de biens industriels qu’il y a vingt ans. Notre sidérurgie est morte sous les coups des raids d’Alcan sur Pechiney et de Mittal sur Arcelor. Notre industrie automobile est reléguée à la quatrième place européenne, après le transfert des petites Renault hors de France et avant celui, annoncé, des petites Peugeot et Citroën. Les secteurs dits de main-d’œuvre, comme le textile, se sont réduits comme peau de chagrin. Il faudrait alors, outre les mesures de sauvegarde que seraient la sortie de l’euro allemand et des trente-cinq heures, définir un modèle économique qui s’appuie sur la qualité de nos ingénieurs et de nos informaticiens, lesquels, sinon, en seront réduits à travailler pour l’Allemagne.
Mais peut-on attendre cela d’un président qui a cessé de réfléchir à l’économie il y a trente ans, au moment du tournant mitterrandien de 1983 ? Le delorien impénitent qui fait semblant de diriger la France est l’un des moins outillés pour penser, dans l’urgence, la bifurcation nécessaire de notre organisation et de notre politique économique.
La croissance nulle de la zone euro remet à l’ordre du jour la question des dettes publiques. Les économistes lucides le savent, il faudrait, pour stabiliser, puis résorber les dettes publiques, une croissance forte doublée d’une inflation d’au moins 2 %. Or, nous risquons la rechute dans une troisième récession et surtout le maintien de cette déflation sournoise qui plombe les comptes des entreprises et des États.
Mario Draghi nous a été présenté comme l’homme prodigieux qui allait nous permettre de surmonter l’enlisement européen. On oublie ainsi ses propos réitérés sur la faiblesse du dynamisme européen qui ne dépend pas de la politique monétaire. Mario Draghi ne peut obliger les entreprises à investir, les ménages à consommer. Il offre de la monnaie quasi gratuite – 0,15 % – à ses guichets. Que pourrait-il faire d’autre ?
Il pourrait se résoudre à faire, comme à Londres et à Washington, du Quantitative Easing. Sous ce vocable obscur se cache une réalité simple et triviale. La banque centrale se transforme en banque commerciale. Elle rachète massivement des créances privées et publiques à long terme (de dix à trente ans de durée). Ainsi, la Réserve fédérale a emmagasiné plus de 4 000 milliards de dollars d’emprunts privés et publics dans ses comptes, la Banque d’Angleterre 375 milliards de livres sterling d’obligations publiques. Avec raison, Mario Draghi s’y est refusé, limitant ces rachats dans leur montant et dans leur durée (trois ans au maximum). Car il sait que le QE est un aller sans retour. On ne peut remettre sur le marché les emprunts rachetés sans provoquer une crise financière qui ébranlerait les banques des deux côtés de l’Atlantique.
Et c’est pourquoi il résiste au chant des sirènes qui l’appellent à imiter Ben Bernanke et Mervyn King. Cependant, la pression qui s’exerce sur lui se renforcera si l’état de faiblesse de la zone euro se confirme. Les gouvernements, désarmés devant une crise qu’ils n’ont pas tenté d’analyser, pourraient se liguer pour réclamer la mise en œuvre du QE. Attendons de voir comment le talentueux acrobate italien s’y prendra, soit pour aller au Canossa du QE, soit pour résister encore aux appels à l’aventurisme monétaire qui montent vers lui.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !