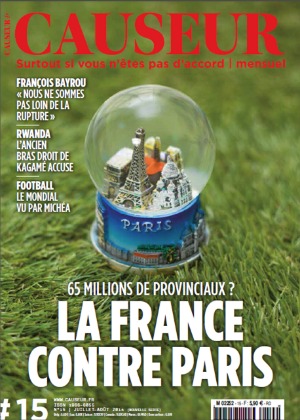Le texte ci-dessous n’est pas un « entretien » au sens classique du terme. Jean-Claude Michéa a accepté de répondre à quatre questions. Qu’il en soit remercié. Cependant, nous n’avons pu lui faire part de nos objections à ses réponses… Ce sera pour la poursuite de ce dialogue !
Causeur. Pour des milliards de gens, le football n’est pas un sport mais un spectacle qui génère d’énormes profits et suscite une immense ferveur populaire. Et avec la marchandisation vient la corruption : le Qatar achète le Mondial 2022, Platini lui-même est soupçonné. Dans le monde entier, des peuples adulent des hommes-sandwiches milliardaires, sans parler des hooligans et de la violence entre supporteurs. Est-ce que cela ne remet pas en cause toutes vos analyses sur l’incompatibilité anthropologique qu’il y aurait entre les valeurs du peuple et celle du marché ? Le football n’est-il pas la preuve que la pulsion de jouissance qui est le moteur du capitalisme est très équitablement partagée ? Y a-t-il vraiment plus de common decency dans ces foules vociférantes que chez les mercenaires qu’elles admirent ? Après tout, « le pain et les jeux », ça marche depuis toujours, non ?
Jean-Claude Michéa. N’étant pas journaliste, je suis évidemment incapable de savoir ce que pensent réellement des « milliards de gens ». En revanche, votre idée selon laquelle le football cesserait d’être un sport dès lors qu’il devient un spectacle me laisse perplexe. Est-ce à dire, par exemple, que les spectateurs que leur passion conduit à fréquenter les salles d’opéra − il leur arrive d’ailleurs aussi, à l’occasion, de siffler le spectacle offert − seraient, pour cette simple raison, définitivement étrangers à l’art lyrique ? Mais peut-être entendiez-vous seulement prendre le mot « spectacle » dans son sens debordien − « le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image » − et désigner ainsi le système des effets profondément aliénants et mystificateurs que la marchandisation du monde induit effectivement sur la totalité de la vie humaine. Votre question aurait alors un sens précis. Le problème, c’est qu’elle revient, du coup, à m’opposer ma propre thèse ! Mes textes sur le football ont toujours eu pour objectif, en effet, de montrer que la colonisation croissante de ce sport par la logique libérale − l’« arrêt Bosman » en a été l’un des moments-clés − ne peut conduire qu’à en dénaturer progressivement l’essence populaire, jusqu’à affecter aujourd’hui la philosophie du jeu elle-même. Telle, du moins, qu’elle avait pris naissance dans le passing game des clubs ouvriers et écossais des années 1870, et telle qu’elle avait été transmise, notamment à travers l’apport décisif de Jimmy Hogan, au merveilleux football autrichien des années 1930, puis hongrois des années 1950 (son nom devrait être écrit « en lettres d’or dans l’histoire de notre football » − disait de lui le théoricien du « football socialiste », Gusztàv Sebes). S’il subsiste, malgré tout, une différence évidente entre nos deux points de vue, c’est donc d’abord parce qu’à l’instar du dernier Debord, vous semblez croire que l’emprise du libéralisme sur la vie humaine est déjà devenue totale et qu’en conséquence la grande majorité du public populaire aurait accepté depuis longtemps cet effacement du beau jeu au profit du seul calcul − les Brésiliens opposent le futebol d’arte et le futebol de resultados − qui est au cœur du « football libéral ». Or jusqu’ici − et quelle que soit l’ampleur des transformations déjà opérées − rien ne permet encore, pour quelqu’un qui observe la chose de l’intérieur, de valider sérieusement cette thèse. Il faut donc plutôt chercher les raisons de votre pessimisme radical du côté de cette curieuse vision du public populaire − ces « foules vociférantes » travaillées par la « pulsion de jouissance » − que vous avez visiblement empruntée aux sermons habituels de l’extrême gauche néo-puritaine sur l’« idéologie sportive » (« le foot, c’est la guerre, les frontières et les hurlements bestiaux de prolétaires avinés »). Vision à la Cabu qui ne constitue pourtant qu’une reprise à peine voilée des doléances de la bourgeoisie de Deauville devant l’invasion de « ses » plages, durant l’été 1936, par ces nouveaux « congés payés » bruyants, sales et − comme il se doit − dépourvus de toute common decency. Il est vrai qu’on trouvait déjà des descriptions identiques du public plébéien dans les imprécations répétées de Tertullien et des Pères de l’Église contre les jeux et les distractions populaires de leur époque. Comme quoi, en effet, « ça marche depuis toujours » !
En attendant, au Brésil, la Coupe du monde semble avoir étouffé la lutte sociale. Tout le monde s’est offusqué que Michel Platini demande aux syndicats de « faire un effort » et d’attendre un mois pour faire la grève, mais dans les faits, c’est ce qui s’est passé, et non pas en raison de calculs cyniques mais parce que c’est une véritable croyance collective. Bref, il y a une dimension religieuse dans la passion du foot. Peut-on parler encore de culture populaire ou est-ce autre chose qui, de la culture populaire, n’a gardé que cette pseudo-religiosité ?
La sortie de Platini est absolument lamentable. Elle confirme à quel point le pouvoir et la richesse finissent toujours par couper leurs détenteurs − si intelligents soient-ils au départ − de tout sens des réalités[access capability= »lire_inedits »] et donc, à terme, de tout sens moral (c’est d’ailleurs l’argument philosophique le plus puissant que je connaisse en faveur d’une société sans classe). Quant au Brésil, il est parfaitement exact que le football − pour des raisons historiques − constitue un des éléments majeurs de son identité collective. La plupart des Brésiliens − et des Brésiliennes − apprennent dès le plus jeune âge à « lire » un match, comme les Espagnols une corrida, ou les Russes une partie d’échecs. On peut donc effectivement parler − si on y tient absolument − d’une véritable religion du football propre à ce pays. Sous réserve, bien entendu, de prendre le mot de « religion » dans son sens sociologique, c’est-à-dire pour désigner une forme de culture populaire (dans « culture » il y a « culte ») qui a su progressivement se donner ses formes de théâtralité spécifiques (dont l’humour est rarement absent), ses codes particuliers et − c’est là le plus important − une mémoire collective partagée, avec ses héros, ses drames et ses exploits légendaires. Or c’est évidemment l’aspect populaire de ces formes de « religiosité » qui choque habituellement l’élite culturelle. On imaginerait mal, en effet, le haut clergé intellectuel dénoncer comme « aliénante » ou « bestiale » la prétention d’un Frédéric Schlegel ou d’un Théophile Gauthier à faire de l’art une religion. Et pourtant les grandes cérémonies rituelles de ce Mondial de la bourgeoisie qu’est devenu le Festival de Cannes – cérémonies qui reposent entièrement sur cette mythologie romantique de l’artiste − donnent lieu, chaque année, à des débordements de « pseudo-religiosité » patricienne − le « Grand Journal » de Canal+ en est l’expression caricaturale − qui ne le cèdent en rien à ceux du public plébéien du stade Vélodrome. Avec d’ailleurs beaucoup moins de légitimité philosophique puisqu’il n’est pas rare qu’un tel festival récompense un réalisateur pour son seul conformisme politique, pratique qui serait naturellement inimaginable dans l’univers infiniment plus exigeant du ballon rond (et rappelons, au passage, que l’industrie du cinéma n’est pas moins soumise aux lois du capitalisme que celle du football). Du coup, vous en venez à donner de la lutte des travailleurs brésiliens une présentation très déformée. Car ce qui frappe, lorsqu’on prend la peine de lire attentivement les revendications que ces travailleurs continuent de défendre − y compris pendant le déroulement du Mondial − c’est, au contraire, leur singulière capacité dialectique à lier leur passion toujours intacte pour le futebol d’arte à une critique impitoyable de la FIFA et de la dénaturation capitaliste de ce sport (les analyses de Romario sont, de ce point de vue, un modèle du genre). Voilà qui confirme plutôt le jugement de Claudio Magris : « En cette époque dite de culture de masse, ce ne sont pas les masses qui manquent de culture mais plutôt les élites. Il est rare d’entendre dans un autobus des bourdes aussi monumentales que celles qu’on remarque à la télévision ou dans les journaux. »
Des bad boys aux boy-scouts : tout le monde, et nous aussi, s’est réjoui de la transformation miraculeuse des Bleus. Mais ne s’agit-il pas toujours d’un récit publicitaire concocté pour les médias et les sponsors, ce qu’on appelle story-telling dans les gazettes branchées ?
Le battage médiatique indécent − et de nature à dégoûter du football n’importe quel aficionado − auquel donnent systématiquement lieu le Mondial et les prestations de l’équipe de France témoigne effectivement de l’incroyable puissance de récupération, comme on disait en Mai-68, qui caractérise la société du Spectacle. Pour autant, peut-on sérieusement prétendre que cette puissance est devenue telle qu’elle permettrait désormais d’imposer à un public de connaisseurs un simple « récit publicitaire concocté par les médias et les sponsors » ? Si tel était le cas, il faudrait alors admettre que la désaffection massive dont l’équipe de France de 2010 a longtemps été l’objet de la part de ce public − désaffection dont les sponsors ont d’ailleurs payé le prix − aurait été sciemment « concoctée » par ces sponsors eux-mêmes ! J’ai, pour ma part, une hypothèse beaucoup plus simple et beaucoup moins méprisante pour les gens ordinaires. Si le public populaire ne parvenait plus, depuis des années, à se reconnaître dans l’équipe de France entraînée par Domenech, c’est avant tout, en effet, parce que cette équipe bafouait non seulement tous les principes du futebol d’arte − elle se montrait pathétiquement incapable de construire le moindre jeu de passes créatrices orientées vers l’avant − mais également toutes ces vertus que les classes populaires tiennent encore en haute estime, comme le sens de l’effort et le refus de sacrifier l’esprit collectif au règne libéral du « chacun pour soi ». Et c’est justement, à l’inverse, parce que l’équipe aujourd’hui reprise en mains par Didier Deschamps − une fois écartés les joueurs les moins aptes à incarner ces vertus − commence, depuis le match « fondateur » contre l’Ukraine, à manifester un autre état d’esprit, et donc une autre philosophie du jeu, que le climat est en train de se réchauffer peu à peu entre les Bleus et leur public populaire. Et cette « transformation miraculeuse » (n’exagérons quand même pas !) doit, à l’évidence, beaucoup plus aux leçons philosophiques administrées à l’Europe tout entière par le Barça de Pep Guardiola − tous les entraîneurs libéraux (ou « réalistes ») ont été contraints, parfois la mort dans l’âme, de tenir compte de cette renaissance spectaculaire du vieux passing game − que d’un quelconque story-telling directement mis au point par Adidas, Sony ou Coca-Cola. Même si, comme toujours, on peut évidemment faire confiance au système capitaliste − et donc aux instances dirigeantes du football mondial − pour récupérer à leur seul profit tout ce qui, dans ce sport, est susceptible de générer de la valeur d’échange – quitte, pour cela, à en dénaturer profondément l’essence originelle et à le couper définitivement de ses racines populaires.
Beaucoup de gens s’identifient au club de leur ville mais, comme nous le rappelle chaque Coupe du monde ou d’Europe, les équipes nationales suscitent toujours une adhésion particulière, même chez ceux qui, entre deux tournois internationaux, ne s’intéressent pas à ce sport. Y voyez-vous la preuve de la pérennité des nations, au moins dans l’imaginaire des peuples, ou l’ultime simulacre d’un patriotisme définitivement éteint ?
Rappelons d’abord que la notion d’identité − qu’elle soit régionale, nationale, européenne ou autre − n’a strictement aucun sens dans le cadre de la logique libérale (sous ce rapport, le rejet par la gauche française du concept d’identité nationale est donc parfaitement cohérent). Une société libérale doit toujours se définir, en effet, comme un simple agrégat contingent d’individus unis par leur seule acceptation contractuelle des lois du marché autorégulé et de l’égalité juridique abstraite. Pour le reste peu importe, au fond, que ces individus ne possèdent aucune référence morale, culturelle ou historique commune ni même qu’ils ne parlent pas la même langue (c’était le sens de la formule de Margaret Thatcher selon laquelle « la société n’existe pas »). C’est ce qui explique, au passage, le rôle central que joue l’idéologie « multi-culturaliste » dans la reproduction idéologique du capitalisme. D’un point de vue libéral, il est en effet indispensable de renvoyer en permanence chaque communauté de fait à son ghetto culturel d’origine − que celui-ci soit « ethnique », religieux ou autre − afin que tout appel fédérateur à développer un minimum de valeurs morales et politiques communes puisse être aussitôt dénoncé comme « totalitaire », « national-nostalgique » ou « discriminant ». Il n’est pas besoin, bien sûr, d’avoir lu l’œuvre intégrale de Durkheim et de Mauss pour comprendre que cette vision purement contractualiste de la société constitue un non-sens anthropologique absolu. Aucune société digne de ce nom, surtout si elle se veut démocratique, ne peut en effet se passer d’un minimum de langage culturel commun, ne serait-ce que pour rendre possible un débat contradictoire permanent entre tous ses membres − et non une simple confrontation stérile de monologues « communautaires ». Or, à partir du moment où l’École n’a plus d’autre objectif réel que de former la main-d’œuvre « compétitive » requise par le marché mondial (Victor Hugo n’étant plus qu’un dead white european male parmi d’autres), on peut compter sur les doigts de la main les formes de culture populaire partagées encore capables de proposer une traduction plausible de ce sentiment d’appartenance à un monde commun sans lequel toute société – pour reprendre la vieille formule des socialistes saint-simoniens – ne serait plus qu’une « agrégation d’individus sans liens et n’ayant pour mobile que l’impulsion de l’égoïsme ». Il se trouve que l’univers traditionnel du football répond toujours à ces critères. On ne doit donc pas s’étonner s’il reste un des seuls à pouvoir encore offrir aux catégories populaires − et particulièrement à celles qui sont issues de l’immigration − un véritable langage commun et donc la possibilité de s’identifier à une ville, une région ou un pays. On me dira que c’est là une base philosophiquement très mince pour espérer rassembler l’ensemble des classes populaires autour d’un programme politiquement émancipateur. J’en suis parfaitement conscient ! Mais si, en plus − et au nom, précisément, de cette idée néo-puritaine selon laquelle le sport serait déjà entièrement réductible à sa dimension d’« opium du peuple » − on laisse le système capitaliste poursuivre tranquillement son travail de dénaturation méthodique des valeurs originelles du people’s game (c’est le nom que les prolétaires britanniques donnaient naguère au football), alors la possibilité de voir se constituer un tel « bloc historique » deviendra sans doute plus problématique encore. Il devrait aller de soi, en effet, que ce n’est pas en commençant par se couper du peuple − un art dans lequel l’extrême gauche moderne a toujours excellé et dont elle tire généralement toute sa fierté − que l’on pourra favoriser l’avènement de cette société « libre, égalitaire et décente » qu’Orwell appelait de ses vœux. Mais peut-être, après tout, avez-vous fini par penser − comme tant d’autres − qu’un peuple qui peut se passionner pour des choses aussi futiles que les dribbles de Leo Messi ou les offrandes magiques d’Iniesta ou de Pirlo ne sera jamais assez adulte pour se gouverner lui-même. C’était déjà − bien avant l’extrême gauche contemporaine − la leçon fondamentale de Platon.[/access]
Que Jean-Claude Michéa se rassure : nous ne pensons rien de tel !
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !