« C’est dans le passé qu’est tout notre bonheur ; et le mien me torture de sa grâce évanouie »
Sachons gré à Frédéric Martinez d’avoir su rendre hommage, et vivant, un poète pour « happy few » – Paul-Jean Toulet donc, qui dut longtemps s’accommoder d’une gloire discrète. Un peu à la manière, ténue mais insistante, d’un Henry Jean-Marie Levet dont les Cartes Postales firent la gloire posthume – et les délices et l’admiration de Larbaud, Fargue, Morand ou Sylvia Beach.
Martinez dit Toulet avec talent et inspiration – comme on a rarement lu. Et l’on pèse ses mots. Martinez connaît « son homme » comme on connaît seuls ses intimes (mauvais exemple ? Soit) et il en écrit avec émotion, justesse, équanimité, grâce et érudition. Il y a là, réellement, comme un miracle de transsubstantiation, un passage de témoin mémorable.
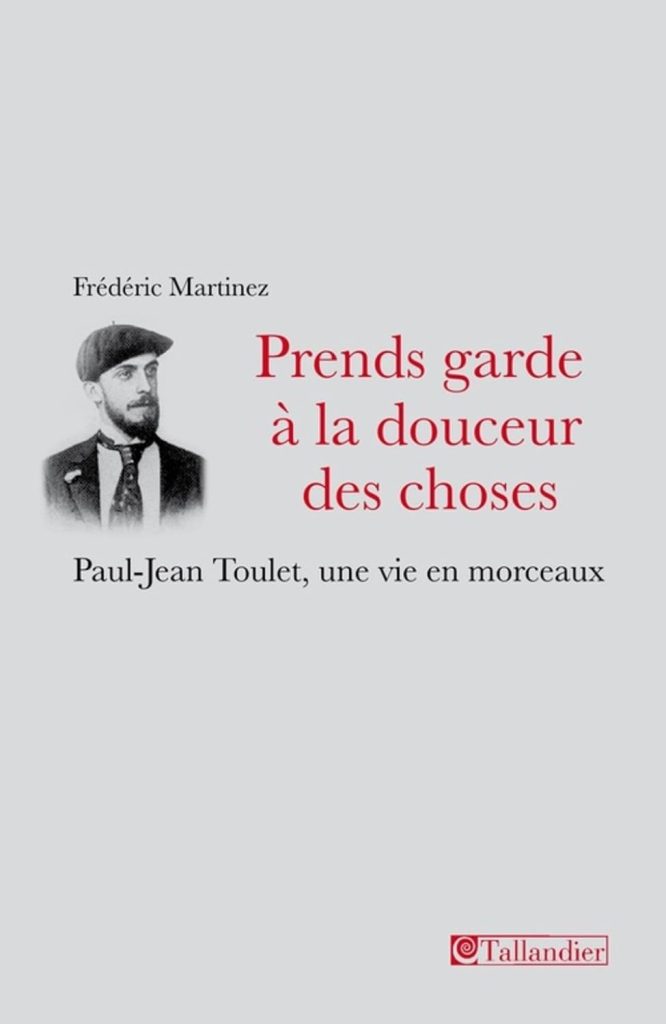
Écoutez-le : « Paul-Jean Toulet naquit à Pau en 1867. Il mourut à Guéthary en 1920. Il écrivit des livres. Le plus célèbre d’entre eux, Les Contrerimes, fut publié après sa mort (par son ami, le distingué, et stendhalien émérite, Henri Martineau). Dans ce recueil de poèmes amers et brefs, il sut imposer un style personnel tissé de classicisme et d’irrévérence. Contemporain de Proust, d’Apollinaire, Toulet fut une figure du Paris 1900, un opiomane notoire et le chef de file de l’école fantaisiste (qui regroupait, entre autres, Francis Carco, Tristan Derème et Jean Pellerin).
Et quoi encore ? Je reprends. Plus qu’un écrivain, Toulet est un sentiment, un état d’âme. Son bonheur d’écrire et son mal de vivre, son sourire en larmes font de sa lecture une expérience singulière. Son œuvre est une confidence. Ceux qui la reçoivent ne l’oublient pas.
L’homme qui voulait prendre garde à la douceur des choses se rendit à celle des mots. Son français est une grâce. Peu de poètes l’eurent à ce point. Illustre et pourtant méconnu, il fut un écrivain discret. Trop. Certains de ses poèmes comptent parmi les plus beaux de la littérature française. On ignore souvent qu’il en est l’auteur. (…) Ce livre n’est pas une biographie. C’est l’histoire d’un poème ».
Vous n’avez pas envie de continuer ? D’en savoir plus ? Vous ne le trouvez pas pour le moins habité ce prologue, nerveux, cursif, personnel ? Vous galéjez.
Il évoquait « (son) frère le whisky et (son) amie la nuit », Stendhal était son écrivain de chevet, une de ses plus constantes admirations, il disait avoir « aimé le plus au monde » : « les femmes, l’alcool et les paysages ». Il cultivait « le crincrin de la blague et le sistre du doute ».
L’ont aimé – voire admiré – Carco, Proust, Valéry (« la matière, à ce degré de finesse, n’est plus elle-même, et s’approche du système nerveux » – à propos des Contrerimes), Maurice Rostand, Francis Jammes, Henri de Régnier, Claudel, Giraudoux, Bernanos, Gide, Jacques Réda, Philippe Jaccottet, Borgès, Vialatte, Pascal Pia, Michel Bulteau, Jean d’Ormesson, Jean Dutourd, Hubert Juin, j’en passe.
Lui, aimait Baudelaire, Verlaine, La Fontaine, Leconte de Lisle, Moréas, Corbière, Banville, Laforgue, Maurice de Guérin. Un « néo-classique » dirait-on, plus tard, lorsque l’on considèrerait, à rebours, les surréalistes, Apollinaire ou Claudel, ses contemporains. Martinez en parle comme d’ « un faux blasé, crédule, aussi peu roué que Stendhal ».
Il était drôle, acide, léger, érudit, railleur, cultivait les archaïsmes et la conversation, rêva de fonder un « club de grammaire » (c’était un latiniste éminent et sa poésie – prosodie, lexique et grammaire – s’en ressent), cultiva la fantaisie comme paravent à la mélancolie, et fut le meilleur ami de Debussy.
Il fut un romancier d’occasion, un styliste d’élection et un poète par nécessité (la seule, peut-être, qu’on lui connût).
Il fit du mélange des genres – le langage populaire, la tradition latine et l’exotisme – une de ses « marques de fabrique ».
Pierre-Olivier Walzer, « touletologue » éminent, l’évoquait ainsi : « Ce qu’on goûte chez lui, ce sont les charmes du langage, la fantaisie du primesaut, l’ironie mordante ou amusée, les tours de la syntaxe, le choix des mots, la délicatesse ou l’imprévu des images, en bref : le style ». Remarquez combien ce poète donne de talent à ses exégètes.
Né à Pau, Toulet avait des attaches à l’île Maurice – où il s’en fut, trois ans durant, après des études un peu chahuteuses qui le menèrent de Pau à Bordeaux et de Bordeaux à Saintes, en passant par Bayonne.
A Maurice, il mène une vie de jeune homme amateur de plaisirs, ceux de l’amour évidemment, mais aussi du jeu et de l’alcool.
Puis c’est Alger, où il se fait journaliste : ce néophyte a une sensibilité de moraliste. « La pointe essayée, plus qu’ornementale, devient formule contondante dénonçant toute vanité ». Il regagne la France en 1889.
Dès lors, sa vie rétrospectivement va former « une manière de triptyque ».
De 1889 à 1898, une période provinciale (son Béarn natal) et oisive en apparence – il accumule notes et impressions. De 1899 à 1912 – hormis un excursus en Extrême-Orient (1902-1903, flanqué de son grand ami Curnonsky, visite de Singapour, Hanoï, Saïgon…) -, il mène une existence de noctambule parisien, riche de fréquentations multiples et parfois illustres.
Couché à 7H du matin, il émerge vers 15h et s’en va au Bar de la Paix retrouver Maurras, Léon Daudet, Edmond Jaloux, Henri de Régnier, Giraudoux, Émile Henriot, Jean-Louis Vaudoyer, Valéry ou Debussy. Il était Rive Droite et n’avait guère l’âme républicaine.
Léon Daudet l’évoquait ainsi : « Nous l’aimions pour son horreur de la foule, des préjugés démocratiques, de la niaiserie diffuse et des gens importants. »
Ses préjugés étaient d’une époque, et d’un milieu. Pour sa défense (en a-t-il besoin ?), nous citerons Montesquieu, dans ses Pensées : « On ne jugera jamais bien les hommes si on ne leur passe les préjugés de leur temps ».
Martinez résume magnifiquement ce « début dans la vie » : « Amant des femmes, aimé des muses, il connut la Belle Époque et vécut de mauvais jours. Artisan d’un désastre semé d’adjectifs, cet intermittent de la gloire apprit que la littérature est une fille de l’enfer. Plus dangereuse que les apaches qui jouent du couteau près des fortifs, plus perfide que les mondaines qui vous lacèrent le cœur, cette mauvaise fille se montre pareille aux dieux : elle tue ceux qu’elle aime. Au charmant Toulet, elle avait promis le Ciel, elle avait tout donné ; elle avait prodigué talent et fortune : il dilapida l’un et l’autre. Flambeur effréné, amoureux compulsif, l’enfant gâté perdit sa rente sur le tapis vert des casinos et le cuir des sofas. A Pau ou à Biarritz, quand les femmes font l’amour et les croupiers la loi, rien ne va plus dans la nuit de strass. Les démons de Toulet se nomment poker, opium, whisky ; ils se nomment Marie, Nane, Yvonne ». (Vous n’avez toujours pas envie de lire Martinez ?)
Troisième phase, de 1913 à 1920, à nouveau le Béarn, il s’y marie : la création poétique prend le meilleur de son temps – ainsi que la collection de ses proses, légères et spirituelles, publiées dans La Vie parisienne en particulier, ou avec Curnonsky (futur « Prince des gastronomes ») ou Willy (premier mari de Colette qui devait s’en séparer en 1907) : entre autres, Bréviaire des courtisanes, Le Métier d’amant, L’Implacable Siska ou Les Amis de Siska. Les titres nous dispensent d’insister. Le souci d’art disparaît. La sensibilité vire alors à la gauloiserie, et l’esprit au calembour. Il était temps de rentrer (au pays).
Monsieur du Paur, homme public (1898), Mon amie Nane (1905) et La Jeune fille verte (1920) lui vaudront un certain succès, d’estime et public.
Virtuosité du style (toujours) et ambitions réduites les caractérisent, même si d’aucuns (Jean d’Ormesson, Geneviève Dormann, Michel Déon) ont fait de Mon amie Nane un petit livre culte. Parenthèse : l’hommage de Déon à Toulet sera « explicite » lorsque, quelques décennies plus tard, Le Jeune Homme vert, un de ses romans les plus aboutis, répondra à La Jeune fille verte. Fermons la parenthèse.
Et écoutons Frédéric Martinez qui nous semble caractériser assez exactement ces romans : « Passé le premier émerveillement que procure un style souverain, ils s’avèrent ennuyeux, souvent déplaisants, témoignages surannées et guettés par le kitsch d’une époque plus lointaine qu’il y paraît d’abord, préhistoire du vingtième siècle peuplée de petites femmes et de fontaines Wallace, redécouvrant le feu dans l’électricité éclairant ses cavernes modern style ».
Équanimité de Martinez, notions-nous d’emblée, et impartialité : amant, oui, aveugle, non. Et peut-être un peu sévère pour Mon Amie Nane.
Mais la cocasserie de quelques-unes des lettres ou cartes postales qu’il s’adressait à « soi-même », leur élégance et leur désinvolture, son Almanach des Trois Impostures (les dieux, les amis, les femmes) – où, moraliste à la Chamfort, il se montre amer, incisif, spirituel – et, surtout, Les Contrerimes, dont demeurent la nonchalante ironie et l’inquiète beauté, lui garantiront la place unique, isolée, altière qui est la sienne dans la poésie française. Toulet, trop sceptique pour s’y attarder, qui excelle en outre dans les formes brèves, n’écrira pas son Temps retrouvé. La tonalité y eût été pourtant.
Recueil de trois cents pièces, chansons, dizains, quatrains ou coples, Les Contrerimes modulent un désenchantement sans remède qui décolore les voluptés et les spectacles de la vie.
La connaissance que Toulet avait des formes littéraires à travers les siècles jointe à une évidente liberté d’allure explique la subtilité voulue de ses vers, où la composition et l’émotion s’exaltent l’une l’autre.
Loin d’y entendre quelque impassibilité parnassienne (pas si lointaine parfois), on y perçoit le vibrato primitif que visait, par-dessus tout, Paul-Jean Toulet – poète « pince-sans-rire » (sic) de la nostalgie et de la mémoire, obsédé par le temps (qui passe) et par la mort (qui vient).
Charles Du Bos, une fois n’est pas coutume, évoque très justement sa poésie : « C’est dans la réduction à l’unité d’impressions venues des quatre points de l’horizon, mais perçues et senties simultanément, et comme avec instantanéité, sur le seul plan de l’imagination, que Toulet est incomparable ».
Les images, chez Toulet, magnifient en effet, par de brefs rapprochements, « ce qu’il y a de fugace dans les beautés du monde ». Et Pierre-Olivier Walzer, de conclure : « De Baudelaire, de Moréas, Toulet a appris cet art infiniment discret qui fuit la déclamation, domine le sentiment et réalise un exact équilibre entre les émotions et leur expression littéraire. Faire entendre le plus en disant le moins : il y a là le secret d’un classicisme, renouvelé par l’accent moderne d’une musicalité qui doit beaucoup à Verlaine. Les choses allant toujours « la même chose », il ne peut appartenir à l’art que de fixer, avec une ironique délicatesse, la fragilité des apparences sensibles et l’amère monotonie des recommencements humains. »
Écoutons-le donc encore, inlassablement. Lisons En Arles, sa chanson la plus fameuse : « Dans Arle, où sont les Aliscams,/ Quand l’ombre est rouge, sous les roses,/ Et clair le temps,/ Prends garde à la douceur des choses./ Lorsque tu sens battre sans cause/ Ton cœur trop lourd ;/ Et que se taisent les colombes : / Parle tout bas, si c’est d’amour,/ Au bord des tombes. » L’amour. La mort. Le passage.
Sa mort, justement, il l’avait « rêvé », dix-huit ans plus tôt, dans une lettre à Madame Bulteau (« Toche »), une des femmes qui lui voulut le plus de bien : « Ce doit être délicieux, Toche, de mourir, de sentir toute la fatigue de la vie fuir par le bout des doigts, comme son sang dans un bain ».
Terrassé par une hémorragie cérébrale, Toulet abandonne, dans un livre, une ébauche de poème : « Ce n’est pas drôle de mourir/ Et d’aimer tant de choses/ La nuit bleue et les matins roses/ Le verger plein de glaïeuls roses/ (L’amour prompt) / Les fruits lents à mûrir… »
Né inconsolé, dandy sceptique et désenchanté (parfois désespéré), homme qui aimait les femmes sans les aimer, poète tantôt aigre-doux et ironique, tantôt tendre et léger, poète « fêlé » dont retentit longtemps, une fois qu’on l’a entendu, le timbre inimitable, Toulet nous laisse un vade-mecum en forme de pirouette grinçante. Le voici : « Si vivre est un devoir, quand je l’aurai bâclé, / Que mon linceul au moins me serve de mystère. / Il faut savoir mourir, Faustine, et puis se taire : / Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. »
A lire : Prends garde à la douceur des choses – Paul-Jean Toulet, une vie en morceaux, de Frédéric Martinez, Flammarion.
Prends garde à la douceur des choses. Paul-Jean Toulet, une vie en morceaux (BIOGRAPHIES)
Price: 11,99 €
1 used & new available from 11,99 €
Price: 22,00 €
26 used & new available from 14,00 €
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !





