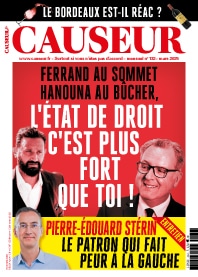Le Quai d’Orsay est-il bien le ministère des Affaires étrangères? Liliane Messika procède à quelques rappels historiques utiles, après la lecture d’un communiqué du gouvernement français concernant les violences des Israéliens en Cisjordanie.
Le Quai d’Orsay est bien le ministère des Affaires étrangères ? Pourtant, c’est à la rue arabe et à ses soumis hexagonaux qu’il a adressé un communiqué le 13 février 2024 : « La France adopte des sanctions à l’encontre de colons israéliens extrémistes qui se sont rendus coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie. À ce titre, 28 individus sont visés par une interdiction administrative du territoire français. (…)
La colonisation est illégale en droit international et doit cesser. Sa poursuite est incompatible avec la création d’un État palestinien viable, qui est la seule solution pour qu’Israéliens et Palestiniens puissent vivre, côte à côte, en paix et en sécurité »[1].
Tout est calibré pour une lecture antisioniste : le choix des mots est un code compris par ceux qu’il vise à apaiser, comme par ceux qui endureront les violences induites. Quant au poids des faux, il pèsera sur les manifestations antisémites, déjà multipliées par 1000 depuis le 7 octobre, dans notre pays.
Explication de texte
« Cisjordanie » est déjà un maître-mot. Il désigne la partie occidentale du Jourdain, que le royaume hachémite de Jordanie avait illégalement annexée lors de la guerre contre Israël, le 15 mai 1948, quand il a déclaré son indépendance vis-à-vis de son colonisateur britannique.
Lorsque Israël l’a reconquise en 1967, ses habitants avaient une carte d’identité jordanienne. Mais en 1970, l’OLP[2] ayant tenté, une fois de trop, d’assassiner le roi Hussein, celui-ci lança l’opération « Septembre Noir », qui tua entre 3500 et 10 000 fedayin et en blessa 110 000 selon les terroristes. Des sources plus fiables parlent de 3500 morts et 10 000 blessés.[3] Les fauteurs de troubles furent expulsés et partirent à Tunis. En 1988, le roi amputa ce membre de son royaume et supprima les cartes d’identité à ses habitants. Les négociations avec Israël étaient probablement déjà engagées, car lorsque le traité fut signé, en 1994, la Jordanie refusa de récupérer ce territoire, arguant qu’elle y avait déjà renoncé et laissant à l’État juif le soin de négocier avec le représentant des