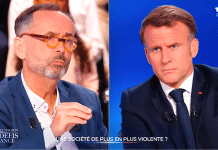De la théorie du genre à la bioéthique en passant par l’antispécisme : panorama non exhaustif des thèses universitaires les plus absurdes, les plus immorales ou les plus risibles – le cumul n’étant pas interdit.
Avant de disséquer dans son dernier ouvrage, La religion woke (1), les thèses déconstructivistes qui ravagent les sociétés occidentales, Jean-François Braunstein avait déjà examiné de près dans La philosophie devenue folle (2), l’excellent essai dont il va être question ici, les travaux de certains « penseurs » très à la mode et ayant participé à l’entrisme, dans le monde universitaire, des théories les plus farfelues devenues, par la force de l’ignorance, de la bêtise idéologique et de la paresse intellectuelle, des thèses « acceptables » et relayées par des professeurs se targuant de progressisme.
Conversations « illicites » avec ma chienne
La théorie du genre est maintenant incontournable dans les universités anglo-saxonnes et connaît un réel succès en France. Le jargon butlérien, après avoir fait le bonheur d’Éric Fassin et de Paris-VIII, a envahi les amphis de la Sorbonne, de Sciences Po, de l’ENS et de quasiment toutes les universités françaises. La théorie en question est aussi fluide, trouble et maigrelette que le liquide rachidien de ses thuriféraires mais les conséquences de son enseignement sont catastrophiques : le transgenrisme, dernier avatar de l’obsession démiurgique et narcissique des déconstructeurs de la distinction sexuelle, ravage une partie de notre jeunesse avec la complicité de l’Éducation nationale, de l’université et de la caste médiatico-culturelle wokiste. Concomitamment, écrit Braunstein, l’idéologie de la « libération animale », initiée par le philosophe et professeur de bioéthique australien Peter Singer, a favorisé l’émergence de l’animalisme et de l’antispécisme chers à Aymeric Caron. Singer, effaçant d’un trait les différences entre « l’animal humain » et « l’animal non humain », s’étonne que les relations sexuelles entre les hommes et les animaux soient encore taboues. Dans la foulée, Monika Bakke, une universitaire polonaise adepte des thèses de Singer, regrette qu’ « aucun pays ne reconnaisse le mariage entre les humains et les animaux ». De son côté, l’universitaire américaine Donna Haraway décrit sa relation avec Mlle Cayenne Pepper, sa chienne, les « baisers mouillés et profonds » qu’elles échangent et les « conversations illicites » qu’elles tiennent, le but étant de « troubler » les distinctions entre les espèces pour finir par « s’entremêler avec le riz, les abeilles, les tulipes, la flore intestinale et tout être organique auquel