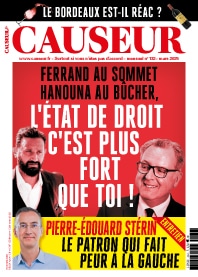Figure reconnaissable entre mille, Harold Hyman est le Monsieur Relations Internationales de CNews. Lunettes rondes à monture épaisse, bretelles rouges bien en évidence, son érudition et sa capacité à transformer une carte en un récit captivant ne sont plus à démontrer. Causeur a voulu savoir comment un Américain a pu – et voulu – s’imposer aux médias français et quelles sont ses préoccupations majeures quand il regarde le monde contemporain en face. Propos recueillis par Alix Fortin et Jeremy Stubbs.
Causeur. Vous êtes franco-américain, new-yorkais d’origine : qu’est-ce qui vous a motivé pour venir vivre en France en tant que journaliste spécialisé en affaires internationales ?
Harold Hyman. Au départ, après mes études, j’ai hésité entre une carrière de journaliste, de diplomate, ou de chercheur. Avant même de décider, il fallait choisir un environnement linguistique et culturel, et j’ai opté pour une aventure française, et non américaine. Comme j’aime ces deux pays par-dessus tout, il fallait vraiment y croire car il n’y aurait pas de retour en arrière.
Ensuite, le journalisme était évident pour moi, car on est journaliste par prédisposition, l’école de journalisme n’est pas obligatoire, et cette activité couvre tous les domaines. J’ai supposé qu’en France je pourrais écrire comme au lycée ou en fac, avec des démonstrations, des références historiques, des conversations rapportées. Stylistiquement, Le Figaro me semblait plus clair que le New York Times, quoique moins dense. L’actu internationale était plus pétillante et directe sur RFI et France Info que sur Voice of America. En France, il y avait un meilleur dialogue entre la droite et la gauche et une meilleure connaissance du monde international et post-colonial – c’est-à-dire une meilleure compréhension du tiers monde, de l’Europe, et du monde arabe. Et la connaissance des États-Unis était plus forte en France que l’inverse. Choisir la France était donc logique selon mes critères subjectifs.
Quel a été votre parcours ?
Après avoir fait le lycée français de New York pendant 12 ans, jusqu’au baccalauréat, et ensuite étudié la littérature comparée, je suis parti à Montréal pour étudier l’histoire. C’était une deuxième immersion dans le monde intellectuel de type français. Là-bas, j’ai certainement étudié dans les mêmes salles et avec certains des mêmes professeurs que Mathieu Bock-Côté quinze ans plus tard ! Me consacrant à l’histoire du Québec, j’ai fait un mémoire consacré à la politique culturelle québécoise jusqu’en 1965, début de la « Révolution tranquille ». Ce mémoire est cité encore aujourd’hui par les chercheurs, car ma curiosité m’a poussé à faire un travail en profondeur sur le sujet. Donc, j’ai le parcours de quelqu’un qui se laisse porter de-ci de-là jusqu’à ce qu’il trouve la bonne voie pour ne plus la quitter.
Pour revenir au présent, quel est, selon vous, le plus grand