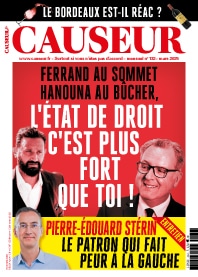En confortant le choix de la fédération française de football (FFF), ce 29 juin, de refuser tout port de signe à caractère religieux lors des compétitions, le Conseil d’État a agréablement surpris.
Par son arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat, saisi par des associations « hijabeuses » ainsi que par la ligue des droits de l’homme, a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’article 1er des statuts de la fédération française de football (FFF), énonçant depuis 2006 que sont interdits, à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci « – tout discours ou affichage à caractère politique idéologique, religieux ou syndical, – tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, – tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande ».
Le Conseil d’État devait donc statuer sur la situation des usagers d’une fédération sportive chargés d’une mission de service public, relative à l’organisation de compétitions en vertu de l’article L131-15 et suivant du Code du sport.
Une décision bienvenue
Le Conseil d’État rappelle préalablement la situation des agents de la FFF (et des personnes sur lesquelles elle exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction) avant de statuer sur celle des « autres licenciés ». Sur les premiers, la haute juridiction rappelle que la fédération est tenue de prendre toutes dispositions pour que ses agents et lesdites personnes, qui participent à l’exécution du service public, s’abstiennent, pour garantir la neutralité du service public, de toute manifestation de leurs convictions et opinions. Ils sont donc soumis à un devoir de neutralité.
Sur « les autres licenciés », le Conseil d’État fonde sa décision sur le pouvoir réglementaire dont la fédération dispose pour l’organisation et le fonctionnement du service public. Il précise que les mesures d’interdictions doivent toujours être adaptées et proportionnées.
Il juge en premier lieu que la fédération détermine les règles de participation aux compétitions et manifestations qu’elle organise et qu’elle pouvait à ce titre interdire « tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande »