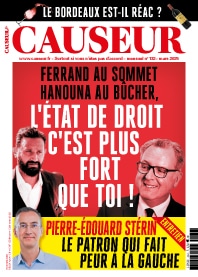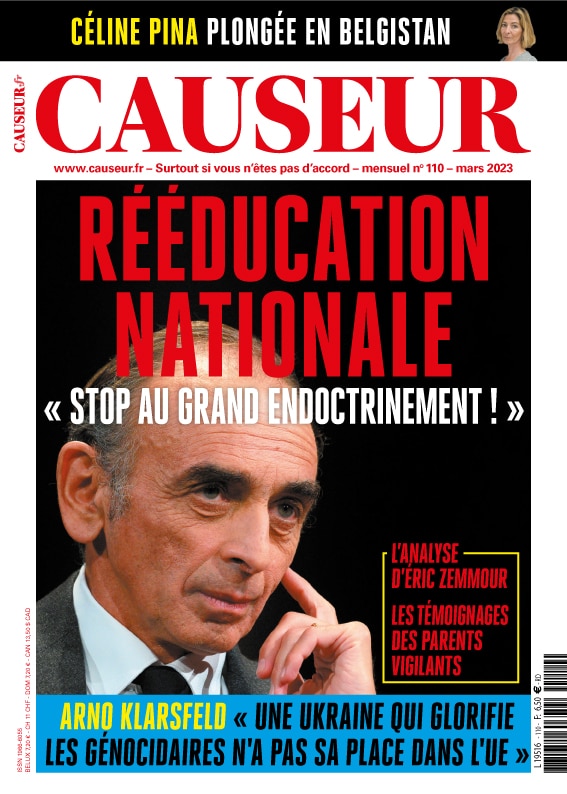Après la chute de l’URSS, nous avons cru à la fin de la guerre et avons créé une armée de maintien de la paix facile à déployer en opérations ponctuelles extérieures. Il faut maintenant reconstruire une armée capable de nous protéger sur notre sol, dans l’éventualité d’une guerre longue et de haute intensité.

Causeur. Au début des années 1990, la chute de l’URSS et la dissolution du pacte de Varsovie ont radicalement changé l’environnement géostratégique de la France. Certains parlaient même de la fin de l’Histoire, des conflits, voire des armées… Quelle stratégie de défense les élites politiques et militaires de l’époque ont-elles décidé de construire à ce moment-là ?
Vincent Desportes. La perception d’un bouleversement profond du monde, mal pris en compte par ailleurs, commence dès 1990, pendant la crise qui a mené à la première guerre du Golfe, à laquelle la France a participé. L’armée française est alors une armée d’appelés, mais le président Mitterrand, reprenant une vieille tradition française, a décidé de ne pas les envoyer se battre à l’extérieur du territoire national. L’armée a donc été obligée de constituer une division avec les soldats professionnels. On tire de cet événement une conclusion forte : notre armée de 300 000 hommes n’est plus adaptée à une situation où nos frontières ne sont plus menacées directement. C’est donc Mitterrand qui casse le modèle. Chirac entérine sa décision et transforme l’armée en armée professionnelle. On perd de vue le fait qu’il puisse y avoir une guerre sur le territoire national. On part d’une vision selon laquelle la guerre « à l’ancienne » n’existe plus et on concentre les efforts sur la construction de l’armée expéditionnaire, capable de conduire de petites opérations ponctuelles à l’extérieur contre le terrorisme ou pour le maintien de la paix, sachant qu’une petite armée comme la française ne sait faire qu’un métier à la fois, surtout quand les budgets de la Défense s’écroulent. On a en conséquence beaucoup de mal à défendre nos chars que tout le monde veut abandonner, car on les juge inadaptés à des opérations à l’extérieur.
Justement, vous avez réussi à conserver les chars : c’est sans doute que tout le monde n’était pas de cet avis.
Bien évidemment. Nous n’avons pas complètement basculé dans l’idée que la guerre à nos frontières ne reviendrait plus. On a conservé un noyau, moins pour l’utiliser que pour ne pas perdre des savoir-faire. C’est grâce à cela que nous possédons aujourd’hui quelque 200 chars, 75 canons,