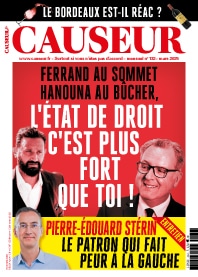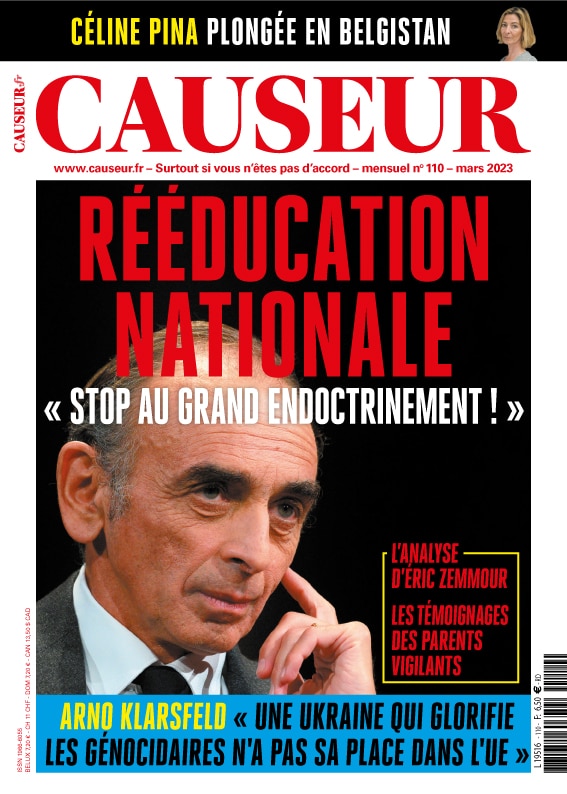Au-delà de la légende de la femme aux amours tumultueuses, de la star de son temps, Colette, dont on fête le 150e anniversaire de la naissance, est d’abord un écrivain de premier ordre. Un tirage spécial de la Pléiade nous le rappelle.
« Colette, c’est de l’eau de bidet ! » Ce jugement d’une grande élégance n’est pas celui d’un des contemporains de Colette, d’un de ces hommes incarnant dans la République des Lettres toute l’horreur de la domination masculine face au succès public de cette femme. Non, on le doit à Marguerite Duras. Comme quoi, on n’est jamais aussi bien haï que par ses pair(e)s. Duras, c’est l’écrivain préféré des professeurs de français, des intellectuels pour qui la littérature est une chose tellement sérieuse qu’elle se doit de refuser au lecteur la jouissance pure, innocente, de l’oubli de soi. Duras, c’est l’écrivain qui instaure une distance permanente et demande sans cesse à être commenté, analysé, célébré. Duras, c’est l’écrivain qui se regarde écrire de manière si ostentatoire qu’elle en devient presque trop facile à pasticher. On se souvient de Patrick Rambaud et de son hilarant Virginie Q. par Marguerite Duraille.
Pasticher Colette, en revanche, c’est beaucoup plus difficile. En 1925, deux ans après la parution du Blé en herbe, alors qu’elle est au faîte de sa gloire, Paul Reboux, pasticheur célèbre à l’époque, préfère, plutôt que s’y risquer, publier la première étude de fond sur son œuvre, Colette ou le Génie du style, lui donnant une légitimité littéraire très précoce, car Colette aborde à peine la seconde partie de son œuvre, celle qu’elle publie enfin sous son nom.
Subversion naturelle
Bref, Duras, c’est l’anti-Colette et ce mépris de Duras est une bonne manière de comprendre, en négatif, pourquoi Colette est une figure majeure de la littérature française de la première moitié du vingtième siècle. Colette, c’est un style qui ne se donne jamais comme style, un style dont le naturel est incroyablement travaillé, mais dont le travail ne se voit jamais, ce qui pourrait être une assez bonne définition du classicisme à la française. Colette est une classique, et une classique réellement subversive, comme tous les classiques. On entend par subversion cette manière de changer notre façon de percevoir, de nous proposer d’autres angles de vision sur un paysage que l’on croyait connu.
A lire aussi, du même auteur: Maigret et Zazie pour la réforme des retraites
La « subversion Colette », c’est une manière inédite d’approcher la réalité par la sensualité, par le plaisir qu’elle est prête à nous donner pour peu qu’on fasse tomber de nos yeux des écailles