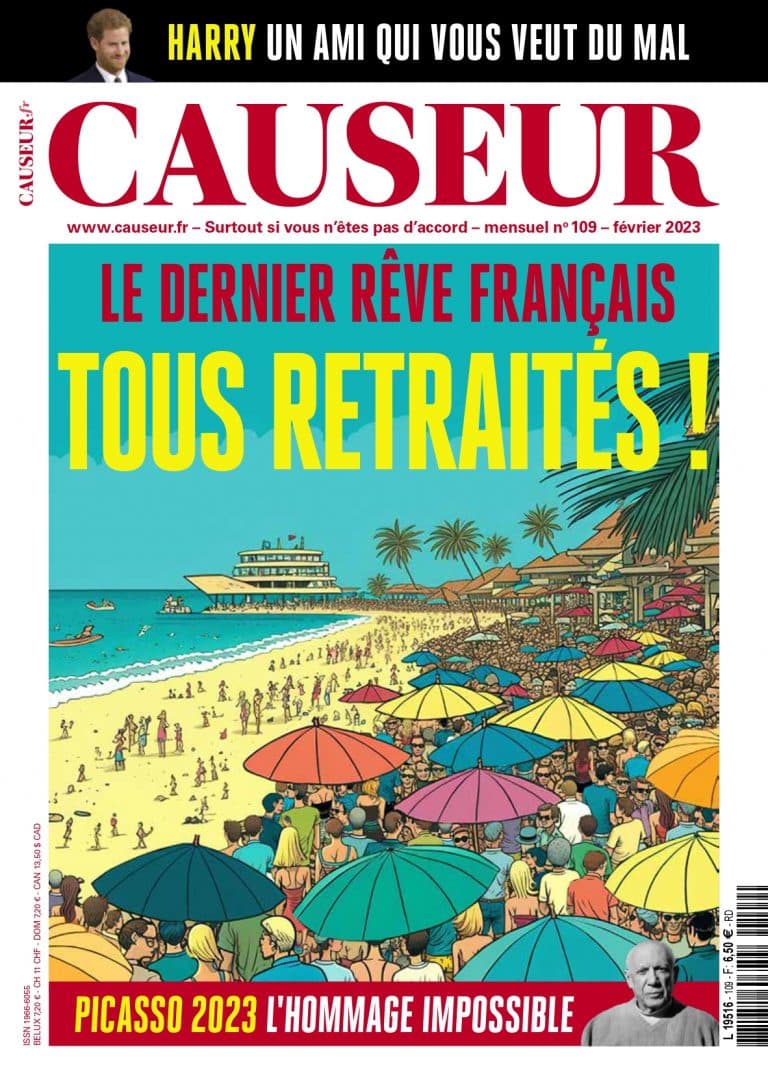À l’origine, notre protection sociale est une assurance universelle financée par tous pour que chacun puisse en bénéficier. Or, depuis les années 1970, elle s’est en grande partie transformée en assistance, voire en assistanat, pour compenser l’inactivité et le déclassement de certains.
C’est un fait politique majeur passé largement inaperçu : la protection sociale se détache progressivement du travail et cette transformation a des conséquences qui sont loin d’être toujours positives.
L’autre élargissement
Pour en saisir tous les enjeux, il faut remonter un peu en arrière, aux fondements de notre État social, c’est-à-dire durant l’entre-deux-guerres et non, comme on le croit souvent, en 1945. Le choc de la Grande Guerre, la peur de l’extension de la révolution soviétique, la nécessité d’atténuer les effets de la crise des années 1930 génèrent un accroissement de la protection sociale, jusqu’alors embryonnaire, et surtout sa réorientation. Alors que des premières lois d’assistance avaient été votées par des majorités de gauche dans les années 1900, la France opte clairement pour une logique d’assurance : l’objectif n’est plus de secourir des individus placés dans une situation de particulière pauvreté, mais de couvrir le plus grand nombre contre les risques habituels de l’existence et d’assurer, à ceux qui en seraient les victimes, le maintien de leur niveau de vie antérieur. Dès 1930, les salariés modestes et moyens bénéficient d’une assurance vieillesse et maladie. En 1932, en réponse à une situation démographique il est vrai catastrophique, les employeurs sont contraints de cotiser à des caisses qui versent à leurs employés des « sursalaires » compensant les charges de famille. En 1938, le dispositif est élargi et revalorisé, l’accent est mis sur le troisième enfant, qui permet le renouvellement des générations : les allocations familiales sont nées. Notons au passage que ces dispositions sont portées par des majorités de droite qui, de Bismarck à de Gaulle et contrairement aux idées reçues, sont souvent à l’origine des avancées de la protection sociale. La création de la Sécurité sociale, en 1945, est une étape importante, mais non décisive. Le gouvernement de la Libération rejette en effet le modèle d’assistance prôné au même moment par William Beveridge au Royaume-Uni et choisit de perfectionner le système déjà existant : le niveau de protection est sensiblement augmenté ; l’organisation administrative, devenue anarchique, est rationalisée ; surtout, la promesse est faite d’étendre à terme l’assurance sociale, qui ne concernait jusqu’alors que les salariés, aux autres catégories professionnelles. Cette promesse sera tenue, en grande partie par le pouvoir gaulliste qui s’installe après 1958, si bien que la construction commencée dans les années 1930 est achevée au début des années 1970. Durant toute cette période, le lien au travail a non seulement été maintenu, mais il a été conforté. Il en découle trois conséquences, aux résonances encore très actuelles.

A lire aussi : Retraites: Elisabeth Borne passe à côté de l’essentiel…
La première tient au mode de financement du système d’assurance, fondé sur la cotisation sociale. On en a aujourd’hui perdu le sens et on considère la cotisation comme une ponction que l’on assimile volontiers à l’impôt sous le terme générique de « prélèvements obligatoires ». En réalité, c’est le contraire : la cotisation sociale n’est pas un prélèvement mais un revenu, intimement lié au travail. On la définissait d’ailleurs traditionnellement comme un « salaire différé », c’est-à-dire une part du revenu qu’on accepte de mettre de côté pour prévenir collectivement la survenance de risque. Cela explique d’ailleurs que seule la cotisation permettait l’ouverture des droits. Cela explique aussi, sur un autre plan, l’hostilité longtemps maintenue d’une partie de la gauche à l’égard de la cotisation et, plus généralement, des assurances sociales. Le Parti communiste ne se rallie à ce modèle que dans la Résistance, jusqu’à en devenir à la Libération, avec Ambroise Croizat, l’un des principaux promoteurs. De façon cocasse, Maurice Thorez dénonçait durant les années 1930 les assurances sociales, en trouvant inadmissible que l’on fasse financer ce système par les travailleurs, tandis que dix ans plus tard, renversant le même argument, il estimait qu’il en allait de la dignité même des travailleurs de participer à leur propre protection. C’est cette ligne que défend aujourd’hui Fabien Roussel quand il soutient le travail contre « la gauche des allocations et des minima sociaux », suscitant, en retour, les cris d’orfraie de ses « camarades » de la Nupes.
La seconde conséquence tient au mode d’organisation de ce système sur une base professionnelle. Les assurances sociales s’accommodent en effet volontiers d’une gestion de ce type. Les réformateurs de 1945 ont laissé subsister, à côté du régime général des salariés, des régimes spéciaux (pour les fonctionnaires, les cheminots, les agents de la RATP…) qui ne seraient pas illégitimes s’ils étaient équilibrés et ne devaient tendre à tout instant la sébile à l’État. De même, l’extension de la Sécurité sociale aux travailleurs indépendants s’est faite sans généralisation dans le cadre de régimes autonomes. Les travailleurs qui en bénéficient sont en général très attachés à ce cadre, qu’à une autre époque on aurait qualifié de corporatiste et qui n’est pas dénué d’intérêt : il permet d’adapter le niveau de protection aux spécificités professionnelles (la retraite n’a pas la même signification pour un travailleur indépendant, qui a constitué un capital tout au long de sa carrière, que pour un fonctionnaire) ; il permet d’associer au plus près les bénéficiaires à la gestion de leur risque (à condition, évidemment, de les responsabiliser) ; il participe, plus largement, à la définition des identités professionnelles (être avocat, c’est certes porter la robe et prêter serment, mais c’est aussi pouvoir gérer son propre système de retraite). Emmanuel Macron l’a oublié en 2019 et cela a probablement causé l’échec de sa (première) réforme des retraites qui prétendait, au nom d’un jacobinisme bureaucratique bien dans l’air du temps, tout uniformiser et, accessoirement, faire les poches aux régimes bien gérés qui avaient accumulé des excédents et constitué des réserves.
A lire aussi : Retraites: et si Macron comprenait ce qui se passe?
La troisième conséquence est la plus oubliée : la Sécurité sociale est, dans l’esprit de ses créateurs, indissociable du plein emploi. Elle n’est pas faite pour compenser les effets de l’inactivité ou du déclassement mais, au contraire, permettre aux travailleurs de maintenir et de compléter les revenus du travail. C’est probablement le changement le plus important avec la situation qui prévaut aujourd’hui. Car depuis les années 1970, sans renoncer encore totalement au système d’assurance qui reste à un niveau satisfaisant, l’accent a été mis sur l’assistance, en total décalage avec l’activité.
De l’assurance à l’assistanat
Les raisons de cette inflexion sont d’abord à rechercher dans l’évolution économique et dans ses effets sociaux. Le ralentissement de la croissance, la désindustrialisation, la difficile montée en gamme de l’économie française dans un cadre de plus en plus mondialisé, une immigration totalement dérégulée ont fragilisé toute une partie de la population et l’ont éloignée durablement du marché du travail. Ces « exclus », comme on les appelle dès les années 1970 (le terme a été popularisé dans un ouvrage pionnier de René Lenoir publié en 1974), sont extrêmement dépendants des transferts sociaux. Des prestations nouvelles apparaissent, comme le RMI, en 1988, tandis que d’anciens mécanismes d’assurance sont totalement détournés de leur but pour solvabiliser les plus pauvres. C’est particulièrement le cas en matière de politique familiale : les prestations ne servent plus que de façon marginale à compenser le coût de l’enfant, ce qui était leur but premier. Elles ont toutes été placées sous conditions de ressources, jusqu’aux allocations familiales proprement dites, placées sous ce régime conditionnel par François Hollande en 2014. Résultat : un effondrement de la natalité. Le même détachement d’avec l’activité se constate au niveau du financement. La cotisation sociale, accusée de peser sur le coût du travail et donc sur la compétitivité, a du plomb dans l’aile. Sa part dans les recettes n’a cessé de diminuer depuis les années 1990, au profit de prélèvements fiscaux, notamment la CSG. Dernier épisode en date : la hausse de 1,7 point décidée par Emmanuel Macron en 2018.
A lire aussi : Crever? Plutôt la retraite!
Car le changement a aussi des causes idéologiques. Depuis les années 1980, le travail n’a plus bonne presse, au pays du ministère du Temps libre, des 35 heures et de la sacralisation des loisirs. Au début de son premier mandat, l’actuel président avait annoncé la couleur : dans une interview au Point d’août 2017, il avait manifesté sa volonté de faire basculer l’ensemble du système social dans un sens « beveridgien », qui correspondait bien à la sensibilité sociale-libérale du nouvel élu. Certes, la dernière campagne a semblé marquer un revirement, quand le candidat a annoncé vouloir subordonner le versement du RSA à une activité minimale, restaurant ainsi, d’une certaine manière, un lien perdu avec le travail. Mais depuis, rien n’est venu. En agissant de la sorte, le chef de l’État avait sans doute vaguement conscience des effets délétères du basculement qu’il appelait de ses vœux cinq ans plus tôt. Car ceux-ci sont nombreux. Sur un plan global, l’assistance est toujours le révélateur d’un échec collectif, le signe d’un dérèglement économique et social. Sur un plan plus individuel, il peut générer une désincitation au travail et donc des trappes à pauvreté : quel est l’intérêt à prendre un emploi si les transferts sociaux vous assurent un revenu à peine inférieur ? Enfin, il produit un clivage dangereux au sein de la société, entre ceux qui financent et ceux qui bénéficient, alors que dans le système d’assurance, beaucoup plus universel, tout le monde finance (selon ses moyens) et tout le monde bénéficie (selon ses besoins). À quoi sert la protection sociale ? Certainement pas à diviser la société et à enfermer les plus pauvres dans l’inactivité mais, comme l’énonçait l’ordonnance créant la Sécurité sociale en 1945, à « débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes ». Pour la droite comme pour la gauche canal historique, le lien avec le travail reste indispensable. Malheureusement, l’une et l’autre semblent avoir perdu la main face à une opinion de plus en plus acquise à l’idée délirante de droits illimités qui permettraient à tous de vivre sans travailler.