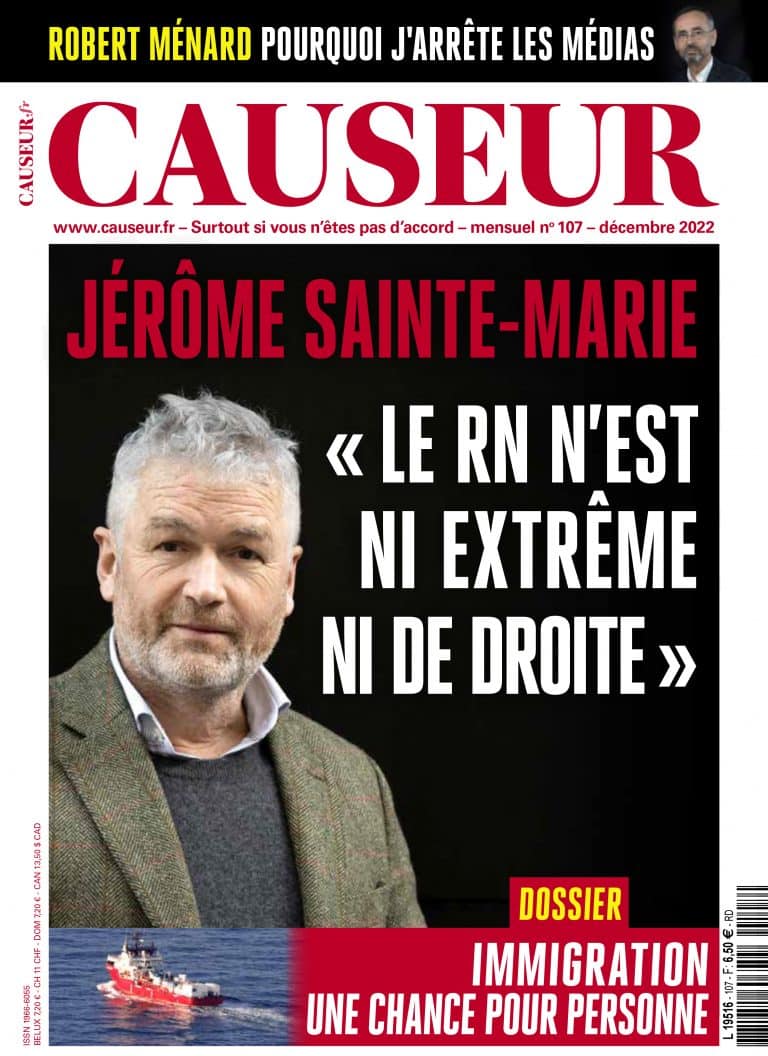Malgré ses 12 étoiles au Guide Michelin, la curiosité, l’audace et l’inventivité du chef Pierre Gagnaire restent intactes. Il continue d’explorer les possibilités que lui offrent les produits du monde entier sans jamais oublier ce qu’il considère comme la base de son métier : le plaisir de ses convives.
Pierre Gagnaire, c’est le chef-artiste, le chef-poète. Ses plats résultent de ses obsessions, de ses recherches obstinées, de ses innovations et de son audace. Mais ce travail acharné reste dans les coulisses. Pour celui qui est à table, n’existe plus que l’émotion, le plaisir des sens. Ce plaisir, Pierre Gagnaire ne l’oublie jamais. Avec ses quelques restaurants, le chef cumule douze étoiles au Guide Michelin. En 2015, il est élu « Plus Grand Chef étoilé du monde » par ses pairs. Contrairement à ce que certains pourraient parfois laisser penser, sa cuisine n’est pas intellectuelle, c’est une cuisine de pulsion, de désir. À sa table, nous redevenons des enfants curieux, et comme des enfants, éblouis, nous découvrons. Il y a l’excellence des produits, bien sûr, mais interprétés par un homme d’exception qui, tel un metteur en scène donnant sa vision d’une œuvre classique sans la dénaturer, nous livre sa version personnelle d’un produit tout en le respectant. Sa cuisine est à l’image de l’homme qu’il est : libre, bonne et généreuse. C’est au Balzac, son bijou de restaurant couronné par trois étoiles, qu’il nous reçoit.
Causeur. La cuisine est-elle une discipline ayant des points communs avec l’art ou est-elle un art à part entière ?
Pierre Gagnaire. C’est la première version qui est juste. La cuisine, c’est de l’artisanat. C’est de la répétition, de la transmission. Mais ce qui rapproche parfois la cuisine de l’art, c’est lorsque quelques personnes – dont je crois faire partie – s’emparent de la cuisine pour exprimer une part d’eux-mêmes. Il ne faut pas opposer art et artisanat. L’artisanat est une chose incroyable, c’est un geste particulier qui est peaufiné, qui est parfaitement construit par la répétition et qui crée le savoir-faire. L’artisanat, c’est la perfection. Mon truc à moi, c’est l’émotion plus que la perfection. Ma cuisine est donc plus art qu’artisanat. C’est mon terrain. Dans la vie, il faut connaître son terrain. Je me suis rapidement aperçu que j’avais une forme de créativité, et répéter une même recette toute une vie ne me convenait pas. J’aime chercher, créer indéfiniment, avec le risque d’erreur que cela induit. La plupart de mes plats, je ne les ai même pas goûtés. Je les ai dans la tête. J’ai des intuitions et goûte mes plats de manière parcellaire, je ne fais jamais de grandes réunions avec dix personnes pour goûter une assiette, la déguster, la découper, l’analyser… ce n’est pas mon truc ! Je préfère la pulsion à l’analyse froide. Et cette espèce de vibration de création, cette ébullition d’idées, les gens la ressentent dans la salle. Ils ressentent que nous, en cuisine, nous ne sommes pas « installés ».
Comment créez-vous un plat ?
L’idée vient souvent d’un produit. Une herbe ou une belle poutargue par exemple… je me dis : « Tiens, comment je peux la mettre en scène ? » Je prends mon cahier, mon crayon à papier et je commence à écrire. J’écris, j’efface, je réécris. Je cherche. J’imagine les autres produits que je vais ajouter dans l’assiette. Je suis mes intuitions, je me projette. Un produit en appelle un autre. Je tire la ficelle. Je tâtonne constamment. C’est du bricolage. Et au fur et à mesure, la recette s’écrit. Il y a quelques jours, j’ai rencontré un type qui fait une merveilleuse eau-de-vie de gentiane. Elle est d’une pureté incroyable. Je n’ai pas encore l’idée, mais je sais que je vais créer un dessert dans lequel elle sera mise en majesté. Voilà comment je fonctionne. C’est pour cela que j’ai besoin de concentration. Je cherche tout le temps. Avant le service, je mange toujours seul. Je veux être tranquille. Je suis toujours inquiet, même quand une recette est prête. La quantité astronomique de détails à gérer pour qu’un plat soit réussi crée de l’angoisse.

A lire aussi : Pierre Gagnaire déplore la disparition de fondamentaux de la “grande cuisine”
Lorsqu’on fait une cuisine de « recherche » comme la vôtre, lorsqu’on va toujours plus loin, comment ne pas perdre le client qui est dans la salle ? Se pose-t-on cette question ?
Non, jamais. Bon, je ne vais pas non plus chercher à faire un menu entier avec des choses dont les gens ne sont majoritairement pas friands, comme les abats par exemple. Il ne faut pas racoler à tout prix, mais on a quand même envie de faire plaisir à celui qui vient manger chez nous.
Les préoccupations liées aux problèmes climatiques sont de plus en plus fortes. Vous souciez-vous du bilan carbone des produits que vous utilisez ?
Je viens d’une ville modeste et d’une famille où l’on ne gâchait pas. J’ai gardé ça. J’achète juste et je sers juste. Beaucoup de cuisiniers gâchaient autrefois. C’est de moins en moins le cas. Par exemple, le turbot était souvent servi en carré. Un turbot n’est pas carré ! Si c’est le cas, ça veut dire que le cuisinier le découpe et jette le reste à la poubelle. Pour moi, c’est hors de question, je n’ai jamais fait ça. Chez moi, tout doit être utilisé. Dans mes restaurants, il y a une forme d’explosion, d’abondance, c’est vrai. Mais tout est utilisé, on ne jette rien. En revanche, je ne vais sûrement pas me priver d’un beau produit qui peut alimenter ma créativité parce qu’il vient d’Espagne ou d’Italie. Je suis sensible aux problèmes climatiques, et étant moi-même obsédé par le gâchis de l’eau, je comprends que les gens soient préoccupés par le bilan carbone. Mais pour être irréprochable, je mets tout mon cœur à travailler le produit qui vient de loin, à le sublimer. C’est-à-dire que si j’ai rendu hommage au produit, que celui qui mange le plat passe un moment de grand plaisir et que cela lui laisse un souvenir, cela aura alors valu la peine de le faire venir de loin. C’est mon engagement à moi. Faire en sorte que le produit ne soit pas venu pour rien.
Quelle est la part de tradition dans votre cuisine ?
Elle est très forte ! Ma cuisine est innovante, certes, mais elle se fonde sur un savoir-faire et une histoire français, sur des bases patrimoniales. La cuisine italienne est très bonne, mais il n’y a pas toutes les sauces que nous avons, ni les modes de cuisson. Notre pays a une culture gastronomique immense, avec des écoles et des traditions solides. Et puis le vocabulaire culinaire français… C’est d’ailleurs intraduisible ! Faire rissoler, pincer, sertir, singer. J’innove, je recherche bien sûr, mais en m’appuyant inconsciemment sur cette longue et riche histoire. D’ailleurs, je crois qu’il nous serait impossible de cuisiner en faisait fi de cette tradition. Que nous le voulions ou non, nous en sommes imprégnés.
Vous avez beaucoup de respect pour Paul Bocuse mais, ce n’est pas sa cuisine qui vous intéresse. Est-ce parce que, chez lui, il n’y a que la tradition et pas la recherche ?
Bocuse avait quelques plats qu’il réalisait parfaitement. C’était très bon, mais c’était toujours les mêmes. Gratin de queues d’écrevisses, loup en croûte, rougets en écailles, sole au champagne… autant de plats qu’il avait souvent appris dans le passé mais cette répétition perpétuelle n’était pas ce que je voulais faire. On en revient à ce que je disais sur l’artisanat. Cependant, j’aimais l’homme. C’était un personnage de roman qui fascinait le monde. Il avait un charisme incroyable. Et c’était un homme très généreux qui aimait profondément les gens, malgré sa mauvaise foi légendaire.

A lire aussi : Cauchemar en cuisine
Selon vous, la cuisine doit-elle réconforter ou déranger ?
Un peu les deux ! Mais elle ne peut pas uniquement venir déranger. Il faut qu’il y ait du plaisir, de la tendresse. Ferran Adrià, par exemple, le chef espagnol maître de la cuisine moléculaire, n’a duré qu’un temps. C’était une expérience intéressante, mais on n’avait pas forcément envie d’y retourner alors qu’il était un génie. À l’époque, la presse américaine l’encensait et dézinguait la cuisine française. Nous, on passait pour des ringards. Mais finalement, ça s’est rééquilibré. La cuisine française garde une place d’exception et continue de rayonner dans le monde entier.
Dans vos restaurants, le rituel est-il important ?
Oui, évidemment. Mais ce rituel n’est pas austère. Il est lumineux, car il est teinté de courtoisie, de chaleur, de gentillesse. L’accueil et le plaisir de recevoir sont très importants. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs souvent un problème. On perd un peu cela, parfois, dans les métiers de service. Ces métiers demandent de l’abnégation. Ils demandent de s’occuper de l’autre et de s’oublier un peu. C’est très important de s’oublier pour faire plaisir aux autres. Faire plaisir, c’est une des bases de notre métier, on ne doit jamais l’oublier.
La gastronomie, c’était mieux avant ou c’est mieux maintenant ?
On mange vraiment mieux aujourd’hui qu’il y a trente ans ! La cuisine est plus digeste, on utilise beaucoup plus de légumes. Elle est aussi plus variée, plus créative et plus belle. Les produits du monde entier ont enrichi notre cuisine. Les viandes, les légumes, les épices… c’est une richesse extraordinaire ! Et pour nous les cuisiniers, c’est beaucoup moins dur aujourd’hui. Les cuisines sont mieux éclairées, mieux ventilées, le matériel est moins lourd. Autrefois, il faisait plus de soixante degrés dans certaines cuisines. Techniquement, nous travaillons dans de meilleures conditions. La reconnaissance est plus grande aussi. Regardez, par exemple, il y a vingt ans, vous ne vous seriez jamais intéressé à un cuisinier. Aujourd’hui, on nous porte un réel intérêt. Et je trouve cela assez justifié. Ici, au Balzac, les gens passent souvent un moment dont ils se souviendront. Pendant trois heures, nous leur offrons une parenthèse avec des plats d’exception bien sûr, mais également avec une sélection très pointue de vins, de pains ou encore de cafés. Il y a la mise en scène de la table et le service, avec un rythme pensé pour le confort des convives, la vaisselle est aussi choisie avec la plus grande attention. Ce sont les arts de la table… Nous créons un moment d’ivresse dans lequel les convives vont pouvoir se perdre. Et des années après, ils se souviennent des émotions qu’ils ont éprouvées chez nous. Ce n’est pas rien, franchement, une telle parenthèse. Surtout si l’on en repart avec le souvenir ému.
A lire aussi : [Reportage à Nangis] Ma première burqa
Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire de notre ami, l’architecte Rudy Ricciotti. Avec lui, vous produisez un vin. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette cuvée « Gary » ?
Un jour, à Marseille, j’ai visité le Mucem. Là, j’ai été bouleversé par ce bâtiment, cet édifice. À l’heure à laquelle j’y suis allé, dans la lumière qu’il faisait, c’était d’une beauté époustouflante. J’ai pleuré. J’ai absolument voulu rencontrer le type qui avait construit ça ! La rencontre s’est faite et nous nous sommes tout de suite entendus. Un jour, avec Rudy, j’ai bu un châteauneuf blanc magnifique. Il m’a dit que c’était le vin de son cousin et l’idée est vite venue d’en racheter une parcelle. Depuis ma faillite à Saint-Étienne, il y a trente ans, je ne suis plus propriétaire de rien, alors l’idée de posséder un petit lopin de vigne m’a beaucoup plu. On a gardé le vigneron, c’est lui qui fait notre vin. On n’a pas acheté une vigne, on a acheté une œuvre d’art : le châteauneuf-du-pape est un vin très typé, avec des notes de cerise et de cassis, il est à la fois très expressif et très délicat. Sincèrement, c’est une merveille.

La question de David Belugou
Cher Pierre Gagnaire, pouvez-vous nous dire quelques mots du costume de cuisinier ?
Ah ! Ça, c’était mieux avant ! Autrefois, les vestes étaient faites en coton d’Égypte. Le touché était incroyable. Aujourd’hui, ce n’est plus la même qualité. Mais j’aime beaucoup nos vestes, elles ont quelque chose de solennel. Ce que je préfère dans mon costume, c’est le tour de cou. Ce petit foulard noué donne beaucoup d’allure, c’est très élégant. Et il nous protège du chaud et du froid. En revanche, il y aurait un effort à faire sur les pantalons et les chaussures, ils ne sont jamais très beaux. Une autre chose sur laquelle je suis très à cheval, c’est que le costume soit blanc, et pas noir comme on le voit de plus en plus souvent. Je préfère le blanc. C’est net, immaculé, pur. Avec le blanc on ne triche pas, c’est en accord avec ce que j’essaie de faire dans ma cuisine.