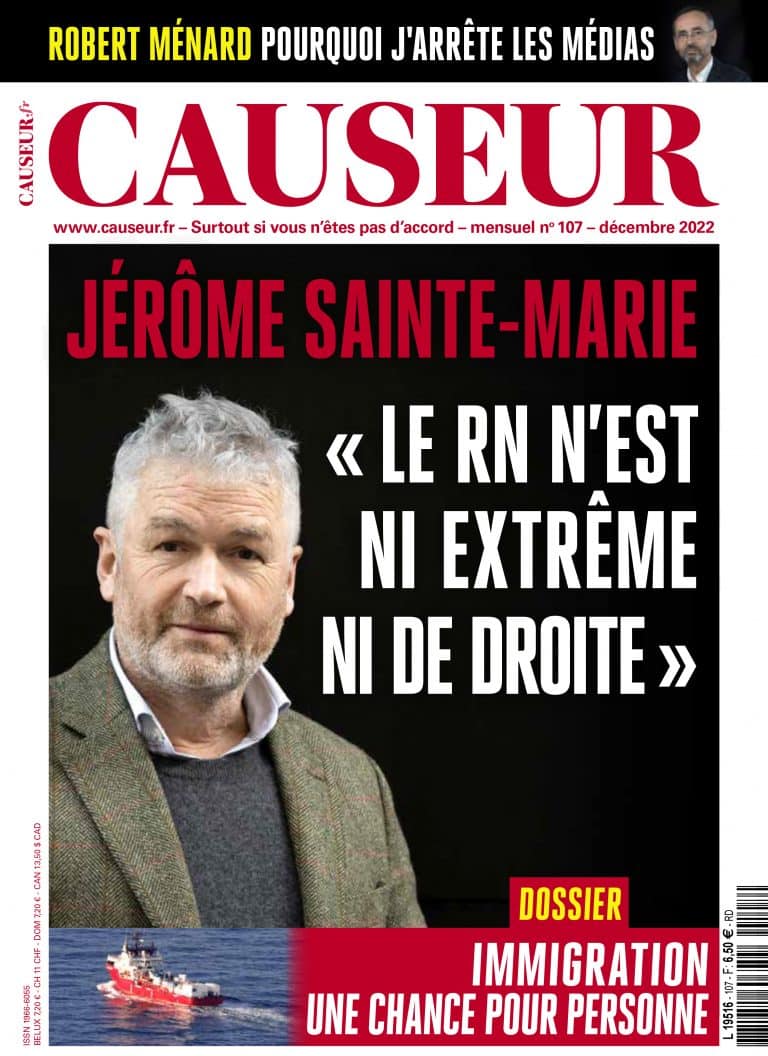Dans son nouveau livre, Chaos, Stéphane Rozès analyse les causes de la défiance des peuples envers leurs élites et celles de la montée des extrêmes. Loin de défendre des intérêts nationaux, les technocrates qui nous gouvernent légitiment des décisions prises ailleurs et par d’autres, et bafouent l’idéal démocratique dont ils se réclament.
Causeur. Le titre de votre nouveau livre, Chaos, a de quoi inquiéter venant d’un observateur averti tel que vous, ancien sondeur et conseiller de présidents. Alors qu’on nous a vendu pendant des décennies la mondialisation comme un facteur de paix et l’Europe comme l’avenir des nations, la construction européenne ne fait plus rêver et la mondialisation fait revenir la guerre sur le devant de la scène. Pourquoi ?
Stéphane Rozès. Nos dirigeants ont simplement oublié l’essentiel et ont cru pouvoir substituer au politique et à ses aléas l’économique et ses process maîtrisés. Ils ont juste oublié que ce sont les peuples qui font l’histoire. Les communautés humaines ne sont pas mues fondamentalement par la prospérité, mais par la volonté de maîtriser collectivement leur destin. Chacune d’entre elles a une façon singulière d’être au monde, de penser et de faire. Chaque peuple est habité par un imaginaire commun qui lui permet de s’approprier le réel au travers de représentations, de symboles, d’institutions. Cela lui permet d’intégrer les changements. D’où le sous-titre de mon livre « Essai sur l’imaginaire des peuples ». C’est cet imaginaire, fonctionnant comme un véritable creuset culturel, qui crée le commun et le génie particulier de chaque peuple. C’est lui qui fait tenir ensemble les hommes.
Est-ce que ce sont les atteintes à ces imaginaires qui engendrent le chaos identitaire que nous connaissons ?
Pour moi, l’existence d’une civilisation s’explique par une forme de cohérence entre l’imaginaire des peuples et la façon dont ceux-ci participent à la marche du monde. En revanche, si on constate une déconnexion, si les peuples ont le sentiment de ne plus avoir de choix, ils sont alors rattrapés par des archaïsmes anthropologiques où l’on se rassure sur ce que l’on est en s’affrontant à l’autre. L’interdépendance entre les peuples, que les fondateurs de l’Union européenne voyaient comme une garantie de la paix, ne suffit pas à éviter la violence et la guerre, si ces peuples ont le sentiment d’être dépossédés de toute prise sur leur avenir.
Comment décririez-vous l’imaginaire français ?
Notre pays a toujours été un archipel. Nous sommes un cul-de-sac du continent européen, une queue de comète de fins d’invasions diverses (Celtes, Latins,