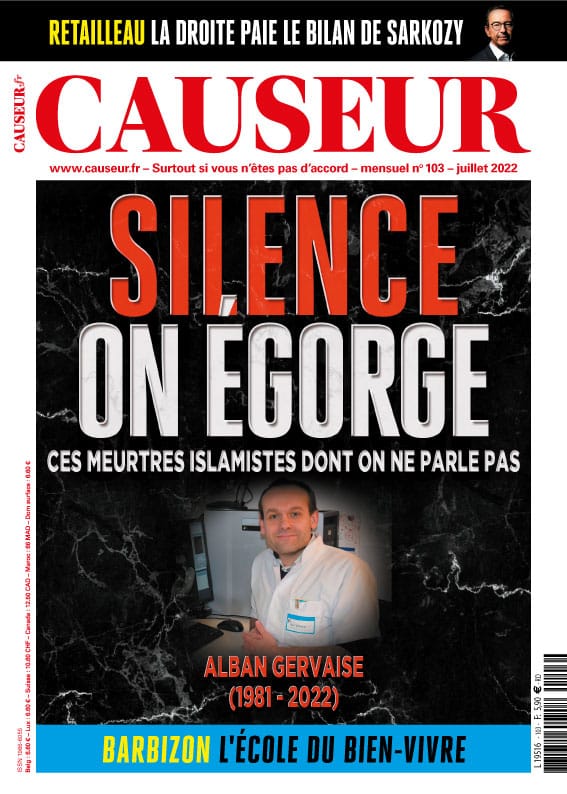Lorsqu’on n’est pas végétarien, on a le devoir de manger des animaux d’élevage. C’est la thèse du philosophe Nick Zangwill qui estime que ces espèces modifiées par l’homme sont incapables de vivre sans lui. Leur destin est de finir dans nos assiettes.
Avons-nous le droit de tuer et de manger des animaux ? En posant cette question, on peut s’attendre à être enseveli sous une avalanche, non seulement de réponses négatives stridentes, mais aussi de réprobations haineuses pour avoir osé la poser. Car, en dépit du fait que la vaste majorité des êtres humains reste carnivore, la scène médiatique est occupée par des idéologues pour lesquels avaler un steak constitue un vice faisant partie d’un ensemble de péchés cardinaux dont les carnivores seraient coupables : la cruauté envers les animaux, la destruction de la planète, la promotion du capitalisme néolibéral et le maintien du patriarcat.
Un philosophe britannique, Nick Zangwill, vient de jeter un pavé dans la mare en publiant deux articles qui soutiennent que nous devons manger de la viande. Notez bien que c’est une question non de permission mais de devoir : nous avons une obligation envers certains animaux de les manger. L’accueil réservé à ces publications n’a pas été des plus chaleureux.
Des animaux bien élevés
Chercheur à l’University College London, Zangwill présente son argument dans deux articles publiés en 2021, l’un dans une revue universitaire et l’autre dans Aeon, un magazine culturel qui connaît un succès considérable dans le monde anglophone[1]. La thèse qu’il y défend est que les êtres humains héritent d’une obligation qui leur est imposée par le fait que leurs ancêtres ont passé des millénaires à élever certaines espèces animales expressément pour la consommation. Nous devons perpétuer ce système car si vaches, porcs, moutons et poulets existent aujourd’hui en si grand nombre, c’est uniquement grâce à l’homme. Certes, la motivation d’origine était égoïste, puisqu’il s’agissait de s’en nourrir, mais il y a une contrepartie : l’homme les a protégés des dangers de la vie sauvage et, la plupart du temps, leur a garanti une vie relativement confortable. Aujourd’hui, ces animaux ne pourraient pas survivre si on les relâchait dans la nature. D’où notre devoir de prolonger cette relation symbiotique qui est mutuellement bénéfique.
A lire aussi, Françoise Bonardel : De l’écologie à l’écosophie
Une première objection est que l’élevage industriel impose aux animaux des souffrances qui violent ce pacte implicite entre l’homme et la bête. Du reste, Zangwill est critique à l’égard de l’agriculture industrialisée qui ne nous libère pas de notre obligation envers ces espèces, pas plus qu’il ne nous empêche de les manger, mais nous force à améliorer leurs conditions de vie. Il cite l’exemple des millions de moutons en Nouvelle-Zélande qui paissent tranquillement dans un véritable sanctuaire à l’abri du stress et du carnage que connaissent les gazelles en Afrique. Regardez quelques heures une de ces chaînes télévisées consacrées à la vie des animaux et vous verrez une véritable boucherie de bêtes trucidées, déchiquetées et dévorées par des lions. Le cinéma gore y prendrait quelques leçons.


Une autre objection est que la mise à mort des animaux ne peut pas justifier leur élevage même dans des conditions de confort relatif. Certes, notre devoir est d’abattre nos bêtes de la manière la plus indolore possible, mais ceux qui ne parlent que de la souffrance des animaux ignorent le fait que ces derniers peuvent connaître aussi le plaisir. Les êtres humains connaissent et la douleur et le bonheur, mais on ne dirait pas que leur vie n’a pas de sens parce qu’ils ont souffert. Un animal, bien que destiné à être abattu un jour, peut connaître entre-temps une vie épanouie.
La doxa végane
Si les bêtes peuvent connaître le bonheur, ne sont-elles pas comme nous et ne devons-nous pas leur accorder les mêmes droits que ceux que nous accordons à l’homme ? Les thuriféraires de la doxa végane, comme Aymeric Caron ou Hugo Clément, n’hésitent pas à attribuer le même statut à tous les êtres vivants, en restant assez vagues sur des distinctions à faire entre eux. Pour Zangwill, la continuité évidente dans le vivant, des bactéries à l’homme, n’empêche nullement d’y voir différentes catégories selon les capacités des espèces à sentir, à penser et à raisonner. Ces différences nous imposent des obligations variables. Les animaux domestiqués sont suffisamment doués d’une certaine conscience pour apprécier leur qualité de vie, mais ils n’ont pas la capacité humaine de raisonner sur leur destinée et nous pouvons les abattre. En revanche, les singes supérieurs peuvent raisonner et nous devrons les laisser vivre. Pour Zangwill, il y a un point d’interrogation sur les porcs, que seule la recherche scientifique pourra résoudre. Dommage peut-être pour le petit-déjeuner anglais.
A lire aussi : La vraie solution à la crise climatique
C’est précisément cet effort pour faire des distinctions qui scandalise les zélateurs des droits des animaux comme Caron, qui y voit une forme de « discrimination ». Dans son livre de 2016, Antispéciste, il s’indigne de l’incohérence entre les traitements que nous réservons aux vaches, que nous dévorons avec plaisir, et aux chiens que les Occidentaux ne mettraient jamais dans une casserole. Zangwill a une réponse. Les chiens ont été élevés par l’homme pour servir à d’autres fonctions, notamment celle d’animal de compagnie. Il n’y a donc pas le même contrat implicite entre nous et eux. Selon d’autres objections, si on peut élever des animaux pour les manger, on pourrait faire la même chose avec des esclaves humains ou des handicapés mentaux, mais Zangwill répond que tous les êtres humains possèdent des droits que n’ont pas tous les animaux.

Les diatribes des végans s’alimentent à deux sources. La première, c’est le philosophe australien, Peter Singer, un spécialiste de l’éthique respecté pour la cohérence de ses raisonnements et son absence de fanatisme. C’est son livre de 1975, La Libération animale, traduit en français en 1993, qui a vulgarisé le terme « spécisme », inventé cinq ans auparavant par un psychologue, Richard Ryder, sur le modèle de « racisme » et de « sexisme », afin de désigner le refus de traiter toutes les espèces de la même manière. Mais Singer, qui a exercé une influence sur Zangwill, fait des distinctions entre les êtres vivants et, bien que végan, mange parfois certains fruits de mer et produits laitiers.
L’autre source est Carol J. Adams, américaine, pionnière de l’écoféminisme et militante de la cause animale. En 1990, elle publie un livre très remarqué, traduit en français en 2016 sous le titre, La Politique sexuelle de la viande. Selon elle, il y a une symétrie entre la façon dont les hommes objectivent les femmes pour les exploiter sexuellement et la façon dont ils objectivent les animaux pour les consommer. La viande incarne la domination masculine. Une seule et même révolte doit mettre fin à la consommation de la chair animale, au sexisme et au viol de la nature par le capitalisme. C’est Adams qui est largement responsable de l’assimilation de la lutte contre la viande à ces autres luttes et de la confusion qui existe aujourd’hui entre leurs justifications. C’est dans cette fourmilière-là que Zangwill a mis un sacré coup de pied.
L’homme, être rationnel parfois
Les premiers commentaires postés sur le site d’Aeon, en réponse à la publication de Zangwill, refusent péremptoirement les arguments du philosophe et expriment détresse et colère devant la publication d’un tel texte. Un grand nombre de posts sont censurés par le site, l’émotivité des auteurs dépassant sans doute les bornes de la décence. Certains traitent Zangwill de troll agissant par pure méchanceté. D’autres sont d’avis qu’il s’agit d’une parodie pour faire rire ou d’une satire dans le style de Swift, l’auteur de la Modeste proposition de 1729 qui, de manière ironique, suggérait de réduire la misère des familles irlandaises en les encourageant à manger leurs enfants.
A lire aussi, Didier Desrimais : Après AgroTechParis, le wokisme gagne l’École nationale supérieure d’architecture
Quand des objections sont formulées, elles se fondent sur une confusion typiquement écoféministe entre la légitimité de la consommation de viande en tant que telle et les conséquences de sa production pour l’environnement. Zangwill maintient que nous avons une obligation morale de manger des bêtes tout en acceptant que nous devons pallier les effets écologiques de l’élevage. Si un jour les progrès de l’agriculture cellulaire permettent à tous de manger de la viande cultivée in vitro, notre devoir envers ces animaux – consistant à les élever et à les manger – restera inchangé.
À la différence des idéologues, le philosophe cherche à raisonner en termes de droits et de devoirs. C’est ainsi qu’à la différence de Roger Scruton – une autre influence importante – , il tient la chasse pour problématique, car nous ne partageons pas la même co-évolution historique avec le gibier qu’avec vaches et moutons. Zangwill est-il aussi intolérant que ses adversaires végans ? Non, car nous ne sommes pas tous obligés de manger de la viande : il suffit qu’une minorité endosse ce lourd devoir. C’est la raison qui nous distingue de la majorité des bêtes, mais l’homme se montre rarement raisonnable.
[1] « Our Moral Duty to Eat Meat », Journal of the American Philosophical Association ; « Why You Should Eat Meat », Aeon.
Politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane
Price: 129,00 €
6 used & new available from