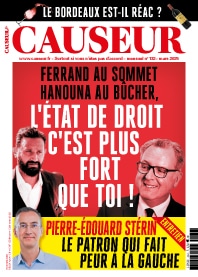L’écologie s’oppose au modèle occidental: comment «sauver la nature» en défendant le transhumanisme et la surconsommation? En respectant les êtres vivants comme ses semblables, l’être humain fera un geste pour l’environnement.
L’écologie telle qu’on la pratique aujourd’hui est-elle dans une impasse ? Les discours et comportements qu’elle inspire la montrent en tout cas traversée par des contradictions qui sont pour une grande part celles du monde actuel dont il lui faudrait, pour être fidèle à elle-même, changer radicalement le logiciel : ce qu’ambitionne de faire l’écosophie en tant que « sagesse de l’habiter », théorisée par Félix Guattari (Les Trois Écologies, 1989) puis par Michel Maffesoli (Écosophie, 2017). Or, à force de sonner le tocsin en prévision d’une apocalypse environnementale dont personne ne peut dire avec certitude si elle aura lieu ni dans quels délais, on est en train de perdre de vue que l’« environnement » ne se réduit pas pour l’homme à la nature, dévastée ou sanctuarisée ; et que l’écologie est justement censée apporter une connaissance avisée de ce qu’il conviendrait de faire, à titre individuel et collectif, pour préserver les liens vitaux entre les êtres vivants et leur « habitat », proche ou plus lointain selon l’extension reconnue à la biosphère.
À force aussi d’inciter les citoyens de tous les pays à se montrer « écoresponsables » en triant leurs déchets, en économisant l’eau et en mangeant bio (s’ils en ont les moyens financiers), tout en dénonçant comme il se doit l’indifférence ou le cynisme des pollueurs et des profiteurs, on est en passe d’oublier que l’écologie est, selon Ernst Haeckel et au sens large du terme, « le savoir des conditions d’existence ». Constituant de ce fait même l’axe et le moteur de tout grand projet anthropologique et civilisationnel, elle ne saurait se limiter à une contre-culture protestataire. Si utile soit-elle quant aux menaces réelles qui pèsent sur l’environnement, la dénonciation permanente risque même de devenir l’arbre qui cache la forêt. À défaut qui plus est de porte-parole qui