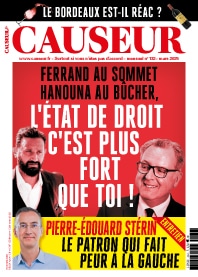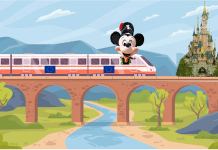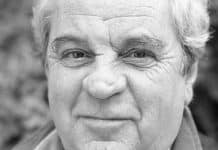Barcelone doit à Antoni Gaudí un parc, des immeubles, des villas et, bien sûr, la Sagrada Família, cathédrale toujours en construction. La renommée de cet architecte peine cependant à franchir les frontières. Une exposition au musée d’Orsay explore une œuvre mécomprise.
Antoni Gaudí naît en 1852 à Reus, ville sise à 100 kilomètres au sud-ouest de Barcelone. Adolescent, il gagne la capitale catalane pour y faire ses études d’architecture. Ensuite, il devient architecte et ne quitte guère cette cité jusqu’à ce qu’il y meure en 1926, renversé par un tramway. Sa biographie est aussi simple que cela.
Issu d’une famille de chaudronniers, il se singularise par un parti pris manuel. Il fait des maquettes, des moulages, il tâtonne, il assemble, il regarde ce que ça donne, il imagine, il recommence. Son art n’est en rien l’application d’idées. Gaudí travaille avec ses mains et avec ses yeux, « sans concept » comme dirait Kant. On lui prête un anti-intellectualisme assumé.
Casanier et traditionaliste
Gaudí apparaît aujourd’hui comme l’une des figures de proue de ce mouvement international né au tournant du xixe siècle et qualifié, selon les pays, d’Art nouveau, de Jugendstil, de Sécession et, en Catalogne, de « Modernisme » (à ne pas confondre avec la notion de modernité). Chose surprenante, Gaudí n’est guère sorti de sa ville. Cependant, son tempérament extraordinairement casanier n’est en rien un obstacle à sa curiosité et à son ouverture d’esprit. En effet, il parcourt attentivement certains livres, notamment ceux de Viollet-le-Duc. Cet architecte français, encore souvent décrié dans notre pays, est porteur d’idées extrêmement fécondes. À force d’étudier l’art gothique et l’art roman, il s’affranchit d’une vision académique rivée sur la tradition du Grand Siècle et développe le sens des linéaments, des décors végétaux, de la diversité des matériaux, de tout