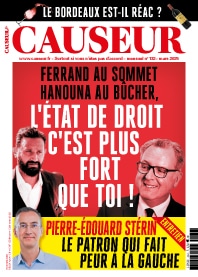Jean-Luc Mélenchon a réussi à transformer une défaite électorale en une victoire politique et médiatique. C’est que le signifiant «gauche» n’a pas perdu son pouvoir de séduction, indépendamment du référent qu’il désigne. Mais la mélenchonisation des esprits ne s’arrête pas aux frontières de la Nupes comme le montre la nomination de Pap Ndiaye à l’Éducation.
L’élection présidentielle s’est déroulée selon le scénario attendu et éculé. Mais la surprise est venue de là où on ne l’attendait pas. Nous nous étions habitués à penser (sans déplaisir excessif pour ma part) que la gauche était dans les choux et que la droite, voire le camp souverainiste, avait gagné la bataille des idées. Certes, la gauche ne totalise qu’un tiers des voix, ce qui signifie que deux tiers des Français sont, sinon de droite, « pas-de-gauche ». N’empêche, pour un tiers de nos concitoyens, le signifiant « gauche » continue à avoir des vertus quasi magiques, indépendamment du référent qu’il désigne. En effet, bien avant que l’union soit réalisée entre les appareils sous la houlette du Lider Maximo, les électeurs la réclamaient à cor et à cri – raison pour laquelle je leur en veux, même à mon très cher Jérôme Leroy (pages 64-66 de notre magazine), car entre l’islamo-gauche, le communisme à l’ancienne de Fabien Roussel et la gauche laïque, il y a plus que des nuances : des visions antagonistes du monde et de la société. Et pourtant, 80 % des électeurs de gauche approuvent un accord idéologiquement contre-nature. Quant aux dirigeants, ils ont recommencé à psalmodier le