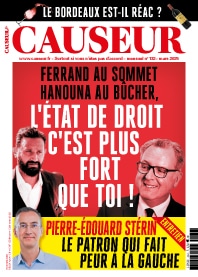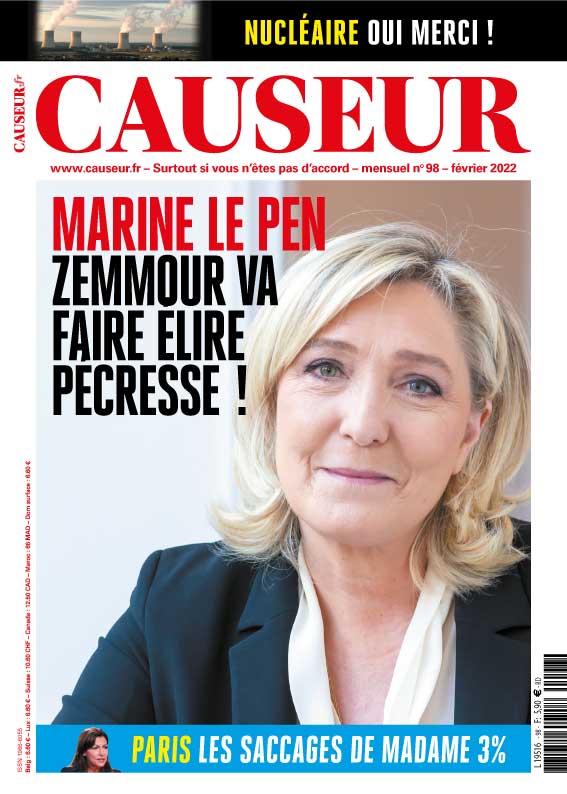Les 7 et 8 janvier, un colloque organisé conjointement par l’Observatoire du décolonialisme, le Collège de philosophie et le Comité Laïcité République s’est déroulé à la Sorbonne. Son titre « Après la déconstruction : reconstruire les sciences et la culture ». Anne-Marie Le Pourhiet [1] a pointé les dérives coupables de l’université et des académies. Nous publions son intervention.
Les outils juridiques d’une « reconstruction » scientifique existent déjà. Il convient seulement d’appliquer effectivement les règles qui régissent le service public de l’enseignement supérieur et encadrent la liberté académique, aujourd’hui bafouées dans plusieurs disciplines. Mais il faut aussi que les pouvoirs publics cessent leur double jeu en s’abstenant de prescrire, encourager, promouvoir et financer les dérives constatées dans le monde académique.
La liberté académique: une notion juridique définie et encadrée
Examinant, en 1984, la « loi Savary » relative à l’enseignement supérieur, le Conseil constitutionnel a déduit du préambule de la Constitution un principe d’indépendance des universitaires, garanti par un statut qui peut limiter la liberté d’expression « dans la seule mesure des exigences du service public ». Les dispositions de cette loi ont été reprises dans le Code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. » (Article L141-6.) « Les enseignants-chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et dans leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d’objectivité. » (Article L952-2.) C’est donc parfaitement clair : l’objectivité est le principe cardinal de l’activité scientifique.

Le Conseil de l’Europe a adopté en 2006 une recommandation relative à la liberté académique, qui reprend les principes de la Magna Carta Universitatum adoptée à Bologne en 1988 et affirme que la liberté académique doit garantir la liberté de rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité.
A lire aussi: [Vidéo] Causons! Colloque anti-wokiste à la Sorbonne
Citons enfin la recommandation de l’Unesco concernant « la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur », adoptée en 1997. Se déclarant « préoccupée par la vulnérabilité de la communauté universitaire à l’égard des pressions politiques indésirables qui pourraient porter atteinte aux libertés académiques », l’Unesco affirme que les universités « sont des communautés d’érudits qui ont pour mission