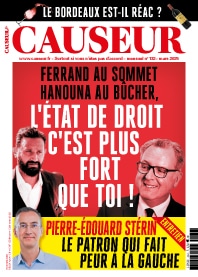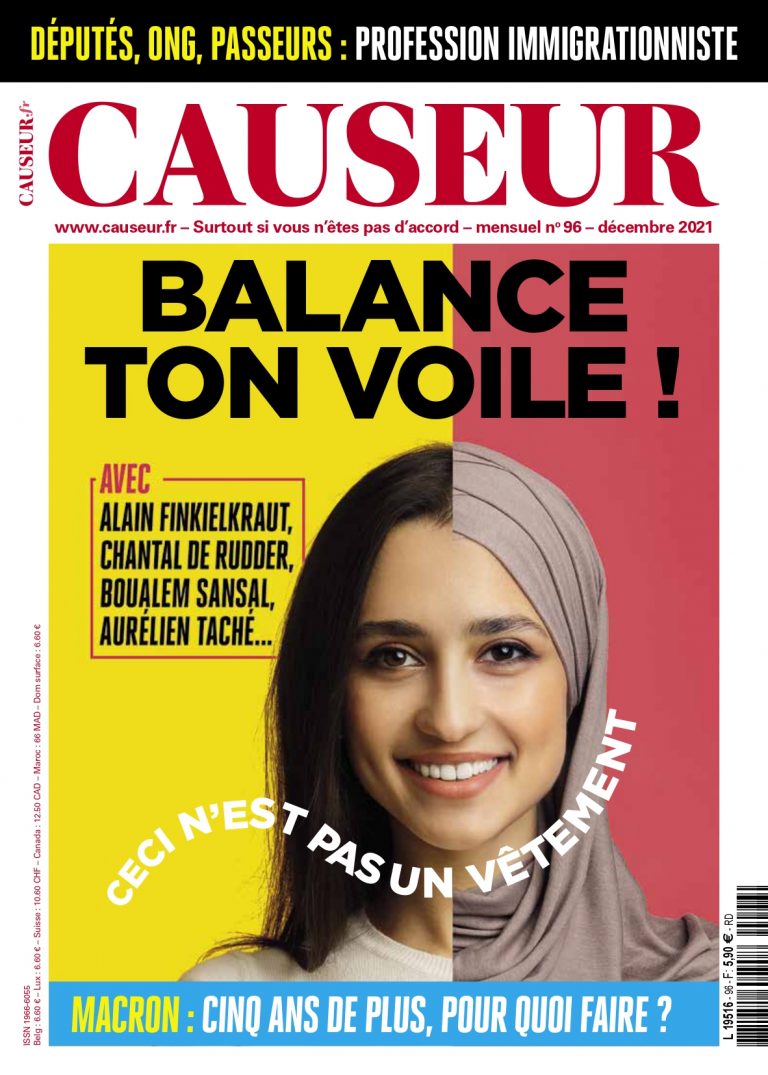Tous les sondages [1] prédisent la réélection du chef de l’État en avril prochain. La révolution qu’il avait annoncée n’a pourtant pas eu lieu. Comme ses prédécesseurs, il a défendu une Europe ouverte à tous, un « pognon de dingue » pour les aides sociales et le progressisme culturel. Le candidat de 2022 ne pourra pas faire les mêmes promesses que celui de 2017.
Emmanuel Macron apparaît indiscutablement en cet automne comme le principal favori de la prochaine élection présidentielle. Avec plus de 40 % d’opinions favorables, il bénéficie d’une cote de popularité très supérieure à celle qu’affichaient, à la même époque, ses deux prédécesseurs (31 % pour Nicolas Sarkozy, 16 % pour François Hollande, Odoxa, octobre). Les sondages prédisent une victoire nette du président sortant quel que soit le concurrent qu’il affronterait au second tour [1], avec un score autour de 57 % contre Éric Zemmour, 55 % contre Marine Le Pen et 53 % contre Xavier Bertrand (Harris Interactive, 20 octobre). Son pire adversaire, c’est lui-même, ou plutôt son identité politique pour le moins problématique.
A lire aussi, Laurence Trochu: “Eric Zemmour s’est engagé à remettre en cause la PMA sans père, mais la loi Taubira n’est pas une priorité”
Un homme de foi
Qui est Emmanuel Macron ? Depuis cinq ans, le Fregoli de l’Élysée entretient sur son compte et sur le courant qu’il veut incarner à lui seul un flou pour le moins artistique, venant de la gauche et draguant à droite, oscillant sur les mêmes sujets entre les positions les plus diverses, théorisant le dépassement et le « en même temps » comme panacée politique. Si l’on veut bien dépasser cet épais brouillard tactique, son positionnement est toutefois assez clair… et probablement inadapté aux futures échéances. Car les trois éléments qui le caractérisent sont en effet en situation de crise avancée.
Emmanuel Macron, c’est d’abord la foi indéfectible dans les bienfaits du libre-échange et de la construction européenne. Il est le meilleur représentant de cette élite nouvelle qui mesure les progrès de l’humanité aux volumes des flux circulant en tous sens et fait de la frontière une survivance archaïque. C’est cette croyance presque religieuse qui l’a conduit par exemple, au début de l’épidémie de Covid, à retarder autant qu’il l’a pu les contrôles à l’entrée du territoire, tandis que ses ministres répétaient en boucle cette fausse évidence : « Les virus n’ont pas de passeport. »
De même, le président, sans aller jusqu’à un fédéralisme affiché, est-il convaincu que les vieilles nations ne disposent plus de la masse