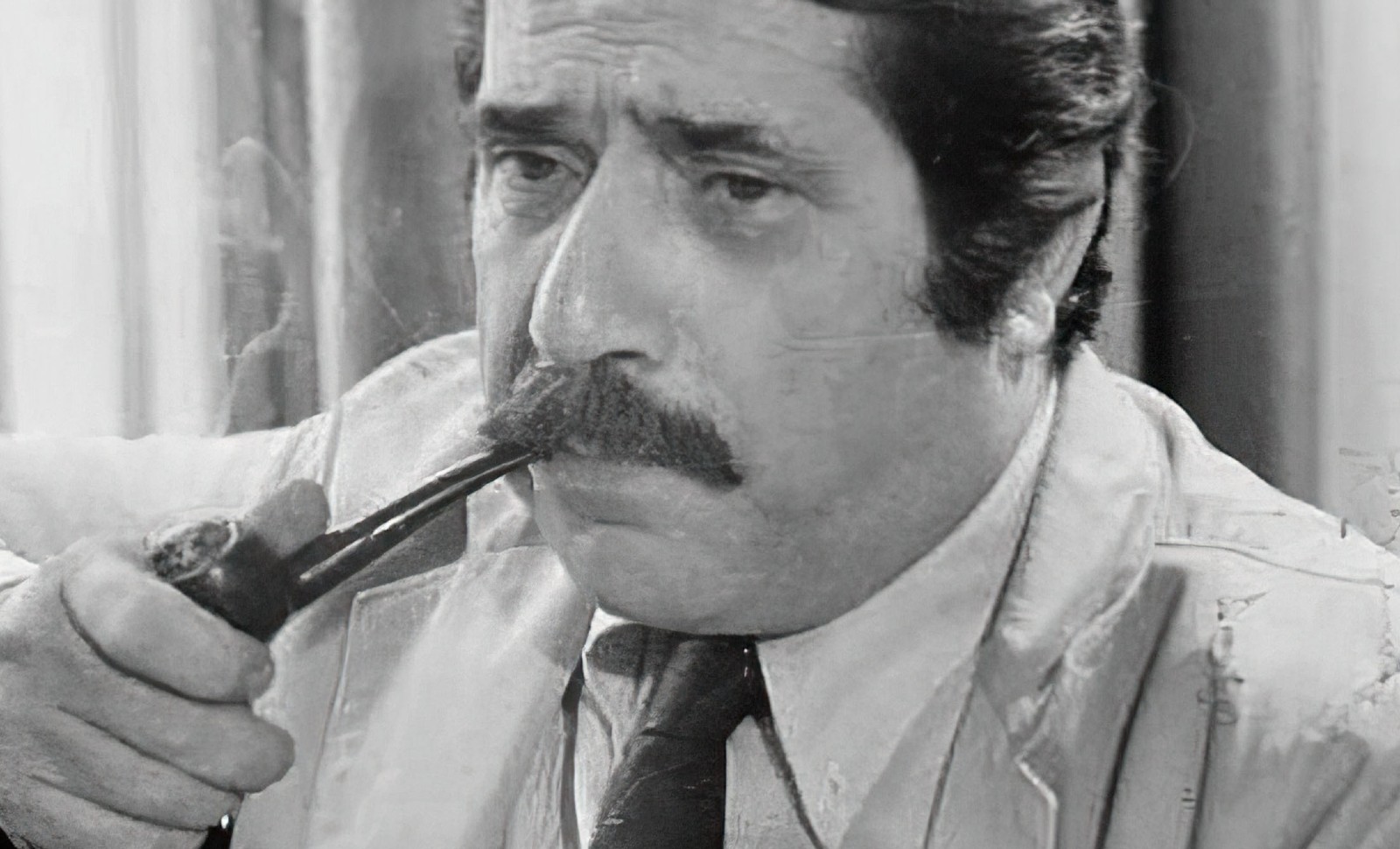Après le 15 août, seule la lecture de La solitude du satyre peut sauver l’estivant déprimé.
Le critique littéraire est, par nature, un être snob. Pour faire le malin et se distinguer de la troupe, il se veut le défenseur des auteurs réprouvés (c’est-à-dire des écrivains qui ne vendent pas). Braquer sa plume sur un inconnu des librairies est une manière peu coûteuse de passer pour un type qui a du flair et du goût. Mais quand ce dernier, cet anonyme, a le malheur d’accéder à une notoriété plus large, nous l’abandonnons sur le champ par dépit amoureux, nous reprochant d’avoir été son strapontin vers une gloire, le plus souvent posthume. Par la suite, nous lui trouverons tous les défauts du monde, raillant sa prose bancale et maudissant notre naïveté. Le critique étant lui-même un auteur dans une majorité écrasante des cas, nous avons toujours plus de mal à vanter le travail d’un vivant que celui d’un mort. Question de pudeur, peut-être.
Avec un défunt, la concurrence nous semble moins déloyale. Avec nos contemporains, la jalousie et l’amertume, le dédain et la lassitude nous empêchent de juger sereinement une œuvre, c’est pourquoi, par principe de précaution, nous préférons la taire. Une forme de névrose très ancienne a perverti notre métier qui se passionne