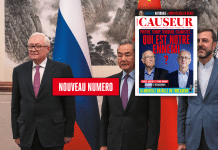On nous annonce pour cette fin d’année une « actualité » (comme on dit en français moderne) de Louis Aragon, avec la publication dans la Pléiade du tome V et dernier de ses oeuvres romanesques (sous la direction érudite de Daniel Bougnoux) à côté des deux volumes de l’oeuvre poétique. Un des plus multiples et omniprésents écrivains du siècle dernier dispose donc désormais de son monument achevé.
C’est en y songeant que je me suis avisé d’une coïncidence tout à fait involontaire (de ma part en tout cas) : le titre que nous avons choisi pour la présente chronique est celui d’un ensemble de poèmes publiés (clandestinement) durant l’Occupation par cet écrivain qui a tant compté pour moi, ces poèmes dont il était si fier (Dites-moi par hasard qui sut plus haut chanter / À l’heure noire du silence, s’exclamait-il quelques années plus tard).
M’est alors revenue à l’esprit une question à moi posée il y a plusieurs années par un ami à propos de cette production illustre (Les Yeux d’Elsa, Le Musée Grévin…) : « Mais au fond, à part à la gloire personnelle de l’auteur, à quoi cela a-t-il servi ? »[access capability= »lire_inedits »] Question troublante à laquelle j’ai mis longtemps à (me) proposer une réponse. Cette réponse est que cela servait (fût-ce a posteriori, car peu de lecteurs y accédèrent sur le moment) à manifester, au milieu du désastre, un pays, une substance, une histoire, un langage. Aragon reprenait tout, réinvestissait tout, le Moyen Âge et les troubadours, l’héritage révolutionnaire et les symboles chrétiens, les formes poétiques anciennes, les noms de pays, pour les (re)faire exister, pour manifester à l’esprit et aux imaginations un fait, un univers qui portait le nom de France. Il est évidemment insolite d’associer le nom d’Aragon à un tel terme, mais, dans un essai qui vient de paraître[1. Vieux réac ! Faut-il s’adapter à tout ? Flammarion, coll. « Antidote », 120 pages.], Harold Bernat nous indique à son avis « ce qu’il faut entendre par réaction : préservation oppositionnelle d’une réalité menacée de disparition ». C’est exactement de cela qu’il s’agit. L’ouvrage d’Harold Bernat ne concerne nullement l’Occupation, mais les conditions actuelles, sans commune mesure, naturellement, de notre société. Il me semble cependant que le défi est le même, qu’il ne nous incombe pas moins de nous demander ce qui est menacé de disparition (« réalité d’une valeur, d’une tradition, d’une idée, d’une coutume », précise-t-il), et d’aviser aux moyens de le faire reparaître, en une sorte d’aléthéia, comme disent les philosophes. Et cela a rapport avec les récits, les formes, les mots, le sens qu’on leur donne.
Je laisse mon lecteur méditer sur ce point et trouver lui-même des exemples. Mais je renverrai notamment à l’excellent dossier récemment consacré par Jean Sévillia au thème « Qui veut casser l’histoire de France[2. Le Figaro Magazine du 24 août.]? ». Sans grand rapport avec ce qui précède, j’aimerais citer deux phrases qui m’ont ravi dans les romans de la période. D’abord cette surprenante (et ô combien parlante) ellipse temporelle de Benoît Duteurtre, évoquant le début des années 1980, la victoire de la gauche, les mutations de Paris : « Tout ce que nous en savons désormais restait à venir[3. À nous deux, Paris ! Fayard, 333 pages.]. » Puis ces mots (plus lyriques peut-être, plus optimistes) que Sébastien Lapaque place dans la bouche d’un jeune révolutionnaire : « Nous voulons dire aux hommes que tous les pays dissimulent au fond d’eux-mêmes un autre pays possible.[4. La Convergence des alizés, Actes Sud, 338 pages.] » C’est la grâce que je nous souhaite.
Une bonne nouvelle enfin : je viens de découvrir sur Facebook l’existence (apparemment récente) d’un « Comité contre la médiocrité linguistique », qui pose avec humour une question très sérieuse. Je n’en sais pas beaucoup plus pour le moment, mais j’y reviendrai dès que possible.[/access]
*Photo : Bernardo Le Challoux.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !