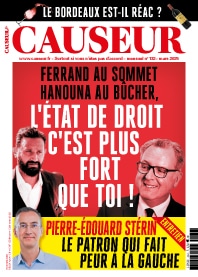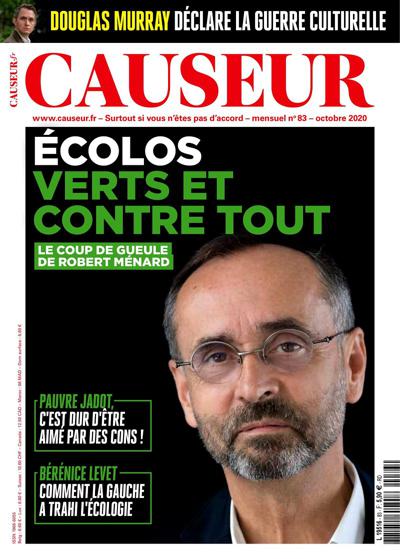Les nouveaux manuels scolaires sont des outils de matraquage idéologique. Absence de repères historiques, marginalisation des grands auteurs, mise en avant des thèses immigrationnistes, indigénistes et antimasculinistes. Le verdict est sans appel.
En tant que professeur de lettres en lycée, je reçois régulièrement, de la part des éditeurs, des spécimens des manuels scolaires susceptibles d’être choisis dans mon établissement. C’est l’occasion pour moi de feuilleter ce qui se fait sur le marché et de vérifier avec consternation, année après année, les tendances lourdes qui s’en dégagent.
Il n’est pas inutile de rappeler que ces ouvrages sont conçus par des professeurs, collégialement, soumis bien sûr aux contenus tels que définis par le Conseil supérieur des programmes, mais bénéficiant tout de même d’une marge de manœuvre significative dans le choix des thèmes et textes abordés. Par exemple, si l’étude de la poésie du Moyen Âge au xviiie siècle est imposée par les programmes officiels en seconde, toute latitude est donnée quant à la sélection des textes proposés aux élèves.
À lire aussi, Didier Desrimais : Elisabeth Moreno compte diffuser la propagande LGBT à l’Education nationale
Un rapide coup d’œil permet de voir, d’abord, et ce n’est pas nouveau, que l’iconographie des manuels de littérature est extrêmement riche et diversifiée (reproductions de tableaux et gravures, photographies, affiches, captations scéniques…), ce qui les rend très agréables à consulter, mais tend à étouffer et à noyer le texte pourtant censé constituer l’essentiel. Le prolongement d’une étude littéraire par une analyse d’image est un enrichissement certain, mais on a le sentiment, bien souvent, que le manuel de littérature ne répond pas à sa mission première en ne mettant pas plus en avant la forme écrite que les autres expressions artistiques.
Une histoire littéraire réduite à la portion congrue
On constate la confirmation d’une autre tendance déjà bien ancrée : l’histoire littéraire est réduite à la portion congrue – une page pour le théâtre classique, une page pour le romantisme, de discrets petits encadrés sur les auteurs, y compris les plus grands (il ne faudrait tout de même pas se risquer à apprendre des choses à nos élèves…). Et sauf rare exception éditoriale, c’est l’absence de chronologie qui prévaut dans la présentation des textes : on choisit une organisation transversale, c’est-à-dire par thèmes, dans le cadre de chaque objet d’étude. Par exemple, pour ce qui est du « roman depuis le xviiie siècle », on va proposer des extraits de différentes époques, centrés sur la question, pertinente au demeurant : « Pourquoi les écrivains s’intéressent-ils à des héros imparfaits ? » Mais comment s’étonner ensuite que règne dans l’esprit des jeunes gens la plus grande confusion dans l’histoire et la chronologie littéraires ?
Bien sûr, la partie « maîtrise de la langue » n’est pas oubliée, jusque dans l’accord sujet-verbe, puisqu’on sait désormais que les lycéens dans leur immense majorité ne possèdent pas les rudiments de leur propre langue.
Bref, le temps est loin du bon vieux Lagarde et Michard qui, pour ne pas être exempt de défauts, et sous une apparence assez austère, privilégiait le texte et livrait une nourriture consistante à ceux qui avaient faim.
L’idéologie préside
Ce qui frappe surtout, si l’on y regarde de plus près, ce sont les choix idéologiques qui président à l’élaboration de ces manuels : puisque les textes littéraires ne sont plus présentés pour eux-mêmes, comme détenteurs d’une valeur intrinsèque, mais pour servir des thèmes de réflexion librement choisis par les concepteurs, la neutralité n’est pas de mise, en dépit d’une apparente objectivité académique. Bien évidemment un manuel scolaire, parce qu’il repose toujours sur des choix,