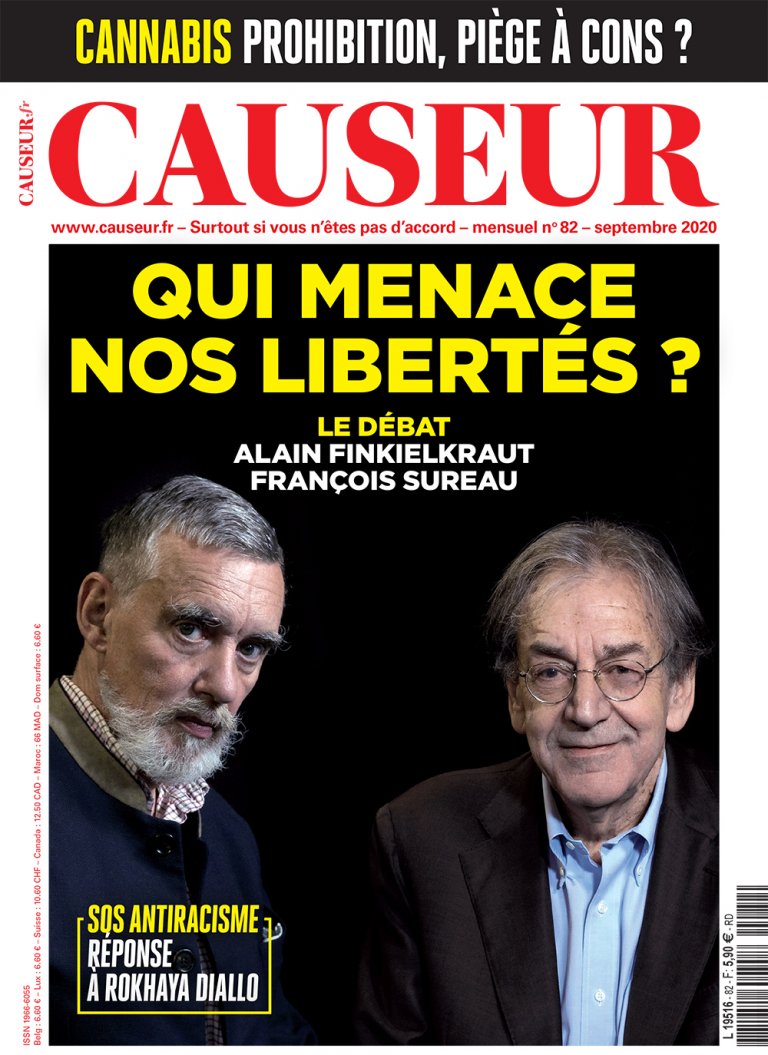Entre le juif de Corfou Albert Cohen et le protestant provençal Marcel Pagnol, l’amitié, nouée dès l’école à Marseille, fut intense et durable. Un livre de Dane Cuypers explore les arcanes de cette relation unique entre deux créateurs que le succès n’a pas séparés.
Ils furent comme des frères, si différents et si merveilleusement assortis. Le premier se prénommait Marcel, le second, Albert ; celui-ci, Cohen (1895-1981), était juif, originaire de Corfou, celui-là, Pagnol (1895-1974), protestant et provençal, précisément natif d’Aubagne. L’un et l’autre devinrent fameux.
Pagnol, ce « sénateur romain qui aurait lu Dickens »[tooltips content= »Bernard de Fallois dans sa postface au dernier tome, posthume, des souvenirs de l’écrivain, Le Temps des amours« ](1)[/tooltips], possédait la veine dite « populaire », qualificatif ambigu, possiblement méprisant, par lequel on désigne des auteurs qui eurent le bonheur de rencontrer un grand succès.
Et Albert alors ? Son succès, plus tardif, l’installa durablement dans la gloire. Son inspiration, vagabonde, se débauche chez Rabelais, passe par la Bible, bifurque un peu vers Pascal, se colore de John Steinbeck, puis se déploie dans un style de miel et de fiel, tantôt caressant, tantôt cinglant, hilarant aussi : des abîmes noirs ou des enchantements. On est emporté par le flot énorme qui coule à l’intérieur de Belle du Seigneur[tooltips content= »Publié en 1968, Belle du Seigneur, appartient à une tétralogie, soit quatre œuvres réunies sous le titre Solal et les Solal dans la collection « Quarto », chez Gallimard : Solal, a paru en 1935, Mangeclous, en 1938, Belle du Seigneur en 1968, et Les Valeureux en 1969. »](2)[/tooltips] dans un tumulte