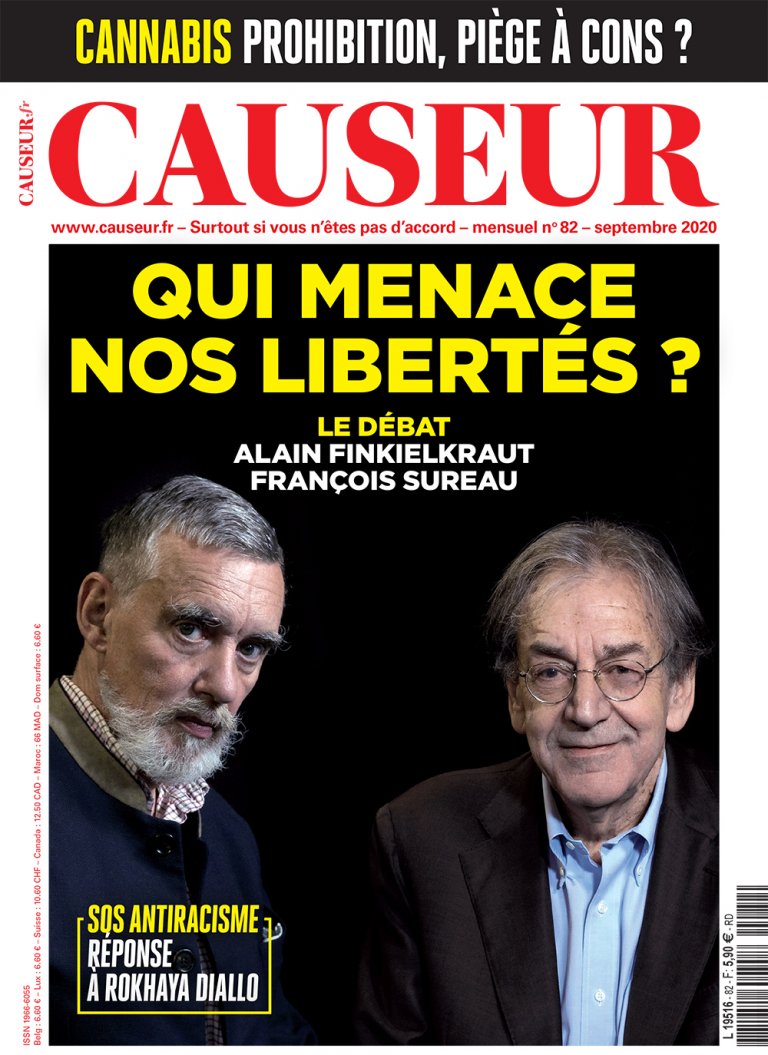La science n’a jamais été un long fleuve tranquille. Comme nous le rappelle le chercheur écossais Stuart Ritchie, la recherche scientifique est la proie des erreurs, des impostures, de l’incompétence et de la cupidité des chercheurs. Avec la crise sanitaire, ces problèmes trop humains n’ont fait que s’aggraver.
21 août 2020, la presse s’emballe. Selon une publication dans la prestigieuse revue Cell, le nouveau coronavirus responsable du Covid-19 aurait muté, ce qui le rendrait plus contagieux, mais aussi moins dangereux, et expliquerait au passage l’augmentation du nombre de cas observés depuis quelques semaines sans que cela se solde par un pic d’hospitalisations et encore moins de mortalité. Quelques heures plus tard, l’eau de la douche refroidit sévère. De un, on apprend que ce n’est pas exactement ce que dit le papier que les médias prétendent citer en boucle – ô joie des journalistes qui ne lisent pas la littérature primaire et bâtonnent de la dépêche à tire-larigot – et de deux, que c’est d’ores et déjà la forme « mutée » qui a circulé en France quand la pandémie y prenait ses aises au printemps.
Depuis le début de la pandémie, la science joue les montagnes russes. À la mi-janvier, l’OMS estimait impossible la transmission interhumaine du virus. En mars, des médecins conseillaient à leurs patients de ne pas s’inquiéter de cette « grippette », à l’heure où le port du masque n’avait officiellement rien d’utile et pouvait même se révéler contre-productif. Mi-mars, il fallait cesser séance tenante l’ibuprofène, molécule anti-inflammatoire accusée d’aggraver les symptômes de la maladie. Jusqu’en avril, les enfants étaient les principaux vecteurs du virus camouflé sous une forme asymptomatique, en outre considérée comme la plus contagieuse. Jusqu’en juillet, la transmission ne se faisait pas par voie aérienne, mais uniquement par contact avec le nez, la bouche ou les yeux de gouttelettes de salive infectée. Autant d’affirmations depuis démenties. D’autres que l’on pense aujourd’hui solides le seront très probablement à plus ou moins court terme.
A lire aussi, Renée Fregosi: Le scandale The Lancet remet en cause le fonctionnement des revues “de référence”
À première vue, rien que de très normal. C’est ainsi que fonctionne la science : ses vérités ne le sont que jusqu’à preuve du contraire et en l’état actuel des connaissances. Quand de nouvelles connaissances émergent et exposent les failles des anciennes, on découvre que ce que l’on pensait vrai ne l’est pas. À ce titre, la crise du Covid-19 a révélé au commun des mortels ce qui ne fait tomber aucun scientifique de sa chaise : la vérité ne sort pas toute casquée de la cuisse des chercheurs, elle est le produit d’une lente et très bordélique entreprise bourrée de fausses pistes, de contradictions, de culs-de-sac et de très sales querelles. Peut-être qu’à l’instar des lois et des saucisses de Bismarck,