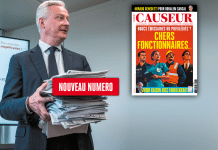Sale temps pour nos libertés. Si Alain Finkielkraut et François Sureau s’alarment tous deux de l’esprit du temps, ils n’ont pas les mêmes motifs d’inquiétude. Quand l’un perçoit dans les revendications individuelles et communautaires les ferments d’une régression antidémocratique, l’autre dénonce la menace que ferait peser l’État sur nos libertés individuelles. Des Gilets jaunes à l’immigration en passant par le confinement et la liberté d’expression, les deux hussards ferraillent dans la plus pure tradition française.
Causeur. Vous éprouvez tous les deux le même amour de la liberté. Alain Finkielkraut, vous avez fondé et dirigé Le Messager européen, dédié au combat antitotalitaire. François Sureau, vous avez quitté le Conseil d’État pour devenir avocat aux conseils où vous attaquez l’État que vous représentiez autrefois. Et si vous êtes un ami du président, vous parlez parfois comme Mediapart. En somme, vous avez tous les deux rompu avec votre milieu ; François Sureau avec la haute fonction publique et Alain Finkielkraut avec l’opinion éclairée. Alain Finkielkraut, vous ferez certainement vôtre la phrase de Chateaubriand qui figure en exergue de Sans la liberté, texte de Sureau paru il y a un an : « Sans la liberté il n’y a rien dans le monde. »
En revanche, vous n’êtes pas du tout d’accord sur la menace qui pèse sur nos libertés. Vous vous inquiétez, François Sureau, de l’extase sécuritaire, tandis qu’Alain Finkielkraut dénonce l’extension illimitée des droits. Comment la liberté s’articule-t-elle avec les droits individuels ? Y a-t-il un vertige de la liberté moderne ?
François Sureau. Je ne suis pas un adepte de la société des droits. Je suis surtout très attaché à ce qu’on appelle depuis le xviiie siècle le projet des libertés publiques. Il suppose la démocratie représentative, des institutions dans lesquelles ce sont les autorités judiciaires, plutôt qu’administratives, qui peuvent limiter les libertés, ce qui évite aux citoyens d’être intimidés par la puissance publique. J’observe avec inquiétude la substitution à ce projet des libertés publiques d’une société des droits et même des créances, dans laquelle chacun fait valoir son droit de créance mémorielle ou minoritaire, couplée avec un moralisme général qui s’impose même aux autorités publiques chargées de la répression. D’où ce drôle de climat où un peuple renonce au projet politique des libertés pour se satisfaire d’une situation où chaque communauté, chaque groupe social peut espérer voir ses droits satisfaits sous le contrôle très étroit de la puissance publique.
Alain Finkielkraut. Je partage votre inquiétude : une société d’ayants droit est une société ingouvernable. La politique, c’est le souci de la chose commune. Si ce souci n’est plus partagé, s’il est dévoré et remplacé par le grief, le ressentiment, l’extension indéfinie des droits-créances, alors la politique, au sens noble du terme, n’est plus possible. L’espace public est accaparé par autre chose.
Venons-en à nos désaccords : vous avez plaidé devant le Conseil d’État contre la loi antiterroriste, contre la loi anticasseurs. Vous avez dénoncé la répression qui s’est abattue sur les Gilets jaunes. Et, alors que des manifestations interdites se déroulent tous les jours dans nos villes, que des « jeunes » insultent et agressent des policiers et les narguent parce qu’ils savent qu’ils ne seront jamais condamnés, que certains quartiers sont livrés à la charia, vous nous parlez d’extase sécuritaire ! Pour ma part, ce que je vois à l’œuvre maintenant, c’est l’extase de l’impunité et j’ai plus peur de la faiblesse de l’État que de son inclination à l’autoritarisme.
François Sureau. Prenons un peu de recul. La grande idée du xviiie siècle, au fond, c’est qu’une société politique est légitime seulement si elle est fondée sur des principes tirés du droit naturel, comme la liberté de détermination de la personne, la liberté de penser, d’agir, de parler, etc. On définit un corpus juridique inaltérable et la mission de l’État est de le faire respecter, par ses agents, par l’impôt, par les forces de répression. Or, de manière insensible, nous avons rompu avec cette idée. Désormais, le respect de droits censément imprescriptibles est proportionné à la capacité de l’État de les mettre en œuvre. Dévaster les centres-villes à coup de boules de pétanque, c’est mal. Face à cela, la première solution, c’est de se doter des forces nécessaires pour maintenir l’ordre. Si l’on ne dispose pas de ces forces, le gouvernement est naturellement tenté de limiter le droit de manifester lui-même. C’est là que l’on glisse vers un autre monde. Le travail d’un gouvernement consiste à organiser les forces de la répression pour pouvoir assurer l’ordre sans être obligé de limiter les libertés individuelles. Or, on fait l’inverse. Et pire, au lieu de prononcer une interdiction de manifester tel jour à telle heure, ce qui est toujours possible, la loi anticasseurs organise un filtrage individuel des manifestants sur la base des opinions qu’on leur prête. C’est la faillite de tout un système de pensée et d’action.
Alain Finkielkraut. Si je prends du recul, comme m’y invite François Sureau, je constate que notre époque n’est pas l’époque des violences policières, mais celle de la banalisation des violences antipolicières. En 68, certains d’entre nous criaient « CRS, SS ! », mais cela n’allait pas plus loin : les flics nous faisaient peur. Aujourd’hui, les policiers ne font plus peur, ils ont peur. Et ils ont des raisons d’avoir peur. Ils sont attaqués, lynchés, victimes, comme les pompiers, de guet-apens. Dans les banlieues, bien sûr, où ils n’osent pas pénétrer de peur de commettre une bavure et de donner ainsi le prétexte à une réédition en pire des émeutes de 2005, mais aussi lors des manifestations des Gilets jaunes. Vous êtes frappés, François Sureau, par le spectacle « des forces de l’ordre armées en guerre patrouillant dans les rues des villes, l’abus des sirènes de police, la recension des plaies mutilantes dues à nos armes modernes ». J’ai vu autre chose : des manifestants extrêmement violents vandalisant des boutiques, mais aussi boxant des flics ou s’en prenant à eux avec une violence inouïe. Et je pense aussi à ce qui s’est passé en 2016, en marge de Nuit debout, quand des policiers ont manifesté place de la République contre la haine dont ils étaient l’objet. Pour les gens de Nuit debout, c’était un sacrilège qu’il fallait punir. Quai de Valmy, certains s’en sont pris à une voiture de police occupée par un homme et une femme, ils ont brisé les vitres, lancé un fumigène à l’intérieur du véhicule, et quand un policier en est sorti, les coups ont plu sur lui. Les agresseurs ont laissé une pancarte : « Poulets rôtis, 5 euros ».
François Sureau: Avec les Gilets jaunes, 70% des gardes à vue n’ont donné lieu à aucune inculpation. La garde à vue préventive massive, c’est une subversion profonde de notre État de droit
Vous parlez aussi d’un pouvoir judiciaire de plus en plus répressif, et de la dureté, sans précédent, de notre droit pénal. Mais je me rappelle que Le Monde était tout content d’annoncer, au sujet de cet incident : « Voiture de police incendiée, pas de volonté de tuer ». Les manifestants ont donc été traduits en correctionnelle, à la grande satisfaction du quotidien de référence. Leur férocité ne les a pas conduits aux assises. Plus récemment, on a entendu des manifestants crier « Mort aux porcs » et des Gilets jaunes hurler « Suicidez-vous ! » au nez et à la barbe de policiers immobiles. Vous écrivez : « Il ne reste rien de la liberté de manifester si le gouvernement peut choisir ses opposants ». Mais le gouvernement ne choisit pas ses opposants, toutes les manifestations aujourd’hui, y compris celles des soignants, sont perverties par des casseurs. C’est à eux que peut s’adresser l’interdiction de manifester, pas au citoyen moyen.
François Sureau. Ce n’est pas exact. Il faut distinguer deux choses.
S’agissant du droit, il est absolument vital si nous voulons faire respecter la démocratie, de ne prendre aucune liberté avec les principes, ce qui n’interdit nullement une répression sévère des affreux dont vous parlez. Il ne revient pas à un procureur de choisir individuellement les gens qui seront admis à manifester dans la rue. On peut interdire une manifestation quand elle est dangereuse, on peut même faire venir l’armée. Mais ce que le gouvernement a voulu organiser, ce sont des interdictions individuelles prononcées, de manière subjective et hors de tout contrôle juridictionnel, par l’autorité publique sur la base de la dangerosité supposée des personnes. C’est inacceptable. Et c’est un précédent dangereux. Un jour, on décrétera que vous, Alain Finkielkraut, dont on connaît les positions contestables, vous ne pouvez pas manifester, et vous n’aurez pas la possibilité de saisir un juge pour vous défendre.
Le deuxième point a trait à l’usage massif de la garde à vue comme instrument de contrôle de foule et d’encadrement des manifestations. C’est une perversion de notre droit qui a été massive et n’a guère été commentée que par les spécialistes. On place quelqu’un en garde à vue lorsque des indices graves et concordants laissent penser qu’il a commis un délit. Or, avec les Gilets jaunes, 70% des gardes à vue n’ont donné lieu à aucune inculpation. La garde à vue préventive massive, c’est une subversion profonde de notre État de droit. Cela ne m’inquiète pas du tout qu’on interdise une manifestation, ou qu’on traduise les gens en correctionnelle s’ils ont fauté, mais il n’y a aucune raison de toucher aux principes. Nous avons un droit assez répressif, avec l’interdiction de manifester qui a été inventée avant-guerre au moment de l’arrêt Benjamin. Pourquoi n’arrive-t-on pas à le faire fonctionner ici ? À cause du sous-équipement de la police, de la violence de plus en plus grande des manifestants et des déficiences du commandement. Que le maintien de l’ordre soit difficile, que des propos tenus à l’égard des forces de l’ordre d’un pays démocratique soient inacceptables, je suis le premier à en convenir. Mais je ne vois aucune raison d’altérer les principes pour régler ce problème. D’ailleurs, ça ne le règle pas. On ne sache pas qu’il y ait moins de black blocs, moins d’horreurs, moins d’insultes depuis le vote de la loi anticasseurs.
Cependant, la réponse pénale est particulièrement faible dans notre pays. Pour aller en prison, il faut vraiment en faire.
François Sureau. Il est très difficile de parler de la réponse pénale en général. Pour l’avoir beaucoup pratiquée, je sais qu’il y a des cas où elle paraît légère, d’autres où elle paraît sévère. L’incrimination des propos outranciers me pose un vrai problème, parce qu’on ne sait pas où cela s’arrête et qu’il est quand même heureux qu’on puisse continuer à distinguer la parole de l’acte, sauf bien sûr dans les cas de provocation directe au meurtre. Mais au-delà, ce qui est dramatique, c’est que les forces de l’ordre soient la dernière digue d’une société déboussolée, et pour beaucoup le symbole visible de l’injustice et de l’immoralité du monde institutionnel.
Alain Finkielkraut. Si la société est déboussolée, l’État est ligoté : par le souvenir traumatisant des émeutes de 2005, et aussi par la mort de Malik Oussekine. C’est d’ailleurs pour cela que les policiers ne vont pas au contact, et que l’utilisation des LBD s’est généralisée. Dans d’autres pays, tout aussi démocratiques, des policiers encerclés auraient utilisé leurs armes létales. Je me souviens d’une image absolument terrible d’une manifestation de Gilets jaunes aux Champs-Élysées, où un policier était coursé, menacé de lynchage, son collègue a brandi son arme, mais il ne s’en est pas servi. Dans le contexte actuel de violence sociale débridée, il faut admirer la capacité des forces de l’ordre de se fixer des limites. Quant à la réponse pénale, je crois, comme Élisabeth Lévy, qu’elle est très déficiente et contribue à démoraliser les policiers. Comme Alain Juppé l’avait déjà dit au moment de son procès pour les abus de biens sociaux de la Ville de Paris, la formule de La Fontaine, « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir », est aujourd’hui inversée. Les politiques, qui ne sont pas très puissants, ont beaucoup de souci à se faire aujourd’hui face à la magistrature du Mur des cons. C’est la conclusion que je tire de l’affaire Fillon. Il est condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, peine non aménageable, pour détournement de fonds publics alors que l’usage de son enveloppe parlementaire était qualifié jusqu’à présent d’abus de confiance. Un jeune de banlieue qui en a blessé au couteau un autre lors d’un règlement de comptes vient d’être moins sévèrement sanctionné. Je ne vois pas ce deux poids, deux mesures comme une revanche du faible sur le fort, mais comme une abdication devant la force brute.
François Sureau. Il y a ici un problème profond qui tient au rapport entre la norme et la pratique. Depuis vingt ans, les gouvernements, incapables de répondre à la demande de sécurité légitime de la population, ont réduit les garanties de l’ensemble des citoyens, et pas seulement des délinquants. Ce transfert est inacceptable. La classe politique me paraît grandement coupable : elle ruine la légitimité de notre système démocratique, car elle n’est pas capable de commander sa police d’une part, et d’organiser un maintien de l’ordre satisfaisant, et elle tente de se racheter publiquement en modifiant le Code pénal chaque année depuis quatorze ans avec un résultat absolument nul.
D’autre part, s’il est vrai que le métier de policier est devenu extrêmement difficile, il faut aussi constater que le respect de la garantie des droits individuels ne correspond pas à la philosophie dominante au sein des forces de police, et cela depuis très longtemps. Nous sommes moins républicains qu’impériaux, en ce domaine. Nous avons tendance, peut-être à cause de nos divisions, à juger incompatibles le respect des droits de chacun et la sécurité de tous. C’est une illusion française. L’exemple de l’Angleterre depuis l’habeas corpus montre que la garantie des droits n’est nullement incompatible avec une répression efficace des crimes et des délits.
 Alain Finkielkraut. Vous dites que les libertés de tous les citoyens sont menacées et même réduites. Pendant le confinement, en effet, nous avons été privés de la liberté d’aller et venir, de nous réunir et de manifester. Mais cette suspension ne témoignait nullement d’un penchant despotique de nos gouvernants. Ils ont choisi de figer l’économie alors qu’ils ne juraient que par l’économie et parce qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour enrayer la pandémie et éviter l’engorgement des hôpitaux. Nulle allégresse disciplinaire dans leur décision, mais le constat désolé qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce choix, qui allait coûter très cher, était pour eux un véritable crève-coeur.
Alain Finkielkraut. Vous dites que les libertés de tous les citoyens sont menacées et même réduites. Pendant le confinement, en effet, nous avons été privés de la liberté d’aller et venir, de nous réunir et de manifester. Mais cette suspension ne témoignait nullement d’un penchant despotique de nos gouvernants. Ils ont choisi de figer l’économie alors qu’ils ne juraient que par l’économie et parce qu’il n’y avait pas de meilleure solution pour enrayer la pandémie et éviter l’engorgement des hôpitaux. Nulle allégresse disciplinaire dans leur décision, mais le constat désolé qu’ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce choix, qui allait coûter très cher, était pour eux un véritable crève-coeur.
Du reste, on savait très bien que les libertés allaient rouvrir en même temps que les cafés et les restaurants. Et cela n’a pas manqué : les néoféministes, les antiracistes du deuxième type, les syndicats, les soignants et même les sans-papiers ont occupé la rue. On a vu ainsi les manifestations reprendre à un rythme beaucoup plus endiablé qu’en 2019. Mais où donc est Big Brother ? Bref, je ne vois pas comment on peut dire que nos libertés publiques sont menacées.
François Sureau. Je vais vous en donner un exemple. Pendant le confinement, ce gouvernement a décidé de prolonger les détentions provisoires sans juge. C’est sans exemple depuis le xviiie siècle. Le principe fondamental, c’est que quelqu’un est en prison parce qu’un juge l’a décidé. C’est un exemple parmi d’autres.
Le droit français comporte désormais de nombreux éléments de ce genre, et qui sont très contestables : le filtrage individuel des manifestants, que j’ai évoqué, la possibilité de confier l’investigation de votre vie privée et de vos propriétés personnelles à un fonctionnaire d’autorité dépendant du gouvernement et non à un juge judiciaire indépendant. Chemin faisant, nous renonçons à des principes sans qu’il n’en résulte jamais aucun supplément d’efficacité répressive. Mais aussi, chemin faisant, c’est l’autonomie, la liberté du sujet politique, du citoyen, qui se trouve de plus en plus compromise.