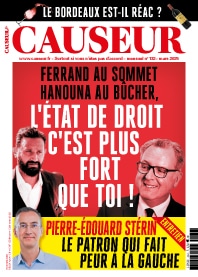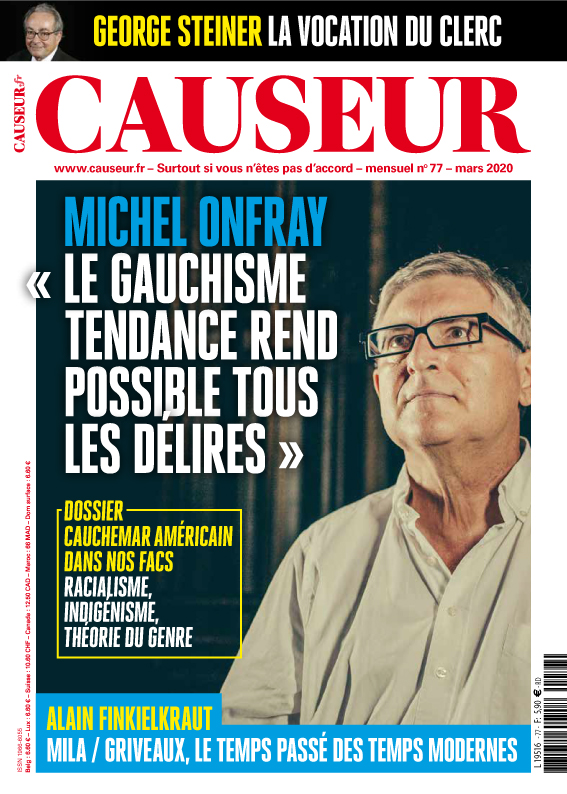Depuis la fin des années 1980, une partie de la mouvance antiraciste s’est islamisée. De la jonction entre les Frères musulmans et les Indigènes de la République est né un courant syncrétique rejetant la France. Enquête.
C’est une guerre de trente ans. De la Marche des beurs (1983) aux attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher et du Bataclan, une partie de la mouvance antiraciste a muté. Elle a commencé à s’islamiser dès la fin des années 1980, puis de plus en plus au cours de la décennie suivante sous l’influence des Frères musulmans, avant de converger avec le courant « décolonial » des Indigènes de la République, né en 2005, quelques mois avant les émeutes urbaines. Se nourrissant mutuellement, militants décolonialistes et islamistes partagent un même rejet de la France « islamophobe », une rhétorique, une stratégie de mobilisation et peut-être même un projet voisins.
Un processus bien particulier
David Vallat, sympathisant de la Marche des beurs converti à l’islam puis au djihadisme du GIA (aujourd’hui un repenti qui lutte activement contre l’islamisme en France), explique ainsi sa trajectoire : « En 1983, on se disait “enfin, il y a des gens issus de nos milieux qui vont peut-être nous représenter”. On a eu cet espoir-là. Et on a vite déchanté. On a vite vu l’arnaque avec les socialistes comme Julien Dray et Harlem Désir. Et ce qui nous a le plus choqués, c’était ce slogan, “Touche pas à mon pote”, qui était d’une condescendance crasse. Nous, on demandait la protection de l’État, l’égalité des droits, et eux ils nous donnaient la protection de nos concitoyens ! Comme si on était des sous–citoyens. Et puis, ce qualificatif de “beur”. Ça n’a fait qu’empirer dans les années et décennies qui ont suivi. C’est à partir de là qu’on a commencé à écouter la doctrine islamiste. »
C’est ainsi qu’une frange de l’antiracisme, majoritairement universaliste pendant les années 1980, a pris un tournant islamiste au cours des décennies 1990 et 2000.
Dès la fin des années 1980, le militant Toumi Djaïdja transforme en mosquée le local associatif de la Marche des beurs, dans le quartier des Minguettes (Vénissieux). Par la suite, l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), issue des Frères musulmans, déploie son entrisme sur le mouvement, né comme elle en 1983. Les polémiques autour de l’affaire du voile au lycée de Creil en 1989 et la fatwa de l’ayatollah Khomeyni contre Salman Rushdie créent un climat idéologique propice à l’islamisation des banlieues. Des outils intellectuels et idéologiques sont alors mis à disposition des propagandistes. Ainsi, Yamin Makri et Abdelaziz Chaambi fondent la maison d’édition islamique francophone Tawhid en 1989 à Lyon. L’Union des jeunes musulmans sert alors de tribune aux thèses du jeune intellectuel Tariq Ramadan. Ces initiatives mettent l’islam à la portée des jeunes enfants d’immigrés. Signe des temps, le chef islamiste tunisien Rached Ghannouchi, annonce l’entrée de la France dans le Dar al-Islam (« Terres de l’islam ») dès 1990, traduisant les espoirs des militants islamistes vis-à-vis d’une jeunesse musulmane française qu’ils jugeaient jusque-là trop francisée et désislamisée.
Regardons en arrière
Passant sous les radars de l’État et des médias, tous ces éléments fermentent au cours des années 1990 pour aboutir à un moment charnière lors des émeutes urbaines de l’automne 2005, début de la décennie sanglante qui aboutira aux attentats de 2015.
A lire aussi: “Séparatisme”, “communautarisme”: Et si on parlait simplement d’islamisme?
Rétrospectivement, les émeutes d’octobre 2005 donnent une signification particulière à la publication, en janvier de la même année, de l’« appel des Indigènes de la République », texte fondateur du mouvement décolonial