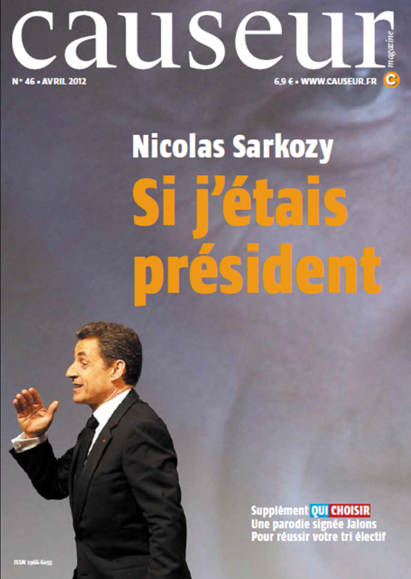« Islamistes modérés » : c’est ainsi que les médias qualifient les premiers ministres tunisien (Hamadi Jebali) et marocain (Abdelilah Benkirane), sans définir cependant ces deux termes apparemment contradictoires. Après la vague verte qui a démocratiquement porté au pouvoir des partis religieux aux quatre coins du monde arabo-musulman, l’ouvrage collectif dirigé par Samir Amghar, Les Islamistes au défi du pouvoir. Évolutions d’une idéologie (Michalon), vient heureusement combler cette lacune en analysant les mutations des mouvements islamistes à l’épreuve du gouvernement (Maroc, Tunisie, Gaza, Turquie), ou des institutions parlementaires (Égypte, Liban, Pakistan, Yémen, Algérie, Cisjordanie).[access capability= »lire_inedits »]
Les chercheurs ont choisi pour base méthodologique la définition de l’islamisme de Patrick Haenni[1. Notamment auteur de L’Islam de marché, Seuil, 2005.] : « Une idéologie portée par un mouvement social ou un parti politique, fondés sur une référence explicite à l’islam, sur une vision précise du politique, ayant un projet politique pratique (et non une utopie messianique), organisés, recourant à des activités et des démarches proprement politiques (participation à des élections, manifestations, pétitions, etc.), agissant dans un cadre politique réel (l’État) et institutionnalisé, et non violents dans leurs modes d’action. » Exit donc Al-Qaïda, les djihadistes et les salafistes qui « partagent (néanmoins) un fonds idéologique commun » avec l’islam politique mais refusent de participer aux affaires profanes de la Cité.
L’islam politique, comprend-on en lisant cette somme, est une doctrine malléable qui s’adapte aux contextes politiques, sociaux et culturels locaux. Samir Amghane nous prémunit à juste titre contre le risque d’une approche statique « émanant des islamistes eux-mêmes sur le caractère intemporel et universel de leur idéologie ». En réalité, au contact du pouvoir, des contraintes institutionnelles, les mouvements islamistes se transforment et, avec eux, leur lien avec le peuple. Car en passant du travail social d’islamisation par le bas (charité, éducation, prédication…) au grand jeu électoral, ils deviennent des « professionnels de la politique », suivant l’expression de Max Weber, soucieux d’appliquer leur programme idéologique, mais également de conserver le pouvoir.
L’exemple du Maroc, analysé dans une excellente contribution de Myriam Aït-Aoudia, constitue une belle leçon de choses. Dans une monarchie où le roi conserve l’essentiel des prérogatives politiques, l’islamisme marocain est scindé en deux branches : le Parti de la justice et du développement d’une part, qui détient la majorité parlementaire et dirige le gouvernement, et l’association Justice et bienfaisance d’autre part (Adl wa ihsane), fondée par cheikh Yassine. Si le premier est souvent comparé à son homonyme turc, la seconde est décrite comme extrémiste, en ce qu’elle a toujours refusé de reconnaître la légitimité de la monarchie et de participer au jeu électoral. Dans ce jeu à trois bandes entre le pouvoir, les islamistes « légalistes » du PJD et les opposants de JB, qui faut-il qualifier de « modéré » ?
Dans la continuité des débats sur l’ « agenda caché » des islamistes, l’article de Michaël Bechir Ayari consacré au « dire » et au « faire » du parti islamiste Ennahda éclaire d’un jour nouveau le contexte idéologique de la révolte tunisienne. Avant le départ précipité de Ben Ali, le leader du parti, Rached Ghannouchi, affrontait une fronde interne pour avoir amorcé des négociations secrètes avec le régime, lequel avait libéré nombre de prisonniers politiques arrêtés pendant la grande vague de répression des années 1990. Il est de notoriété publique qu’avant de rafler plus de 40% des suffrages lors de la première élection démocratique de la Tunisie indépendante, les islamistes tunisiens n’ont pas vu venir la révolte de janvier 2011, pas plus qu’ils n’y ont participé, à la différence des Frères musulmans égyptiens qui ont su rattraper le mouvement de la place Al-Tahrir pour asséner un coup fatal à Moubarak.
Ce rappel jette une lueur nouvelle sur la politique ennahdiste actuelle. À l’instar des partis populistes européens qui participent aux gouvernements, le premier ministre Hamadi Jebali et son équipe doivent se battre sur deux fronts : accusés de dérive « centriste » et soumis à la concurrence de groupes salafistes qui s’en prennent aux maisons closes et aux débits d’alcool, ils tentent, par leurs « dérapages » verbaux, de rassurer une base frustrée. Les sorties remarquées du ministre de l’Enseignement supérieur tunisien, obsédé par l’idée du complot mondial anciennement fomenté par le « juif Bourguiba », ne s’expliquent pas autrement.
Au fil des pages, le lecteur est invité à (re)vivre les atermoiements stratégiques du FIS algérien, à explorer les dissensions des Frères musulmans égyptiens et à dresser un bilan de la dernière décennie AKP en Turquie. Au final, ce travail collectif ouvre des perspectives inexplorées et apporte des réponses à de nombreuses questions – y compris à celles qu’on ne se posait pas.[/access]
Samir Amghar (dir.) Les Islamistes au défi du pouvoir. Évolutions d’une idéologie, Michalon, 2012.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !