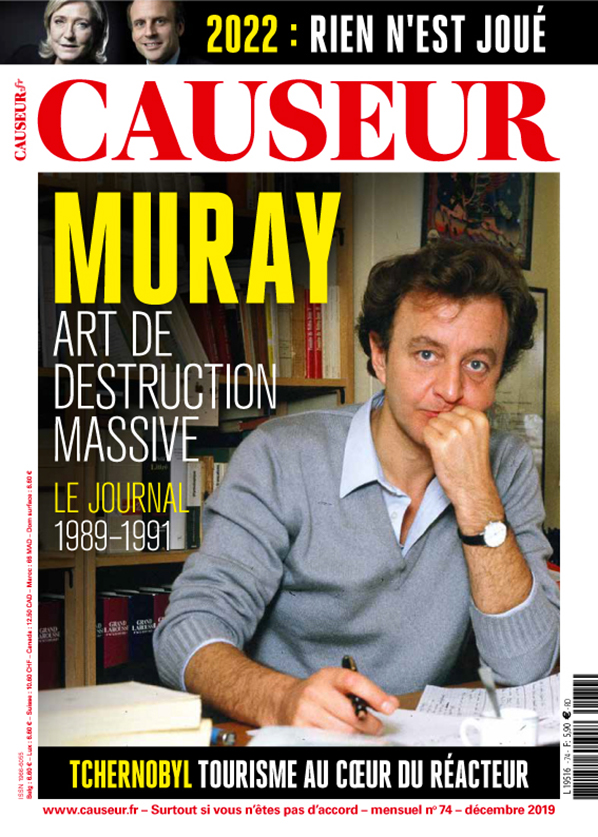Le politologue Jérôme Sainte-Marie ausculte la société française dans son essai Bloc contre Bloc. Il identifie un conflit de classes entre un bloc élitaire pro-Macron et un bloc populaire incarné par Marine Le Pen. Pour 2022, rien n’est joué.
Causeur. Depuis 2017, Emmanuel Macron a anéanti ces deux grands cadavres à la renverse qu’étaient le PS et LR. Or, tout en reconnaissant son caractère largement artificiel, vous semblez regretter le bon vieux clivage droite-gauche.
Jérôme Sainte-Marie. Je ne regrette rien, mais je constate que le remplacement partiel du clivage gauche-droite par un clivage entre un bloc élitaire et un bloc populaire n’a fait qu’accroître les tensions sociales. Par le jeu des traditions locales ou familiales, droite et gauche étaient des ensembles largement culturels dans lesquels cohabitaient des classes populaires, moyennes et dominantes. Ces deux synthèses interclassistes sont remplacées par une polarisation politique en fonction du rapport à la mondialisation, sur des bases directement liées aux ressources économiques et scolaires des individus.
En somme, la lutte des classes oppose désormais deux « blocs historiques » au sein de la société : le bloc élitaire et le bloc populaire. Si on admet que les gilets jaunes ont mobilisé une partie du bloc populaire, quelle est la base sociale du bloc élitaire macroniste ?
Précisons d’abord que j’emprunte la notion de « bloc historique » au marxiste Antonio Gramsci. Au-delà d’une simple coalition politique, c’est un projet collectif visant à la domination sur la société, à partir d’une construction sur un triple plan, idéologique, politique et surtout sociologique.
Le bloc élitaire au pouvoir a pour noyau dur l’élite réelle, c’est-à-dire les couches dirigeantes de la société dans le monde des affaires et la haute administration. Ces élites se sont mises en scène dans la commission Attali, dont Emmanuel Macron fut le rapporteur général adjoint. Mais le bloc élitaire est aussi constitué de deux autres cercles plus larges. Tout d’abord l’élite « aspirationnelle », qui correspond au monde des cadres, ceux qui veulent « en être ». Ses membres partagent l’idéologie de l’élite réelle : le culte de la réussite individuelle, l’amour de la construction européenne, un rapport détendu à la mondialisation et un discours managérial. Ensuite, il faut compter avec une partie des retraités, ceux qui forment ce que j’appelle l’élite par procuration. Quelle que soit leur condition sociale, ils ont tendance à déléguer la protection de leurs intérêts à l’élite et se défient des forces antisystème qui leur paraissent menacer une stabilité économique dont dépendent leurs revenus.
On ne saurait résumer l’électeur macroniste à la caricature du nomade mondialisé. La petite bourgeoisie urbaine et rurale, traditionnellement