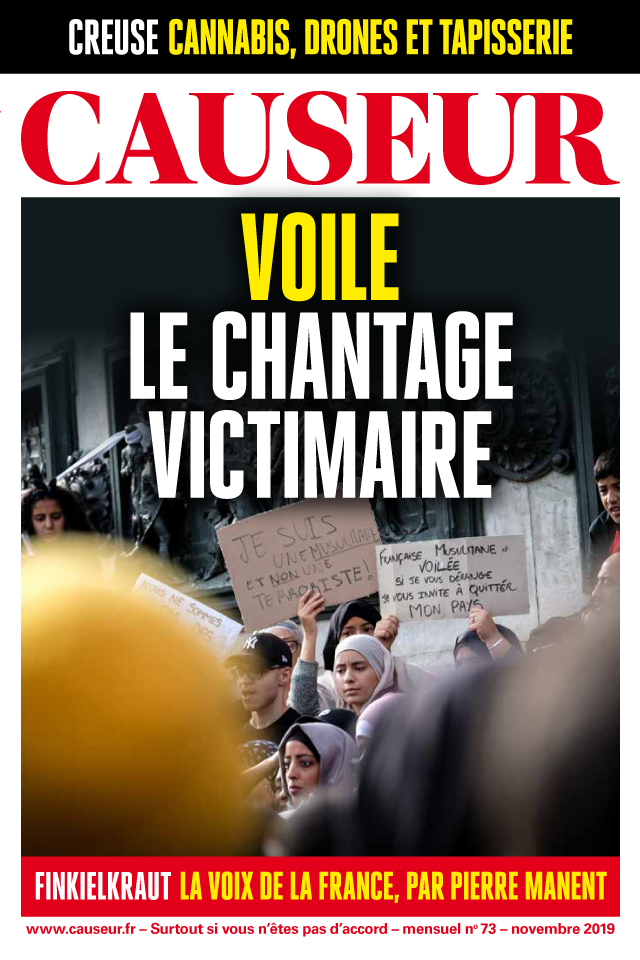L’attaque de la préfecture de police a révélé nos failles face aux cas avérés de radicalisation. Lourdeurs administratives, refus de la délation et peurs des représailles affaiblissent notre combat contre le séparatisme islamique, ferment idéologique du djihadisme.
La tragique attaque islamiste de la préfecture de police (PP) de Paris, le 3 octobre dernier, a focalisé les projecteurs sur l’épineuse question de la radicalisation des membres des forces régaliennes : police, gendarmerie, armées, mais aussi douanes ou administration pénitentiaire. C’est que les forces régaliennes ne sont pas – et c’est heureux – un État dans l’État, mais l’émanation de notre société. Une émanation particulière, avec des spécificités nombreuses, mais une émanation tout de même. Elles sont donc touchées elles aussi par les évolutions de la France. En l’occurrence, la préfecture de police en a été une illustration paroxystique : quelles que soient les mesures techniques que l’on prenne, la banalisation du communautarisme islamique, les injonctions paradoxales au plan juridique et la peur d’être accusé d’islamophobie sont nos principales failles sécuritaires.
Définissons la radicalité
J’ai déjà évoqué l’attaque islamiste du 3 octobre. Toutefois, je préfère désormais parler d’attaque : le terme « attentat » suppose une conscience politique qui en l’occurrence n’a rien d’évident. Islamiste : le tueur de la PP était ce que l’on appelle couramment un islamiste, c’est-à-dire un adepte de l’islam littéraliste théocratique. Attaque islamiste : perpétrés après une nuit de délire mystique, les quatre meurtres ont bien été inspirés par une idéologie avant tout religieuse, transcription sans fard dans les actes de l’idéal islamiste. On parle donc de radicalisation. Mais qu’est-ce que la radicalité ?
Est-elle l’intensité d’une conviction ou d’une pratique, différence donc de degré, mais non de nature avec ce qui n’est pas radical ? Et dans ce cas, où placer la limite, et comment ne pas voir – ce que pourtant beaucoup s’obstinent à nier – qu’il y a un continuum évident entre la non-radicalité et la radicalité ?
Est-ce au contraire une approche spécifique de l’idéologie – religieuse en l’occurrence, et plus précisément islamique –, ce qui suppose une différence de nature par rapport à d’autres approches, et pas seulement une différence de degré ? Mais dans ce cas, « islamisme » est un mot piégé, car il ne définit pas laquelle ou lesquelles, parmi les approches possibles de l’islam, sont visées par le terme de « radicalisation ».
A lire aussi : Monsieur Macron, lutter contre la «radicalisation», c’est se payer de mots
Pour l’instant, le lecteur me permettra de parler de « radicalisation islamiste », à l’image de la communication officielle.
Cela peut sembler paradoxal de le dire après le 3 octobre, mais les forces régaliennes sont relativement épargnées par cette radicalisation. Il n’y a naturellement pas de données chiffrées vérifiables, mais on peut affirmer que la nature même des missions de ces forces les positionne comme adversaires affichés des islamistes. Bras armé de l’État, et donc perçues comme des ennemis par ceux qui refusent la légitimité de l’autorité de l’État. Non que l’infiltration soit impossible, bien entendu. Mais à moins d’une radicalisation se voulant dès le départ secrète, un agent, fonctionnaire ou militaire islamiste sera détecté. Ce fut d’ailleurs le cas du tueur de la PP : ce qui a fait défaut n’est clairement pas la détection de sa radicalisation, mais la réaction à cette détection.
Quels sont les signes ? Pratique religieuse ostentatoire, et surtout choix