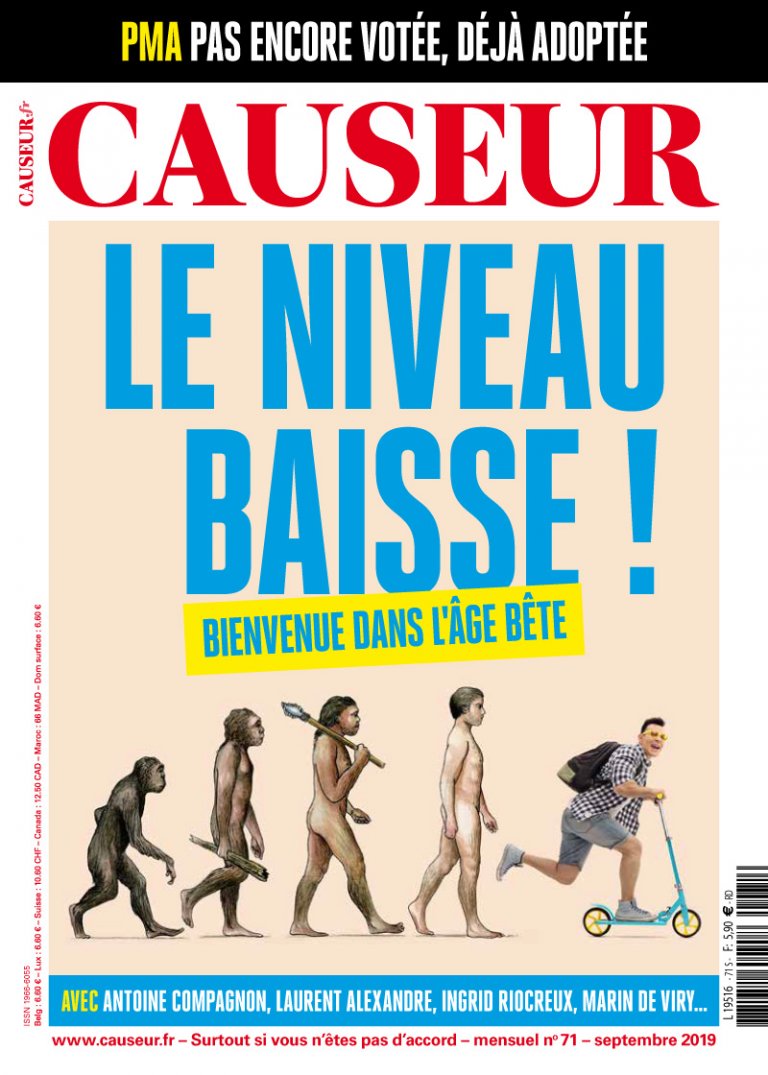Au nord-est de l’Italie, le grand ensemble de Rozzol Melara abrite 1 200 locataires en périphérie de Trieste. Objets d’un plan de requalification, ces HLM avec vue sur mer ne connaissent ni l’insécurité ni l’immigration massive de nos banlieues. Mais la souffrance sociale y est vive. Reportage.
« Giovanna est tombée ! Elle s’est empoignée avec une autre habitante qui faisait la queue pour les légumes. » Ces quelques mots prononcés en dialecte triestin affolent Genny, l’organisatrice de la distribution alimentaire. La quinqua frisée court rejoindre les gaillardes se crêpant gentiment le chignon. « Du Zola ! » me souffle-telle. Plus de peur que de mal : une dame d’un certain âge est tout simplement tombée dans les pommes de peur qu’une commère la prive de poireaux, kiwis ou abricots gratuits. Dans ce passage couvert du grand ensemble brutaliste Rozzol Melara, à quatre kilomètres du centre, la rue Louis-Pasteur est le théâtre d’une petite commedia dell’arte.
En périphérie de Trieste, 230 000 âmes, ce monstre de béton surnommé le « Quadrilatère » abrite 1 200 locataires répartis sur 650 logements sociaux. Juchés en pilotis sur une colline, deux bâtiments gris en forme de L dessinent un immense bloc dont les cimes toisent l’Adriatique. Si Melara est stricto sensu une banlieue, cette cité HLM n’a pas grand-chose à voir avec nos coupe-gorge hexagonaux. À un jet de pierre karstique de la Slovénie, on ne déplore pas de cages d’escalier transformées en planques à chichon, d’ascenseurs parfumés à l’urine ni de boîtes aux lettres défoncées par des « jeunes ».
A lire: Ma campagne d’Italie
Ceci explique sans doute cela. D’après les chiffres de l’agence régionale de l’habitat ATER, 92 % des locataires sont italiens[tooltips content= »Rappelons que le droit du sol n’a pas cours en Italie. »]1[/tooltips] et près de la moitié dépasse les 65 ans. Surnommé aussi « Alcatraz » pour son architecture quasi carcérale, Rozzol Melara reste un vestige de l’urbanisme pour les masses version seventies. Comme la Cité radieuse de Marseille, les grands ensembles italiens de Corviale (Rome), Forte Quezzi (Gênes) ou Scampia (Naples), Rozzol Melara relève du pari.
ATER : Cent vingt ans de sollicitude
Où a été créée la première agence publique italienne de l’habitat ? En Autriche-Hongrie ! Cette blague aurait pu naître à Trieste où la monarchie des Habsbourg a fondé en 1902 l’Institut communal pour les habitations minimales (ICAM). En un siècle d’industrialisation et d’urbanisation, la population triestine passe de 57 000 à 220 000 habitants. Le port franc entasse les anciens paysans devenus ouvriers dans des habitats insalubres de la vieille ville où maladies et grogne sociale se développent jusqu’à provoquer la première grève de l’empire. Par un mélange de prophylaxie, d’hygiénisme et de paternalisme social, les grands employeurs privés, comme l’armateur Lloyd ou les grandes compagnies d’assurance, construisent des logements pour les employés. Mais l’État, autrichien jusqu’en 1919 puis italien, prend les choses en main. Sous le fascisme, ATER se met au service du dessein mussolinien de construction d’une classe moyenne accédant à la propriété. Aujourd’hui, l’agence dépend administrativement de la région Frioul-Vénétie Julienne (gouvernée par la Lega), dont elle applique les directives. L’un de ses derniers réquisits ? Résider depuis cinq ans en continu sur le territoire régional pour pouvoir briguer un logement social.
Presque quarante ans après son ouverture, le Quadrilatère a les apparences d’une utopie éteinte. Si son dédale de passages couverts répartis autour de la grande cour centrale laisse filtrer la lumière par de grandes fenêtres-hublots, on n’y croise guère âme qui vive. Le promeneur égaré à Rozzol oublie sa proximité avec l’une des plus belles villes d’Europe, dont la piazza Unità d’Italia fait le bonheur des touristes. Les vieilles carcasses qui s’y traînent en déambulateur, les quelques familles avec enfants et les jeunes tatoués de Melara ne vivent pourtant pas tout à fait en vase clos.

Toute la Botte connaît désormais ces couloirs pleins d’entrepôts vides, décor de la série télévisée à succès La Porta Rossa.
Cependant, au quotidien, les petits commerces intégrés en son sein se comptent désormais sur les doigts d’une main et l’objectif initial de 2 500 habitants a été revu de moitié. Aujourd’hui, le quartier fait l’objet d’un plan de requalification urbaine, à hauteur de 18 millions d’euros, financé par l’État et la ville.
Constat d’échec ? Pas si vite. Pour sortir des idées simples, rien ne vaut les témoignages des premiers concernés. Genny, Claudio, Katia, Federico, Ares et les autres habitent Rozzol Melara depuis des années. Ces Italiens des confins racontent les joies, les peines et les désillusions nourries à l’ombre du béton. Tous décrivent un système social grevé par vingt ans de récession et éclairent d’un jour original la crise de foi dans la
politique.
Dans l’unique bar du Quadrilatère, ouvert au mois de juillet, Genny, 55 ans, dont vingt-trois passés à Rozzol, se souvient de son arrivée. « Quand on nous a attribué l’appartement, mon mari s’est mis à pleurer en se lamentant : “Non, pas là !” parce que c’était surnommé le “Bronx” – mais on y a finalement vécu assez paisiblement.
» Au sixième étage, son « petit » appartement de 70 m2 avait été réaménagé aux frais du bailleur social pour les besoins de son époux handicapé. Devenue veuve, elle occupe toujours le même logement moyennant 80 euros de loyer mensuel indexé sur ses (maigres) revenus et sa situation familiale. « Comme j’habite seule, j’ai une remise de 20 % sur le loyer. Mais je paie beaucoup plus en facture d’eau. En plus, il y a cette histoire de rétroactivité des tarifs à rattraper depuis le 1er janvier 2018. Quand la facture arrivera, ce sera terrible. Ça me met en colère parce que le prix exorbitant de l’eau était un cheval de bataille grilliste », confie cette sympathisante de « Cinque Stelle » (le Mouvement 5 étoiles). C’est notamment pour ces pauvres vieilles, qui vont puiser l’eau au robinet extérieur faute de pouvoir payer les factures, que Genny œuvre avec la banque alimentaire. Le système social italien, elle en connaît tous les travers à force d’avoir été éprouvée par la vie. Des années durant, l’amour conjugal l’a transformée en garde-malade à domicile. À la mort de son mari, cette ex-employée du terminal de fret Fernetti, à la frontière slovène, entendait reprendre du service. « J’ai appelé les services sociaux. Comme cela faisait vingt-trois ans que je ne travaillais plus, je voulais suivre des formations pour revenir dans le monde du travail. Ils m’ont répondu : “Non, nous ne faisons plus ce genre de choses que pour les extra-Européens.” C’est comme ça que les gens deviennent racistes. » Genny ne cède pas pour autant à la tentation Salvini, gardant un souvenir traumatique du « congrès de naissance de la Ligue du Nord » auquel elle a assisté, marqué par les cris « Romains = voleurs » de la vieille garde autonomiste. Aujourd’hui inquiète de la mauvaise gestion de l’afflux migratoire, Genny a prévu de visiter un camp de migrants en Bosnie. Des Afghans, Pakistanais, Syriens ou Tunisiens dont certains en état d’urgence sanitaire qui risquent de grossir les rangs des 1 500 migrants déjà officiellement recensés à Trieste.
À Rozzol, une Somalienne voilée « parfaitement intégrée » se rend régulièrement à la distribution alimentaire du samedi, tranchant avec l’origine yougoslave (Slovènes, Croates, Serbes, Kosovars) de la plupart des non-Italiens. On m’apprend d’ailleurs l’expression dialectale désignant les Triestins pur sucre : patochi. Un terme moins aimable qualifie l’étranger yougoslave, dont Trieste fut pourtant l’un des berceaux historiques : s’ciavo (« esclave »).

© Emma Rebato
Entre deux conciliabules, je rencontre Katia. À 52 ans, dont trente-neuf à Melara, elle aussi paie 80 euros de loyer… pour un appartement de 98 m2. Pas de quoi flamber : cette mère de cinq enfants en instance de divorce ne gagne que 400 euros par mois en nettoyant le port. Depuis 1980, elle n’a jamais quitté le bloc, passant du foyer familial de 12 enfants au mariage, puis à la condition de mère seule avec deux fils à charge. « Avec mes parents, on habitait un appartement de banlieue avec seulement une chambre et une cuisine alors que j’avais déjà six frères et sœurs. Quand on a déménagé ici, pour nous c’était un château, vraiment le paradis ! Nous avions tellement d’espace pour jouer, tant de vert » dans la cour centrale… À l’époque, il n’y faisait pourtant pas toujours bon vivre. Venus à Melara avec leurs parents, des adolescents proliféraient, formant une bande de jeunes qui se frottait aux autres quartiers et entendait faire la loi chez elle. « Je suis devenue très bagarreuse pour défendre mes petits frères », en sourit encore Katia avant de relativiser. « Les drogues, même fortes, circulaient, la police contrôlait et arrêtait souvent les dealers, puis cela s’est calmé. Tout est beaucoup plus caché aujourd’hui. » Un autre habitant de la première heure, Claudio, 72 ans, infirmier à la retraite et président du comité de quartier, confirme cette loi des séries : « Des jeunes entre 16 et 20 ans voulaient jouer les caïds. Au bout de dix ans, soit ils se sont rangés, soit ils ont fini en prison, fous ou morts ! »

À mesure que la population du bloc avançait en âge, le gouffre générationnel s’est creusé. 50 % des foyers se composent d’une seule personne, 30 % de deux, signe que les résidents sont restés dans les murs après le départ de leurs enfants, comme les y incite le barème de loyer. Sauf improbable gain au loto, qui leur ferait payer un surloyer de 1 200 euros, les locataires conservent leur logement social ad vitam. Les faire déménager dans des appartements plus petits coûterait trop cher au bailleur ATER. Si les prix de l’immobilier demeurent raisonnables, la crise sociale a toutefois incité 4 600 citadins à postuler à la dernière offre de logement social. Du jamais vu…
Requalifier, pour quoi faire ?
Il y a de quoi être jaloux. À Trieste, le plan national sur les banlieues ne concerne que Melara. 27 interventions sont programmées afin de requalifier le Quadrilatère et de sécuriser la circulation au profit des 8 000 habitants de toute la zone. La mort d’une adolescente renversée par une voiture en décembre 2016 à un rond-point a alerté la ville. L’adjointe aux travaux publics, Elisa Lodi, annonce une refonte de la voirie « pour les piétons qui pourront traverser le quartier en sécurité jusqu’à l’hôpital de Cattinara ». Vague verte oblige, des « îles écologiques » [sic] supplanteront les grandes poubelles de rue. Tri des déchets, local vidéosurveillé où déposer ses encombrants 24/24 h sont aussi au programme. Plus largement, l’adjointe aspire à « recoudre un quartier entier ». L’amphithéâtre central sera rénové, une bibliothèque d’archives ouverte au premier étage et l’entretien des parties communes partiellement assuré par les résidents eux-mêmes. La banlieue, ça fait rêver.
Grâce au travail des associations, le tissu humain s’écaille moins vite que la peinture. Entre voisins, on se cotise parfois pour payer les obsèques d’un mort parti sans le sou. Mais un fossé culturel sépare les vieux qui rient des jeunes qui pleurent. Les retraités apprécient en effet le réseau de services et de commerces, disponible à portée de main : supérette en bas du bloc, parking couvert, pharmacie, cafés, église, école, gymnase, bureau de poste et cabinet médical intégrés. Le tout avec une vue imprenable sur le golfe et les côtes d’Istrie. Un panorama insuffisant pour combler les attentes des jeunes adultes. Comme s’en désole Katia, rien ou presque n’est vraiment prévu pour eux. Exception faite du terrain du foot voisin et du « Centre pour la vie », l’une des nombreuses associations encadrées par l’Agence de santé (voir encadré ci-contre), dont le but avoué est d’éviter les avortements pour motif économique. Les graffitis psychédéliques peints par l’association Mel’Art sur les murs intérieurs des passages couverts ne suffisent pas à donner aux locataires les couleurs qui manquent à leur décor. « Beaucoup de choses ont fermé. Autrefois, il y avait une rôtisserie, un marchand de fruits et légumes, une poissonnerie, une parfumerie… » se lamente Katia. D’après Fulvio Capovilla, le directeur du secteur entretien d’ATER-Trieste, tout était couru d’avance. À supposer que la promesse originelle de 2 500 habitants ait été tenue, ce bassin de clientèle n’aurait pas suffi à entretenir un tissu commercial digne de ce nom. Motorisé ou non, chacun fait ses courses dans des grandes surfaces. Et malgré l’excellent réseau d’autobus qui maille la ville frontière, le bloc reste terra incognita pour le Triestin lambda.
Pour tuer l’ennui, en tant que présidente de l’association Melara et chanteuse émérite, Katia ne ménage pas ses efforts. Catholique déçue par le Parti démocrate, elle s’emploie à distraire petits (colonies de vacances, théâtre) et grands (fête de la bière, gymnastique, zumba, danse…). Son fils cadet Federico, 26 ans, a créé avec des amis l’association de quartier Quarto Quadro, devenue célèbre pour avoir nettoyé de fond en comble le jardin et les galeries du Quadrilatère. L’opération « Melara Pulita » a partiellement corrigé l’image déformée de la jeunesse propagée par le documentaire Città Visibile (2019). Federico et ses amis y devisent face caméra, clope au bec et canette de bière à la main. « On est passés pour des gens louches qui passent leur vie à jouer au foot et faire des choses étranges », regrette Federico, rejoint par son ami, Ares, 31 ans, selon lequel ils ont « toujours été vus comme les pommes pourries » de Rozzol. Après avoir eu des mots avec la structure qui chapeaute les associations, le groupe d’amis travaille à l’organisation d’événements qui divertissent les jeunes et redorent l’image du quartier. Le troisième larron de l’assoce, également prénommé Federico, 33 ans, déménageur à ses heures et père d’un enfant, me sensibilise aux questions de santé publique. Lui connaît trois résidents, « pas si vieux », emportés l’an dernier par une tumeur. Certains pointent du doigt les radiations émises par les antennes-relais installées sur le bloc, d’autres s’inquiètent de l’amiante présent dans les sols et la tuyauterie. Elle-même atteinte de trois tumeurs osseuses, Genny a recensé une quarantaine de cancers survenus ces six dernières années. Ses examens sanguins, elle les pratique dans une clinique privée, « parce que ça coûte moins cher que de payer le ticket de santé publique instauré par l’ancienne présidente de région » de centre gauche. Interrogée par mes soins, l’adjointe à l’urbanisme Luisa Polli (Lega) précise le diagnostic : Trieste a le plus haut taux de cancer du poumon de toute l’Italie. L’élue voit deux facteurs de risques : la fonderie de fer et sa pollution aux particules que charrie par rafales la bora, ce vent triestin dévastateur. Si les derniers tests scientfiques effectués à Melara disculpent l’amiante, nombre d’habitants critiquent le délabrement de l’habitat. « Il pleut dans les galeries couvertes ! » balance un anonyme. Chez Katia, ATER a pris soin de changer le linoléum morcelé. « En dessous, on a découvert des termites et 3 % d’amiante. Ils ont mis du carrelage dans le séjour, la cuisine et le couloir. » Ce qu’on appelle un replâtrage…


Les topolini, ces trottoirs du bord de mer qui cachent sur les pavés la plage, ne sont pas la seule spécialité triestine. Dans les années 1970, le psychiatre Franco Basaglia y a mené une révolution sociale qui aboutira au vote de la loi 180 (1978) prévoyant la fermeture de tous les asiles italiens. Après une première expérience à Gorizia, Basaglia a dirigé l’hôpital psychiatrique triestin San Giovanni en inversant la thérapie traditionnelle : faire sortir les malades dans la ville pour les soigner au contact de l’extérieur. Vingt ans après, cette médecine communautaire a inspiré le projet « Habitat microaree » que l’Agence de santé a mis en place avec ATER et la municipalité de Trieste dans 16 points de la ville. Ignorée de la plupart des 200 000 habitants, l’expérience pilote concerne 18 000 personnes en état de difficulté sanitaire et sociale. Comme le montre le documentaire La Cittàche che Cura (2019), médecins, infirmiers et travailleurs des coopératives offrent un suivi individuel, des réunions d’échange et une dose de sociabilité aux malades, notamment toxicomanes, alcooliques ou déficients mentaux. À Rozzol Melara, l’infirmière Lorella Postiferi anime une équipe d’une dizaine de personnes pour notamment prodiguer « une aide et des services presque à la demande » aux « gens vraiment pauvres qui n’ont pas de familles et ne demandent rien ».
Au fond, Rozzol Melara illustre de façon paroxystique les illusions des Trente Glorieuses. Queue de comète de l’après-guerre, sa conception en 1968 a coïncidé avec la fin du grand programme national de reconstruction INA-Casa. La densité de Melara, ses toits-terrasses, son usage du béton, son réseau de galeries couvertes qui font office de rues internes au Quadrilatère rappellent l’unité d’habitation de Le Corbusier. Bref, une petite ville en soi. L’aspect grisâtre du bloc ressemble à s’y méprendre au couvent de la Tourette, que le théoricien de la « ville radieuse » a dessiné près de Lyon. Or, ce que Salvador Dalí appelait « l’architecture d’autopunition » est paradoxalement le fruit de longues réflexions sur les rapports entre individu et habitat collectif. Comme l’explique la chercheuse en planification urbaine Elena Marchigiani, adjointe à l’urbanisme de la ville de Trieste sous la précédente administration de centre gauche (2011-2016), « dès les années 1930, la lutte contre l’individualisme a régi de nombreux projets architecturaux et urbains. À Rozzol, où personne n’est propriétaire, cette exacerbation du collectif a entraîné un désinvestissement individuel des espaces publics ou semi-publics, du palier aux promenades ». Outre des travaux d’ampleur, le plan de requalification prévoit justement d’impliquer les résidents dans l’entretien des corridors. Cela suffirat-il ? À en croire Marchigiani, l’enveloppe de 18 millions d’euros ne suffira pas à mettre aux normes ce grand ensemble énergivore qui ruine les locataires en facture de chauffage. Autrement plus coûteux, un plan Borloo de démolition serait éventuellement une solution plus pérenne que ce cautère sur une jambe de bois, sachant que « au bout de cinquante ans, ces constructions commencent leur fin de vie… ». Certes, tout n’est pas à jeter : l’école du bloc attire enfants et parents de toute la ville grâce à son excellent niveau. Et les locataires de Rozzol demandent moins à quitter leur lotissement que ceux des autres blocs de logements sociaux, peu pourvus en commerces et jouxtant parfois la fonderie.

© Emma Rebato
En périphérie de la plus âgée des villes italiennes – 35 % des Triestins ont plus de 60 ans –, Simone Modugno, jeune pigiste du quotidien local Il Piccolo, suit les affres de Melara. Lors des réunions de présentation du plan, il a été frappé par la fronde des locataires contre le projet de chauffage centralisé. Beaucoup ne comptent pas renoncer au chauffage individuel, certes plus onéreux, mais modulable à domicile. Le jeune homme sourit de ce « souverainisme des chaudières ». Salvini compte bien réchauffer les plus frileux.