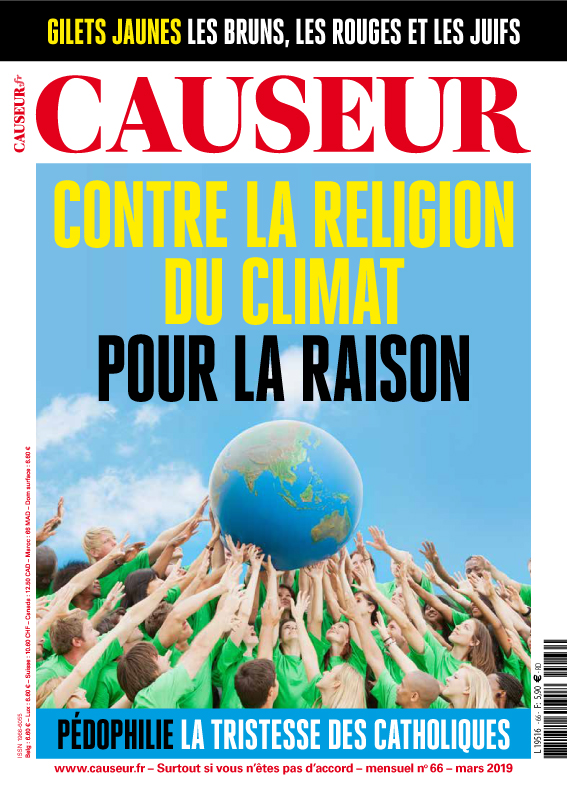Instrumentalisant la cause des Indiens d’Amazonie, ONG et mouvements indigénistes ont pris le contrôle d’un septième du territoire brésilien. Leur écologisme radical se heurte aux intérêts des agriculteurs… et aux aspirations de nombreux Indiens. Enquête.
Les médias européens racontent souvent des histoires de bons et de méchants, notamment lorsqu’ils traitent de sujets lointains qu’ils connaissent mal, comme le sort des Indiens du Brésil. En janvier dernier, après son investiture, Jair Bolsonaro, le nouveau président du pays, a décidé de confier la délimitation des territoires indiens au ministère de l’Agriculture. Auparavant, cette mission incombait à la Funai, la Fondation nationale de l’Indien, un organisme créé en 1967 et rattaché au ministère de la Justice. Ce transfert de compétences a suscité une bronca des ONG et des mouvements indigénistes. À de rares exceptions près, la presse du Vieux Continent a pris leurs arguments pour argent comptant. À les entendre, le nouveau président s’apprête ainsi à détruire plus de cinquante ans de travail pour l’attribution des terres aux peuples indigènes pour livrer les territoires ancestraux à l’appétit vorace de l’ « agribusiness ». La preuve ? Lorsqu’elle était députée fédérale (de 2014 à 2018), la ministre de l’Agriculture choisie par Bolsonaro était le chef de file du lobby parlementaire « ruraliste », réputée défendre les intérêts des grands propriétaires terriens.
A lire aussi: Le Brésil, victime des clichés samba-cocotiers
Fin 2018, le Brésil comptait 896 900 Indiens (0,43 % de la population totale) répartis en 305 ethnies différentes. La constitution brésilienne (adoptée en 1988) accorde à ces populations un droit d’usufruit des territoires ancestraux sur lesquels elles sont installées et où la loi indigène fait foi. Ces terres restent néanmoins la propriété de l’État fédéral. Lorsqu’une ethnie revendique un territoire, l’État engage un processus de démarcation en plusieurs étapes. Si la première phase d’étude est concluante, la fondation délimite l’espace sur lequel le droit d’usufruit sera exercé. Ensuite, le ministère de la Justice rend public un projet d’homologation. Celui-ci peut alors être contesté par les occupants non indigènes des lieux (propriétaires en titre de foncier, locataires de bonne foi), qui sont menacés de devoir quitter le territoire délimité. Si les contestations sont jugées irrecevables, le chef de l’État homologue puis régularise les terres de réserve. Après une évaluation des pertes subies par la Funai, les expulsés peuvent cependant être indemnisés. Ces terres indigènes sont de véritables sanctuaires, dont l’accès est réglementé pour les non-Indiens et