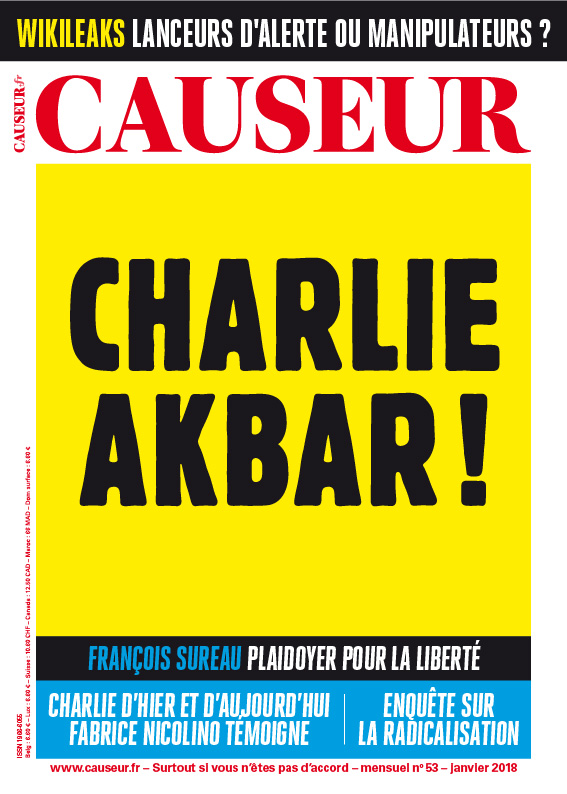Gallimard a réuni en un seul volume les écrits de Perros (1923-1978). Ses aphorismes, notes, critiques et poèmes font découvrir un styliste brillant et marginal, rétif aux figures imposées de la littérature.
Quarto a réuni en un seul volume les écrits de Perros : aphorismes, notes, critiques, poèmes pour un écrivain mort il y a quarante ans et dont le premier désir a été de se connaître pour mieux connaître les hommes.
« Décidément, je ne suis pas foutu d’écrire un roman. Ce n’est pas que j’essaie, non. Mais je me demande à quoi rime ce que j’écris. Je ne me sens pas moderne du tout. J’ai plutôt envie d’être sincère qu’objectif », nous dit Georges Perros (1923-1978) dans Papiers collés, III. Cela explique peut-être pourquoi cet écrivain majeur reste aujourd’hui encore, quarante ans après sa mort, aussi confidentiel. L’impérialisme du roman, qui est devenu synonyme de littérature depuis deux siècles, a tendance à marginaliser les inclassables, les poètes, les amants du fragment ou de la note, comme le fut Perros.
Perros est un marginal, parce qu’au sens littéral, il écrit d’abord dans les marges : « Certains maniaques, dans la marge du livre fiévreusement découpé, ne peuvent s’empêcher de déposer, comme instinctivement, le résultat à peine intelligible de leur réflexion. Font un livre, hybride, avec l’œuvre lue. Il arrive que leurs remarques soient plus intéressantes que le discours qui les a provoquées. » Perros a d’ailleurs lui-même créé le néologisme de « noteur » : il estime être plus « noteur » qu’auteur. Un auteur, pour lui, c’est un statut toujours un peu vain, comme tous les statuts. Et il fut bien placé, en tant que soutier chargé de rapports de lecture à la NRF, pour voir à l’œuvre cette vanité de la vie littéraire : « Un type qui écrit deux cents pages sur sa veulerie, sa saloperie, sa médiocrité, son néant, allez, on lui file le prix Goncourt. » Ne nous méprenons pas, il n’y a pas d’aigreur chez Perros, jamais. Plutôt une ironie qui sous sa plume prend la forme d’une bienveillance sceptique et amusée pour toute la comédie sociale à laquelle il participera un temps, avant de s’exiler en Bretagne.
On peut espérer que son œuvre, recueillie aujourd’hui avec une minutie exhaustive et amoureuse par Thierry Gillybœuf dans un fort volume Quarto de plus de 1 500 pages – cette antichambre de la Pléiade –, viendra pallier ce manque de reconnaissance. Pour un peu, on lui en voudrait, à Thierry Gillybœuf, d’exposer notre Perros au public. Perros fait partie de ces écrivains, comme Louis Scutenaire, André Hardellet ou Jean-Claude Pirotte, dont la gloire s’accroît en secret, que l’on se transmet comme un mot de passe entre amateurs qui n’aiment pas trop la lumière du jour sur leurs bibliothèques pleines de contrebandiers, de déviants et de poètes.
Il ne faut pas, bien sûr. Georges Perros, par sa simplicité,