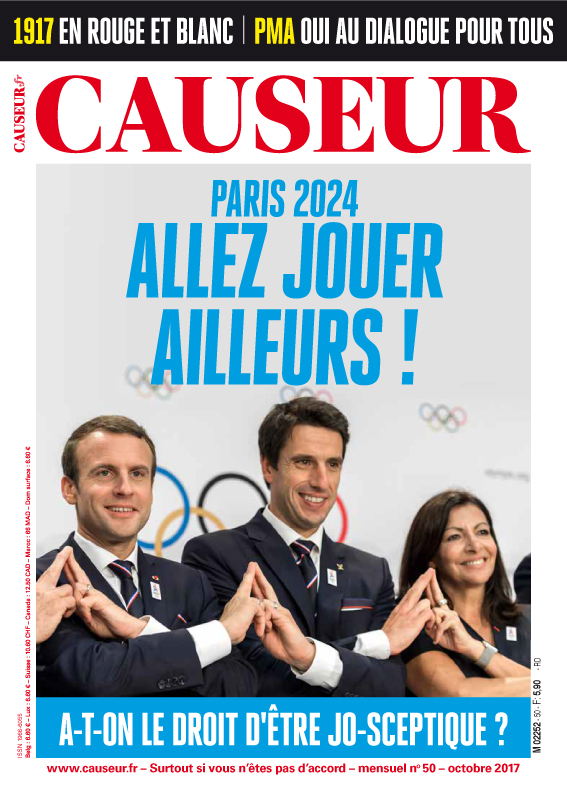A l’occasion du centenaire de la mort de Léon Bloy, la collection « Bouquins » a réuni en un seul volume ses Essais et Pamphlets. On y trouvera mille preuves que cet imprécateur catholique antimoderne est avant tout un très grand écrivain.
Léon Bloy nous manque. Comme nous manquent Barbey d’Aurevilly, Bernanos ou Pasolini. Imprécateurs désespérés, marathoniens de la colère, révoltés antimodernes, tous se sont tus, apparemment une fois pour toutes. Aucune voix, désormais, pour troubler le consensus et nous réveiller d’un totalitarisme doux – et choisi – qui nous conduit à nous extasier sur les nouvelles technologies, les trains à grande vitesse, les algorithmes du trading à haute fréquence, la vie virtuelle comme substitut de la vraie vie pendant que sur terre, l’horreur réelle est quotidienne. Celle, banale dans nos contrées développées, d’une existence aliénée, « séparée » aurait dit Guy Debord. Celle, aussi, de la violence planétaire qui frappe partout, toujours et encore, les plus pauvres.
Les pauvres… Le mot a quelque chose de démodé, n’est-ce pas ? De démodé et de brutal à la fois : dans les discours politiques, même de gauche, comme dans la néo-langue sociologique ou technocratique, on préfère le substantif, plus impersonnel, de « pauvreté ». Les pauvres, eux, sont au cœur de l’œuvre de Léon Bloy et le mot, chez lui, est aussi fréquent que les offenses qui leur sont faites. Nous oublions les pauvres, nous dit Bloy, preuve que nous avons oublié Dieu et construit l’enfer sur terre avant de le connaître dans l’au-delà.
« Le riche est une brute inexorable qu’on est forcé d’arrêter avec une faux ou un paquet de mitraille dans le ventre. »
Léon Bloy nous manque aussi parce qu’il était le seul, ou presque, à maudire ce qu’il voyait s’édifier sous ses yeux et que tous applaudissaient au nom du progrès. Dans Belluaires et Porchers, il a dit sa détestation de la « Babel de fer », autrement dit la tour Eiffel : « On ne la sent pas fraternelle comme les autres monuments de Paris. Elle ressemble à une étrangère d’Orient et on devine bien qu’elle n’aura jamais pitié de nos pauvres. » Ou encore du métropolitain : « bruit infernal, danger certain, mort probable – et quelle mort ! – toutes les fois qu’on descend dans ces catacombes. Impression de la fin des sources, de la fin des bois frissonnants, des aubes et des crépuscules, dans les prairies du Paradis. De la fin de l’âme humaine. » On rêve, du coup, de ce qu’il aurait écrit, par exemple, au sujet des smartphones, qui ont enfermé les attributs de la divinité dans des applications et des moteurs de recherche, donnant l’illusion prométhéenne d’être omnipotent, omniscient, maître d’un présent perpétuel.
Bloy est autant l’« entrepreneur de démolitions » du stupide xixe siècle que le prophète de xxe et même du xxie. Mourir un 3 novembre 1917 en fait le contemporain du carnage mondialisé de la Grande Guerre