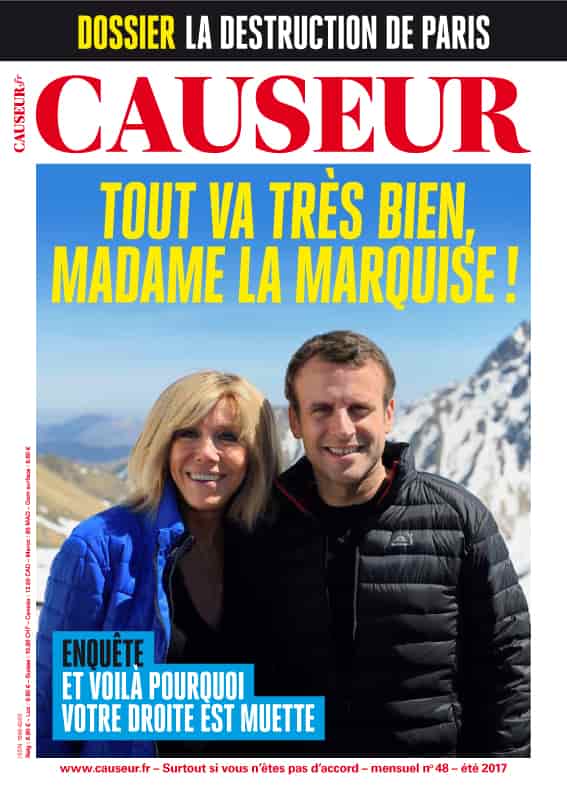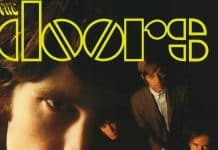Sous des prétextes écologiques, sociaux, culturels, touristiques, nos édiles bradent l’âme et l’histoire de la capitale au profit des marchands du temple. Heureusement, une poignée de Parigots résistent…
Causeur. Vous êtes président de Sites & Monuments, la plus ancienne association de défense du patrimoine, et à ce titre vous avez engagé de nombreuses procédures contre la Ville de Paris. Pour quelles raisons ?
Alexandre Gady. Notre rôle, en tant qu’association nationale reconnue d’utilité publique, est de défendre au mieux le patrimoine naturel et bâti, notre bien commun, et dans le cas où celui-ci serait menacé, d’intervenir. Nos combats s’inscrivent dans le droit fil d’un héritage et d’une expertise plus que centenaire, puisque l’association a été créée en 1901. C’est un des bienfaits du système démocratique : les citoyens veillent ainsi à la bonne marche des affaires de la cité. Et comme rien n’est parfait en ce bas monde, la Mairie de Paris commet parfois des erreurs : nous essayons donc de l’aider à faire mieux.
Agir signifie forcément se battre : de quels moyens disposez-vous ?
Le pouvoir des associations est mince. Dans les années 1990, sous l’impulsion d’un jeune et brillant avocat, Olivier Chaslot (décédé en 2009), nous avons développé une activité alors rare dans les associations de défense du patrimoine, pour des raisons à la fois de moyens, mais aussi de culture : les procédures judiciaires. Celles-ci sont longues évidemment, et aléatoires car elles s’effectuent devant la justice administrative, inventée par Napoléon : tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, enfin Conseil d’État au bout de la chaîne, une institution sans doute trop liée au pouvoir politique (qui en nomme certains membres à discrétion), comme on l’a vu dans l’affaire de la Samaritaine (voir encadré). Ces actions sont fondamentales pour peser dans le débat autrement que par des gentils courriers ; il faut se donner les moyens de peser dans la décision quand elle est trop loin des citoyens.
A lire aussi: Paris n’est plus vraiment Paris
Ces procédures sont coûteuses : comment faites-vous ?
Une association vit d’abord des cotisations de ses adhérents, et nos premiers procès ont été faits avec des bouts de chandelle. Puis, nous avons cherché du mécénat. Aujourd’hui, nous faisons comme tout le monde, du fund raising : on lève des fonds via le site de l’association, parfois par le biais de pétitions, pour des causes précises : ce sont des « dons affectés ». La bataille du jardin botanique d’Auteuil, par exemple, a été un succès formidable de ce point de vue. Malheureusement, l’enthousiasme citoyen ne garantit pas nécessairement le succès devant la justice administrative.
Le jardin botanique des serres d’Auteuil
Construire un stade de 5 000 places en béton dans un jardin botanique en site classé et protégé au titre des Monuments historiques, que même B. Delanoë jugeait en 2006 inviolable : voilà l’exploit de la Fédération française de tennis, activement soutenue par Matignon, M. Valls regnante, le ministère de la Culture et… la Mairie de Paris, propriétaire du jardin. Sites & Monuments, avec d’autres associations, a élaboré dès 2011 un projet alternatif chiffré et obtenu en référé la suspension du permis en mars 2016, alors que les bulldozers approchaient. Las encore ! Le Conseil d’État a cassé le jugement, permettant à la FFT de raser un ensemble de serres techniques et d’abattre une centaine d’arbres en septembre dernier. L’affaire est toujours pendante au fond devant la cour administrative d’appel, mais le résultat est connu : le stade est en chantier.
Il existe tout de même une instance patrimoniale, la Commission du Vieux Paris : quel est son rôle ? Dans quelle mesure peut-elle intervenir sur des dossiers de ce genre ?
La Commission du Vieux Paris est un organisme consultatif placé auprès de la mairie, institution que je connais bien puisque j’y ai travaillé pendant six ans. Officiellement, c’est un organisme libre, que les gens prennent pour une association à cause de son nom, mais qui est de fait une véritable instance municipale. L’arrivée de la gauche à Paris en 2001