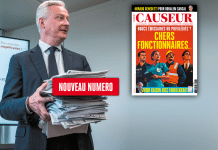Même si l’on peut y trouver des différences, la continuité entre le Brexit et l’élection présidentielle américaine semble difficile à contester. On ne saurait mieux le dire que Marie Viennot, qui, dans son « billet économique » de France Culture du 8 novembre, affirmait : « Remplacez Bruxelles par Washington, les propos xénophobes sur les immigrants de l’Est, et ceux du Mexique. Jetez un œil aux réactions des marchés financiers, des médias, des économistes, quasiment tous anti-Trump. Le candidat républicain dit être un Brexit US, et espère faire mentir les sondages […] Les gens veulent des frontières, ils ne veulent pas de cette arrivée massive de gens qu’ils ne connaissent pas, c’est leur volonté… Les discours anti-mexicains de Donald Trump ressemblent à s’y méprendre à ceux de U-Kip, le parti pro-Brexit. Comme lui, Donald Trump veut rallier les déclassés. »
Donald Trump revendique clairement cette continuité ; lors de son meeting à Raleigh dans le Michigan, la veille du scrutin, il clamait: « demain ce sera une journée véritablement historique. Ça va être un Brexit puissance trois ».
On se souvient des réactions qui ont suivi le Brexit : Bernard-Henri Levy et Alain Minc mettent en cause les électeurs, et reçoivent en retour une volée de bois vert en châtiment du soi-disant délit d’ignorance et de mépris des « vrais gens ».
On connaît la boutade célèbre de Bertolt Brecht qui fait dire à un de ses personnages : « Le peuple a par sa faute perdu la confiance du gouvernement il convient donc pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre ». Elle a été assez abondamment sollicitée en cette occasion. Elle a probablement encore servi pour l’élection de Donald Trump. Le débat se pose, en tout cas, dans les mêmes termes.
Il peut arriver à l’élite de dire la vérité
Est-ce à dire que toute réflexion sur la rationalité d’un vote populaire est interdite ? Après les attentats du 13 novembre, Manuel Valls déclarait : « expliquer de tels actes, c’est déjà vouloir un peu excuser ». A l’inverse, une tentative d’analyse du vote des catégories en voie de déclassement serait-elle déjà une façon de les stigmatiser ?
Comme pour la question de l’islamisme, il s’impose à tout effort de lucidité de se blinder contre l’accusation d’islamophobie, ne faut-il pas se protéger contre un autre missile idéologique, sur un tout autre front, qui ferait d’une mise en examen (au sens sociologique !) du vote populaire un nouveau crime en « mal-pensance » ? Comme il y a un CCIF (Comité contre l’islamophobie en France), y aura-t-il prochainement un CCPP (Comité contre la « populophobie » partout) ? Osons ajouter à la sauvette qu’il peut arriver à des membres de l’élite de dire la vérité.
Soyons clair : s’il doit être permis de mettre en doute la rationalité du vote d’une partie déshéritée du peuple américain qui a permis l’élection de Trump, cela n’équivaut, en aucun cas, à le mépriser, ou à manifester quelque condescendance. On s’efforcera ici au contraire de dénoncer l’environnement informationnel dans lequel il a bien peu de chances de se construire des représentations valides des causes de son déclassement, ou de son malaise identitaire.
Le ressentiment que l’on peut éprouver à l’égard de la mondialisation libérale, du libre-échange forcené, de l’impuissance européenne, etc, est évidemment compréhensible, et il est logique qu’il se traduise parfois en agressivité vis-à-vis des élites qui s’en félicitent et ne préconisent rien d’autre que d’aller plus vite et plus loin dans la même direction.
La facile lapidation symbolique des responsables
Avec l’élection de Trump, on peut si l’on y tient se réjouir de la gifle à l’establishment, aux politiciens traditionnels, aux journalistes, aux sondeurs, etc. Mais Guignol rossant les gendarmes ne saurait constituer une politique, ni offrir de solutions aux perdants de la mondialisation. La question d’une recherche des voies permettant de sortir de ce marasme – après une analyse lucide – est autrement plus importante que la facile lapidation symbolique des responsables qui nous y ont englués.
Il faudrait être vigilant au fait que se réjouir d’une bonne leçon administrée aux bien-pensants thuriféraires de la mondialisation heureuse, incite à glisser subrepticement vers une sorte d’indulgence, de compréhension, voire de sympathie diffuse pour l’énergumène propulsé aujourd’hui à la tête du plus puissant pays du monde. On peut ainsi lire des quasi-compliments étonnants : Alexis Brézet, dans Le Figaro du 10 novembre, écrit : « Parce qu’il n’est pas du sérail, parce qu’il n’est prisonnier d’aucun tabou, Donald Trump a su mettre ses mots sur des sentiments que les autres ne voulaient pas nommer ». Donald Trump devient l’homme qui fait « exploser les codes », qui tranche avec « les timidités d’Obama à désigner l’islamisme radical »… timidités qui de ce fait apparaissent plus coupables que les injures ouvertement racistes de Donald Trump, ou l’affichage de ses préférences pour les régimes dictatoriaux.
Cette implicite connivence se lit également entre les lignes des anticipations de ses actions à venir. Sa politique sera-t-elle après tout si néfaste ? On voit bien que la bourse réagit plutôt bien depuis l’élection… Les membres raisonnables du Parti républicain, les institutions, la constitution, les experts, l’armée, les chinois, que sais-je… ne seront-ils pas autant de garde-fous ? En d’autres termes, faut-il se tenir prêt à féliciter le nouveau président de faire une bonne politique malgré lui, en quelque sorte ?
L’élection de Trump, défaite de la réalité…
La tonalité dominante semble être celle que Pascal Brukner exprime pour Le Figaro, affirmant qu’il y a eu « vengeance du réel », « victoire du principe de réalité ». On soutiendra ici que c’est tout au contraire la virtualité qui a terrassé la réalité.
C’est saisissant : plus de 40 % des femmes ont voté pour Trump, ainsi que plus d’un tiers des Latinos et 12 % des Afro-Américains. Il en va de même, on le sait, d’une grande partie des classes moyennes inférieures des régions les plus désindustrialisées. La réalité est brutale : une grande partie de ses électeurs, la majorité peut-être, a voté contre son intérêt direct ; et, si on prend en compte l’intérêt collectif (qu’on me pardonne encore cette préoccupation incongrue), c’est à leur quasi-totalité que l’on peut appliquer cette assertion. Et cela pour de multiples raisons qu’on ne peut que survoler ici, en donnant juste quelques arguments :
– On voit mal comment l’application de son programme pourrait améliorer la situation de son électorat populaire en réduisant l’impôt sur les sociétés de 35% à 15%, ainsi que celui des contribuables les plus riches (la tranche la plus élevée passant de 39,6% à 33%), ce qui en outre ne manquerait pas d’aggraver le déficit budgétaire, en plus des abattements fiscaux destinés à financer un programme de 1.000 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures.
– Inutile de développer les désastreuses conséquences qu’auraient, pour les plus pauvres, la remise en cause des réformes du système santé d’Obama.
– Il ne faut pas oublier que si la mondialisation explique en partie la dégradation de la situation de beaucoup elle est inséparable de la domination des puissances financières. Or, on sait que Trump compte abroger la loi Dodd-Frank de 2010, en d’autres termes récidiver avec la dérégulation reaganienne qui est à l’origine de l’énorme crise de 2008. On voit mal l’avantage que la fraction populaire de l’électorat du nouveau président pourrait en retirer…
– Au contraire, le programme d’Hillary Clinton avait assurément davantage de chances d’améliorer la situation du pays. Comme l’indique Philippe Askénazy dans Le Monde du 11 novembre, « Des dizaines de milliards d’investissements publics auraient été déployés pour construire des barrages ou des fermes solaires, ou encore rénover les logements, le tout en redéployant les subventions aux énergies carbonées et en renforçant les normes environnementales. ». De nombreuses avancées sociales visaient directement les plus nécessiteux.
… mais victoire de la virtualité
L’accession au pouvoir de ce personnage qui n’a rien à y faire est souvent interprétée, avec un enthousiasme plus ou moins discret, comme étant la fin d’un monde, et l’avènement d’un nouveau…
En fait cet évènement a été rendu possible parce qu’un monde nouveau est déjà advenu, et exerce son emprise depuis déjà plusieurs décennies. Il est l’aboutissement et non l’annonce du changement. Guy Debord avait théorisé la Société du spectacle, dans sa première forme, en 1967 : il conviendrait maintenant d’actualiser ses analyses, en prenant en compte la révolution de la communication qui alors n’en était qu’aux prémices.
Certes, les sondages indiquent, aux Etats-Unis comme en France, la baisse de la confiance vis-à-vis des médias, que ce soient les journaux, la télévision ou l’internet. Les journalistes sont perçus comme faisant partie de ces élites discréditées. Il est toutefois significatif que ce sont les réseaux sociaux – Facebook notamment – qui résistent le mieux à cette défiance. La mobilisation d’une armée d’internautes – la Trump’s Troll army – en faveur de Trump a été d’autant plus efficace que l’on connaît la logique virale de propagation des rumeurs, idées et réputations à travers les réseaux, et les possibilités de manipulation qu’ils recèlent. Mais, là encore, nous en sommes plutôt au niveau des conséquences – ce qui a été rendu possible – que des causes profondes qui ne sont rien moins que l’instauration d’un monde nouveau, virtuel, dans lequel se construisent les représentations, à l’intérieur du monde réel.
Une version « high-tech » de la caverne de Platon
Nous pouvons nous le représenter comme une réplique version « high-tech » de la caverne de Platon, ou comme une gigantesque bulle de Center Parcs ou d’un de ces sites artificiels de Las Végas avec leurs faux ciels. La plupart de nos concitoyens – bien au-delà des catégories socialement et culturellement déshéritées – y vivent de façon confinée, sans avoir même l’idée qu’il y a une autre réalité accessible en dehors. Contrairement à la version platonicienne, les chaînes sont directement dans les têtes, produisant une nouvelle sorte de servitude volontaire.
Donald Trump est une créature de ce monde virtuel-là, et de ce monde d’avatars seulement. On sait qu’il en était devenu une icône, notamment avec son émission de téléréalité The Apprentice. On peut donner une idée de ce monde factice à partir de la transposition de quelques éléments clés.
Notre terre-patrie, comme l’appelle Edgar Morin, y devient le cyberespace. Logiquement, la guerre tend à devenir de plus en plus une cyberguerre. Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) en sont les régulateurs, faisant ensemble office d’état. L’internaute en est le citoyen et/ou le client, les deux fonctions fusionnant. La personne y est complètement dissoute dans ses avatars. Elle manifeste son civisme par son ardeur à cliquer sur les innombrables sondages en ligne sans les lire vraiment, au gré de sa fantaisie du moment. Les évènements qui comptent sont ceux qui créent le buzz, c’est-à-dire qui surprennent, bluffent, et polarisent les attentions. C’est d’ailleurs cela qu’excelle à créer Donald Trump. Ce monde-là a sa propre religion, internet, avec ses objets de culte, les NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la communication) et autres objets techniquement sophistiqués, le smartphone ou la tablette faisant office de signes ostentatoires d’appartenance se substituant aux croix et chapelets d’antan comme supports de prières incessantes. Les grands prêtres de ce monde-là (ceux des GAFA) se réunissent parfois dans le désert du Nevada pour d’étranges pratiques occultes, à l’occasion du Burning man.
Time-lapse du festival Burning Man par Spi0n
Les valeurs y sont également spécifiques. Le jeu s’y situe très haut dans l’échelle. Déjà en 2003, l’administration Bush pourchassait les terroristes en Irak en les situant sur un jeu de 52 cartes. La morale a été un moment définie par la « nétiquette » ; elle est maintenant ringardisée, l’agressivité et l’expression de la haine devenant la norme sur les réseaux et forums. Pourtant, il y a encore une conception du Bien et du Mal ; le Bien est une sorte de consumérisme sympa. Le Mal, c’est ne pas jouer le jeu de ce monde-là… En l’occurrence, la mauvaise action typique est l’utilisation des bloqueurs de publicité. Beaucoup de sites exigent d’ailleurs de les neutraliser avant de libérer leurs écrans, en alléguant que cette publicité leur est nécessaire, contraignant ainsi les quelques 85% d’internautes qui s’en plaignent à les subir (à quand l’introduction de la nécessité morale de respecter la pub dans les cours d’instruction civique ?)… Ces valeurs sont évidemment « boostées » par les entreprises, qui qualifient « d’évangélisation » leur propagation sur les différents marchés.
La génération Trump a sa « novlangue »
Ce monde, enfin, a sa propre « novlangue ». Comme « l’Océania » de George Orwell. La communication (mode exclusif) se fait par texto et par tweets, la lettre papier étant vouée aux oubliettes, et le face à face physique devenant superfétatoire. On sait là-encore que le nouveau président en est un fervent utilisateur. Selon Fred Turner « Donald Trump s’immisce partout dans la sphère intime. Avec Twitter, il touche directement tous les membres de ma famille et m’accompagne en permanence dans ma poche sur mon smartphone ». Le texte à l’ancienne, ou le discours un peu long, y sont évidemment devenus impossibles. Forcément, la pensée doit s’y adapter, c’est-à-dire se rétrécir en proportion. C’est parfois difficile ; heureusement, on peut compter pour la formater à ce gabarit sur l’Education nationale, qui fait de l’introduction des tablettes à l’école comme de l’apprentissage des codes informatiques ses missions essentielles, et a contracté avec Microsoft pour mieux les assumer.
Tel est le monde virtuel qui a engendré ce fait aberrant que la campagne électorale, les primaires et l’élection finale sont restées à l’intérieur de cet univers artificiel du divertissement, que ses facteurs décisifs ont plus souvent été issus du spectacle, que de la réalité sociale ou culturelle. En France, Coluche fut un précurseur de ce mouvement avant 1981, sans que l’on sache si lui-même se prenait ou non au sérieux. Depuis, on a eu Silvio Berlusconi puis Beppe Grillo en Italie, (revendiquant sa proximité idéologique avec Donald Trump), Michel Joseph Mertelly, ancien chanteur, dit « Micky le doux », président de la République à Haïti… En France les politiques anticipent, la primaire de la droite ayant donné lieu à une mise en scène très proche précisément de celle des jeux télévisés.
Pourtant, le monde réel existe encore. Comme dans Pétrouchka, le ballet dont la musique a été composée par Igor Stravinsky en 1910-1911, c’est quand des marionnettes coule le sang que l’on prend conscience qu’elles sont encore des êtres réels. Les avatars aussi peuvent cacher un être humain.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !