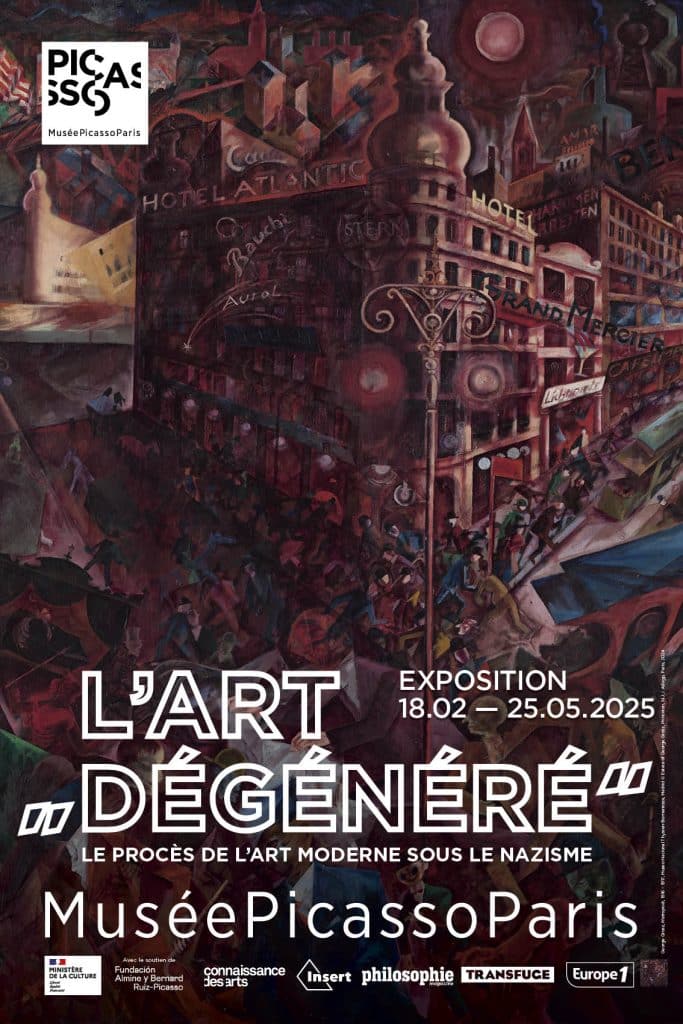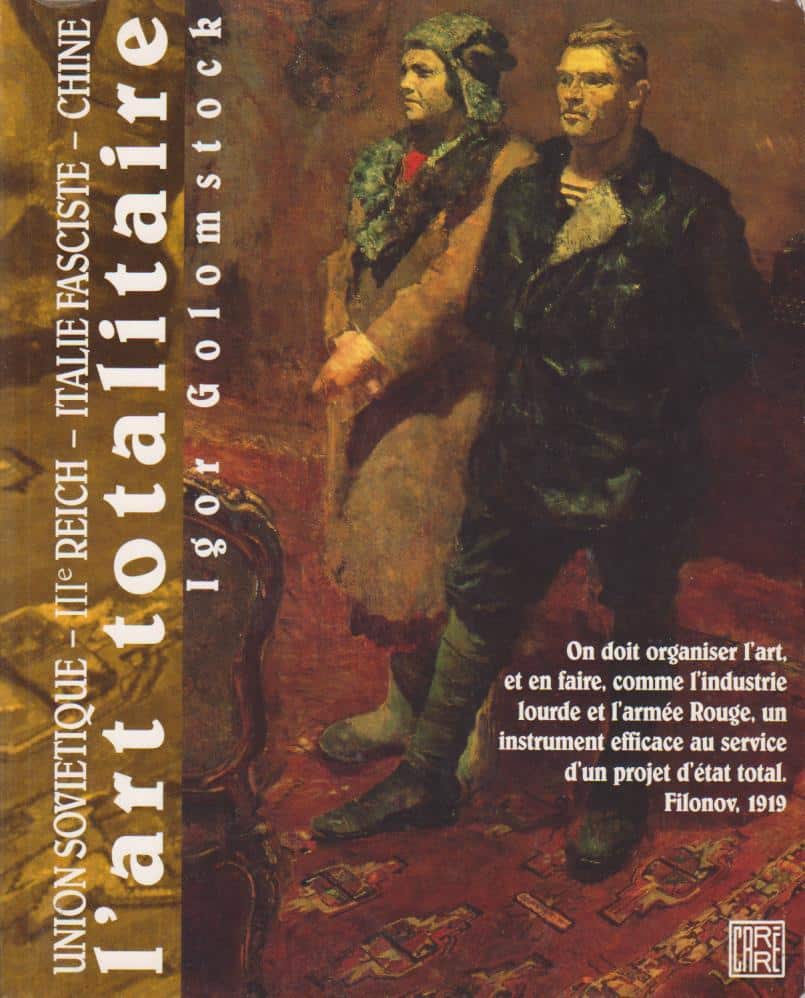Lyrique : Le Paradis et la Péri de Robert Schumann, dernière demain !
De Robert Schumann (1810-1856), la postérité a retenu bien davantage ses chefs-d’œuvre pour piano que ses très rares compositions lyriques. À l’immense compositeur romantique l’on ne doit, en tout et pour tout, que l’opéra Genoveva, dont ce féru de littérature écrira lui-même le livret en 1848, d’après une légende médiévale. Et Manfred, tiré de Byron, un mélodrame pour voix parlée, chœur et orchestre. Reste Le Paradis et la Péri, créé à Leipzig en 1843 sous la direction du compositeur, et qui relève plus de l’oratorio que de l’opéra proprement dit. Sur un livret de son ami d’enfance Emil Flechsig (1808-1878) avec qui Schumann restera lié toute sa vie, l’œuvre se veut une allégorie de la Rédemption. Les arrière-plans fort exotiques du conte inspiré par Lalla-Rookhn : an Oriental Romance (1817), poème épique dû au grand irlandais Thomas Moore (1779-1852), projette cette féérie extatique tour à tour en Inde, en Egypte, en Syrie… Résumons : esprit céleste banni du paradis, la Péri aspire au salut. Le sang d’un héros indien, puis l’amour d’une vierge égyptienne, et enfin les larmes d’un criminel syrien repenti lui rouvriront les portes du Ciel.
Trois représentations exceptionnelles
Si Le Paradis et La Péri n’est pas souvent donné de nos jours, il faut savoir que l’œuvre triompha en Allemagne puis dans l’Europe entière, et jusqu’à New-York cinq ans plus tard. L’on comprend bien pourquoi : une musique fluide, des mélodies enveloppantes, des chœurs à la fois énergiques et amples, des airs d’une suavité délicieuse. On est pourtant très loin des audaces instrumentales des symphonies, comme des fulgurations et des angoisses qui s’expriment dans l’écriture pianistique de Schumann. N’était le spectre assez novateur de la palette sonore (faisant la part belle aux percussions) où s’affirme déjà nettement le premier romantisme germanique, l’œuvre se raccorde encore à la tradition Sturm und Drang (« tempête et passion ») ; l’esthétique formelle de La Péri n’est pas fondamentalement éloignée de Fidelio, d’Obero ou du Freischütz.
A lire aussi: Naissance de la Bossa Nova d’Alain Gerber – L’évocation magistrale d’un courant musical tout aussi magistral
Sous le grand œuf de bois tressé de l’auditorium de La Seine Musicale, les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines ont fait, il y a moins de dix ans, une proue monumentale à l’île Seguin. C’est donc dans cette enceinte qu’est donnée, pour trois représentations exceptionnelles, une version sur instruments d’époque – marque de fabrique, comme l’on sait, d’Insula orchestra et du chœur Accentus, dont sa fondatrice, Laurence Equilbey occupe le pupitre.
Comme souvent hélas, la mise en scène n’ajoute pas grand-chose à la beauté intrinsèque de cet oratorio, qui se porte très bien d’être proposé en version de concert comme ça a été le cas – hasard du calendrier ? – à la Philharmonie de Paris, il y a quelques jours, par le Concert des Nations et la Capella National de Catalunya, sous la direction de Jordi Savall.
Johanni van Oostrum souffrante
La présente scénographie dispose un plateau polygonal d’une matière charbonneuse, découpé par des faisceaux de lumière crue, dans lequel sombre, presque engloutie, l’épave d’un piano à queue laqué de blanc. Hommes en redingote et hauts-de-forme noirs ; chœurs en costumes de cotonnade écrue. La Péri, figure quasiment statique d’un bout à l’autre du spectacle, emprise dans une robe de bal immaculée, son bras droit gainé d’une aile vaste, blanche et célibataire, cernée d’anges noirs emplumés de lourdes ailes repliées… Sur l’obscurité d’un fond de scène enveloppé dans le manteau d’une immense toile noire sur laquelle viendra se démultiplier la projection, se déploie sur écran large une vidéo omniprésente, voire tentaculaire, épousant tour à tour la forme d’un aquarium dans le volume duquel on voit se redoubler virtuellement la silhouette de La Péri, puis des formes abstraites alternant avec paysages sylvestres ou bucoliques, cascades, volutes de fumée, colonies d’oiseaux, chromatismes variés dont les contours se noient – admettons que ce soit assez joli par instants – la vidéaste Astrid Steiner, venue de l’univers techno, n’a pas été sollicitée en vain. Bref, formellement très éclectique, cette projection en continu a sensément pour objet d’accompagner visuellement le climat propre aux trois « actes » de la féérie. Sa plastique virtuose n’en finit pas moins par coloniser celle-ci, sans en éclairer beaucoup les développements, il est vrai assez touffus. Signé Daniela Kerck (à qui l’on doit une Norma au Théâtre du Châtelet et, l’an passé, la régie d’un Turandot à Wiesbaden, en Allemagne) le dispositif scénographique éthéré confine ainsi à l’abstraction. Sans être adepte à tout prix de la littéralité figurative, on se prend à regretter que, précisément dans cet oratorio baigné d’un imaginaire romantique où la fantasmagorie exotique se donne des ailes, le partis pris scénographique récuse délibérément la couleur locale.

Quasiment au pied levé, Mandy Fredrich a dû remplacer la Sud-africaine Johanni van Oostrum attendue dans le rôle-titre, mais souffrante. Il ne paraît pas qu’on ait perdu au change, la soprano germanique assumant avec brio cet emploi, dans un vibrato qui miroite jusque dans les aigus. Dans cette distribution, la palme revient au baryton Samuel Hasselhorn – timbre à la fois charnu et délicat, phrasé impeccable, articulation ciselée. Pareillement, on applaudit à la performance du ténor allemand Sebastian Kohlhepp, tout comme à l’alto Agata Schmidt… La rédemption par le chant, en somme.
Le Paradis et la Péri, de Robert Schumann. Oratorio pour voix solistes, chœur et orchestre, op. 50. Avec Johanni van Oostrum, Sebastian Kohlhepp, Agata Schmidt, Samuel Hasselhorn… Direction : Laurence Equilbey. Mise en scène : Daniela Kerck. Vidéo : Astrid Steiner. Chœur : accentus. Orchestre : Insula orchestra.
Durée : 2h.
La Seine Musicale, île Seguin, Boulogne-Billancourt.
Le 16 mai, 20h. Le 17 mai, 18h.