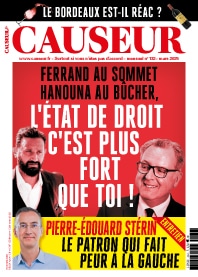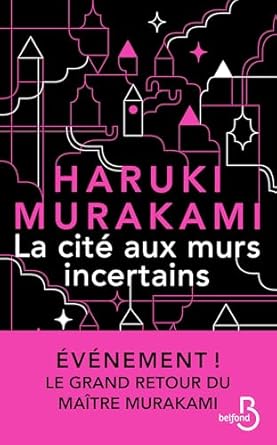Dans Je me retournerai souvent, Jean-Paul Enthoven évoque des souvenirs et des auteurs qu’il a connus, lus ou fréquentés. Pas pour les tièdes…
De sa retirance parisienne, en bordure du jardin abritant quelques œuvres célèbres de l’ogre Rodin, dont La Porte de L’Enfer, pour voir les allers-retours de Satan, Jean-Paul Enthoven nous offre une promenade littéraire et égotiste qui ravira les amoureux de la belle langue. La confession de l’ancien éditeur, devenu écrivain, vaut le détour. L’homme, de nature secrète, se met à nu, acceptant de montrer les défauts de la cuirasse, mais également ses qualités. On a l’image d’un esthète, toujours élégant, en pantalon blanc et chemise de lin, le visage halé, les lunettes fumées, le ton qui en impose, la remarque qui flatte ou qui tue, c’est selon l’interlocuteur. Il regrette l’Europe galante, en retrouve quelques éclats en Italie, notamment en Toscane, où réside sa Bien-Aimée, le long de la côte amalfitaine, sur l’île de Capri, sous le regard langoureux du fantôme de Bardot méprisé par Godard. C’est un sudiste sensuel qui prend des avions comme on fume un cigare. On lui envoie un message, il est à Miami, au Venezuela, il boit un cocktail en songeant à son prochain livre. C’est peut-être le dernier extravagant, dans le style de Paul Morand ; le Morand, visiteur du soir de Proust, l’homme des nuits ouvertes, de la nouvelle tranchante comme du diamant, du sprinter vers une ligne d’arrivée incertaine, obsédé par la camarde, de l’angoissé permanent. Mais aucunement l’écrivain statique, devenu académicien pour faire plaisir, encore une fois, à sa femme richissime et antisémite. De Gaulle a fini par retirer son veto. Il avait d’autres chats à fouetter. Le Morand crépusculaire du Journal inutile, confiant ses relents d’âme moisie à Jacques Chardonne, guère plus fréquentable que le sectateur de Pierre Laval, il le déteste, et comme il l’a aimé, sa phrase n’en est que plus assassine : « Il est toujours éblouissant – l’ignominie se déguste, même honteusement – mais il est devenu odieux et méchant », écrit Enthoven. Plus loin : « À chaque page de ce Journal, Morand se rapetisse. Ses giclées de bile le défigurent. » Il en va de même pour Pierre Drieu la Rochelle. Lui aussi est passé de l’autre côté de la rive, celle des croix gammées. Du talent, irradié par « une immaturité perpétuelle », et un antisémitisme comparable au diabète. Proche de Jacques Doriot, communiste converti au nazisme, enivré de causes perdues, il évite le recyclage d’après-guerre, dont beaucoup d’écrivains collabos ont su profiter, en se suicidant. « Le tweed et le gaz », résume Enthoven qui ne manque pas sa cible. À propos de ces écrivains talentueux, assis dans le sens inverse de l’Histoire, il note : « On ne dira jamais assez tout ce que l’on doit aux écrivains infréquentables. Ils préviennent les maux dont on pourrait mourir. Ce sont des vaccins. » Je me retournerai souvent n’est pas pour les tièdes.
À lire aussi, Pascal Louvrier : Bouches cousues
Le titre est emprunté à un poème d’Apollinaire. Il indique que l’écrivain patrouille sur la crête de la falaise, en surplomb de la mer turquoise, et que c’est la fin de l’après-midi, comme le lui fit remarquer une jeune femme blonde qui ne pratiquait pas la langue de bois. « Cette jeune fille me tendait un miroir couleur du temps, note Enthoven. Déjà la fin de l’après-midi ? Juste avant le crépuscule ? Peu avant la nuit… » L’heure d’écrire, en tout cas. Sagan faisait la même chose, elle chinait ses titres de roman chez les poètes. Enthoven a connu l’auteure de Bonjour tristesse grâce à son amie Florence Malraux. Il consacre un chapitre très émouvant à « Miette », la fille du « barde gaulliste ». Il faudrait citer tout le livre tant il regorge de pépites. Sagan, donc, reçoit Jean-Paul et comme elle est proustienne, elle lui pose trois questions sur son auteur préféré. Ça tombe bien, Enthoven fréquente les allées sinueuses de l’asthmatique Marcel. Les réponses fusent et le voici introduit dans le cercle fermé et alcoolisé de Françoise. Enthoven parie que ses romans trouveront de nouveaux lecteurs. Sa modernité joue en sa faveur. Son « amoralisme tranquille », précise-t-il. « Elle est la seule femme qui figure sur mon Mur Sacré », ajoute-t-il. Puis, il en profite pour donner un coup de griffe au mauvais tissu de notre époque. « Qui oserait, chez nos modernes, mettre tant de riches, tant de beaux quartiers, dans un casting romanesque ? Et tant de voyages en première classe ou d’épaisses moquettes sur lesquelles des robes coutures s’affalent dans un bruissement soyeux ? » Enthoven, ici, parle de certains décors de ses romans. La guerre du goût impose de ne pas rendre les armes devant « les chiens de garde qui veillent sur le bon traitement de la ’’question sociale’’ ou de ’’la domination patriarcale’’. »
D’autres portraits savoureux sont présentés par Enthoven. Citons Barthes, « veuf de sa mère », Kundera, « homme révolté », Diderot, son « ange gardien le plus intelligent », Cioran, « absolument généreux », Gracq, « l’exquis mortifère de Saint-Florent », Louise de Vilmorin, de la race des femmes conversiationnistes, Hemingway et ses coqs de Key West, Camus, si proche par l’enfance vécue sous le soleil d’une Algérie encore française, Gary, le dépossédé de tout, et tant d’autres voyageurs du temps qu’il faut présenter à la nouvelle génération qui lit de moins en moins et perd la mémoire. Sans oublier Aragon, dont le fantôme rend visite à Enthoven – il est très présent dans son avant-dernier roman intitulé Ce qui plaisait à Blanche. Il aimerait lui poser plusieurs questions, dont celle-ci : « As-tu vraiment fait l’amour avec Pierre Drieu la Rochelle, une nuit de 1926, sur la plage d’Anglet ? »
Et puis, il y a l’évocation de Philippe Sollers – je viens de citer deux titres de ses livres. Enthoven se souvient de l’ami, du complice parfois, mais il n’hésite pas à souligner les travers du Sollers parfois trop « stratège, très parisien de province, qui voulait se la jouer fine et disait soudain : ’’bon, passons dans la salle des cartes…’’ – ce qui signifiait : où en sommes-nous avec les forces en présence ? » C’est vrai qu’il avait le talent d’un agent secret aux identités rapprochées multiples (IRM). Il éclatait de rire pour masquer sa timidité ou préserver son isthme peuplé de mouettes magiciennes. C’était un sous-marin, Philippe, avec de nombreux sas, dont un de décontamination, très efficace. À propos de l’auteur de Femmes, Enthoven révèle : « Il ne lisait jamais mes livres mais en disait le plus grand bien à des amis communs, à des critiques, à des jurés et à moi-même. J’ai commencé par en être blessé. Puis j’ai cessé de lui en vouloir. J’aurais pourtant bien aimé qu’il en soit autrement, c’était impossible, ce que j’écrivais ne l’intéressait pas. » C’est ce que Sollers appelait, à la fin du mois d’août passé à écrire face à l’Atlantique, le retour dans « la vallée des mensonges ». Mais Enthoven ne lui en veut pas. Il n’est du reste pas rancunier – explication à la page 140 –, il continue de le guetter, il sait que de là où il est, il voit tout, entend tout, comprend qu’il a raison sur toute la ligne, que Satan est aux commandes et que les esprits sont de plus en plus anesthésiés. C’est « un agité d’outre-tombe. »
A lire aussi: Lovecraft et ses mondes fantastiques en Pléiade…
À travers ces portraits, se dessine, par petites touches impressionnistes, l’autoportrait de l’auteur. Il ne dit pas tout, bien sûr, l’homme est pudique et le savoir-vivre l’empêche de citer le nom de ses ennemis. Mais il sème des indices, comme il supprime la ponctuation quand il rejette Morand. Il faut prendre le temps de le relire, comme il prend le temps de se retourner souvent. Il tait également certaines blessures profondes. Ça s’appelle l’élégance du cœur, ce cœur tout neuf après une violente alerte. Il nous dit également qu’un jugement ne doit jamais être définitif, sauf pour les traitres. Il commence le livre par être critique à l’égard de René Char, puis il nous recommande la lecture d’un de ses poèmes, Allégeance, et il nous dit pourquoi – ah, l’amour.
Jean-Paul Enthoven est fidèle en amitié. Fidèle à son « frère choisi », Bernard-Henri Lévy, qu’il orthographie « Les Vies ». Le philosophe ne tient pas en place. « Ce remue-ménage, c’est son élément, écrit son ami – le mot n’est pas galvaudé. Il est convaincu qu’il est né pour le chahut et la renommée. » Entre les deux personnalités, des engueulades, des désaccords, des digressions, mais rien de grave, ils s’estiment trop. Jean-Paul Enthoven dit encore en parlant de Bernard-Henri Lévy : « Il essaie de réparer le vaste monde tandis que, par tempérament, je ne me penche que sur les alentours de mon seul nombril. »
Une phrase, soudain, me vient. Elle est signée Paul Valéry : « Je me suis détesté, je me suis adoré – puis, nous avons vieilli ensemble. »
Je me retournerai souvent appartient à la catégorie des livres – rares – qui protègent.
Jean-Paul Enthoven, Je me retournerai souvent, Grasset. 272 pages.